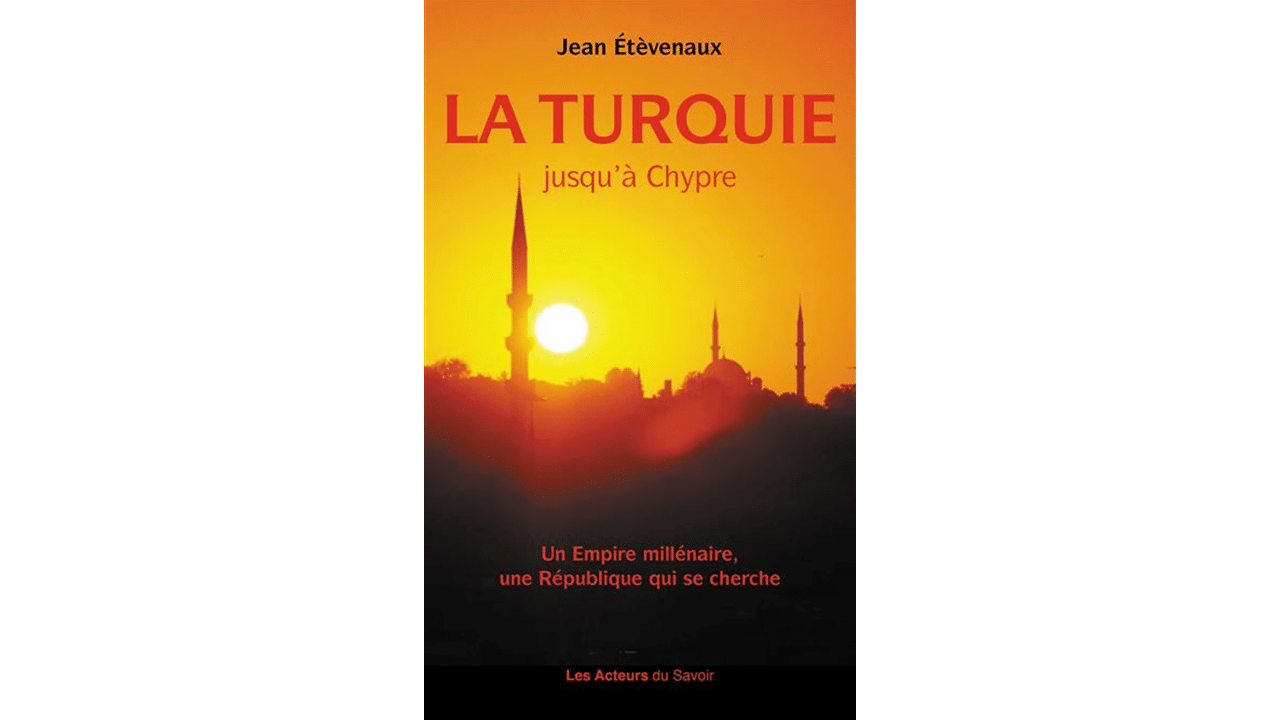L’actualité et le thème du dossier du dernier numéro nous obligent à faire une pause dans notre cycle des grands capitaines pour nous consacrer à une bataille anecdotique sur le moment, mais devenue un véritable mythe fondateur : le siège de Massada en 73-74 de notre ère.
Article paru dans le numéro 49 de janvier 2024 – Israël. La guerre sans fin.
En 66, lorsqu’éclate la première grande révolte juive, cela fait tout juste un siècle que la Judée est sous influence romaine. Ce royaume s’était émancipé des Séleucides en 167 av. J.-C. grâce aux Maccabées, une famille à l’origine de la dynastie hasmonéenne, que les Romains ont maintenue au pouvoir dans un protectorat peu contraignant. Mais en 6 de notre ère, les troubles engendrés par la succession d’Hérode le Grand (qui régna de 37 à 6 av. J.-C.) décident Auguste à faire de la Judée une province romaine. L’exaltation religieuse alimente alors nombre de courants messianiques, pacifiques comme les esséniens et les disciples de Jésus, ou prônant la révolte ouverte, comme les zélotes, qui protestent contre le resserrement de la tutelle romaine en s’opposant violemment au recensement organisé par le gouverneur de Syrie pour établir l’assiette de l’impôt.
Guerre civile autant que guerre de libération
Tous ces événements nous sont connus par l’Histoire des juifs de Flavius Josèphe, la seule source contemporaine non chrétienne qui évoque la prédication et la mort de Jésus. Josèphe est non seulement un témoin, mais aussi un acteur de la révolte des années 60, d’abord du côté des rebelles – son premier nom est Josèphe ben Matiyahu – avant de se rallier aux Romains en 67. Il décrit les zélotes comme une nouvelle école théologique, après les sadducéens, les pharisiens et les esséniens. Religieux de stricte observance, comme les pharisiens, ils veulent chasser les étrangers – Romains, mais aussi Grecs et autres – des terres juives. Effacés après la répression du début du siècle, ils resurgissent un demi-siècle plus tard, car Josèphe présente les Sicaires, acteurs essentiels en 66, comme leurs continuateurs.
Les Sicaires, appelés ainsi parce qu’ils utilisent la sica, un poignard à lame recourbée, pratiquent d’abord des assassinats individuels, qui visent plutôt les Grecs et leurs rites polythéistes, ou les juifs ralliés à l’ordre romain, considérés à la fois comme traîtres et impies. Mais l’expulsion de Jérusalem des Romains et de leurs partisans, et le massacre de la garnison de Massada, en 66, sont un défi à l’autorité de Rome. La Judée n’ayant pas de troupes romaines permanentes, c’est le légat de Syrie, Cestius Gallus, qui engage la répression avec environ 30 000 hommes, dont la XIIe Légion Fulminata, composée de vétérans. Mais Gallus tergiverse, renonce à attaquer Jérusalem, dont les factions juives se disputent alors le contrôle, et subit une sanglante défaite[1] lors de sa retraite le 25 novembre 66 au défilé de Bet Horon, là même où les Maccabées avaient vaincu l’armée grecque deux siècles plus tôt. Cette victoire doublement providentielle provoque l’extension de la révolte aux régions voisines (Galilée, Samarie, Pérée…). Néron envoie alors des renforts et un général expérimenté : Vespasien, 57 ans – Titus Flavius Vespasianus.
A lire également
Israël : une terre sainte devenue une destination touristique
À la tête de quatre légions et d’environ 50 000 hommes, en comptant les troupes auxiliaires, ce dernier lance la reconquête au début de 67, en commençant par la Galilée et le Golan, au nord de la Judée. Faute de cavalerie, les insurgés ne peuvent disputer le contrôle des campagnes aux Romains et résistent dans des points d’appui urbains ou des forteresses isolées, comptant sur des coups de chance ou des embuscades, comme celle qui faillit être fatale au fils de Vespasien, Titus. Ne pouvant espérer aucun secours extérieur, ces places fortes tombent l’une après l’autre. Après le suicide de Néron en juin 68, Vespasien quitte la Judée pour se mêler à la lutte pour le trône, dont il sort victorieux à l’issue de l’« année des quatre empereurs » (69) ; c’est donc Titus qui mène à bien le siège de Jérusalem.
Les quelque 20 000 rebelles qui tiennent la Ville sainte continuent à se déchirer pour son contrôle. Les zélotes, fermement campés dans le temple et la forteresse Antonia, ont pris l’ascendant et imposent leur intransigeance, allant jusqu’à condamner les assiégés à la famine en détruisant une grande partie des réserves de nourriture. Le siège dure d’avril à septembre 70, et la ville n’est prise qu’après d’âpres combats de rues, notamment autour du temple, qui est incendié le 10 août au cours des combats[2]. La ville est incendiée, les survivants sont massacrés ou réduits en esclavage. Titus rentre à Rome, où l’attend un triomphe durant lequel il exhibe le butin du temple, dont la Menorah[3] ; à l’issue du défilé, l’un des chefs rebelles, Simon bar Giora, est supplicié en public (71). La Judée est à nouveau soumise, comme le proclame une série de pièces frappées jusqu’à la fin du siècle.
Le mythe de Massada
Toute ? Eh bien, non ! Trois sites fortifiés restent aux mains des rebelles : l’Hérodion, à proximité de Jérusalem, Machéronte et Massada, sur deux rives opposées de la mer Morte. Les deux premiers cèdent rapidement, le troisième, nid d’aigle réputé imprenable, est occupé par une poignée d’irréductibles Sicaires sous la conduite d’Eléazar ben Yaïr, un descendant de Judas le Galiléen – le fondateur de la secte des zélotes. Massada était une forteresse protégeant un palais et des infrastructures vitales – magasins de vivres, citernes recueillant les eaux des versants voisins – aménagés sous Hérode au sommet d’un plateau aux versants abrupts, situé à environ 60 km au sud-est de Jérusalem, sur la rive occidentale de la mer Morte. Avec les familles des combattants et les réfugiés venus de Jérusalem et des environs, la forteresse héberge près de 1 000 personnes.
Pourtant, le pouvoir de nuisance des réfugiés de Massada est plus symbolique qu’autre chose : la révolte est matée, ses principaux chefs éliminés, les combattants trop peu nombreux et trop isolés pour rallumer la flamme ; d’ailleurs, les Sicaires, qui avaient arraché la forteresse à un premier groupe de rebelles, ne s’étaient plus mêlés à la lutte politique, se contentant de piller la région, massacrant notamment 700 juifs de l’oasis voisine d’Ein Gedi. Mais Rome ne pouvait garder cette épine dans sa semelle[4]. Le nouveau gouverneur de Judée, Lucius Flavius Silva, se charge donc de conduire ce siège oublié, ultime épisode sans gloire d’un conflit déjà réglé.
A lire également
Grande stratégie. Comment Rome a conquis son empire
Comme à leur habitude, les Romains procédèrent méthodiquement, construisant d’abord dans la plaine au pied du plateau les circonvallations, un ensemble de fossés et de palissades pour isoler la forteresse. D’une longueur de 4,5 km, elles sont établies durant l’hiver 72-73 (ou l’année suivante) et sont jalonnées de huit camps hébergeant les troupes : la Xe Légion Fretensis et six cohortes auxiliaires, soit environ 8 000 hommes. Comme il n’était pas question d’aborder le plateau par l’est, où la falaise s’élève à environ 400 mètres, ni par l’accès officiel au nord – un étroit sentier surnommé « chemin du serpent » –, le tribun décide d’édifier une gigantesque rampe pour combler les 100 mètres de dénivelé entre les remparts et l’accès occidental, depuis les plateaux voisins. Il ne fallut pas plus d’un mois de travaux, apparemment pas contrariés par les assiégés, soit qu’ils n’aient pas cru possible l’aboutissement de ce chantier colossal, soit qu’ils aient compris que leur infériorité numérique était rédhibitoire – à moins que Josèphe n’ait pas connu tous les détails.
En avril 73 ou 74, la rampe est prête. Une tour d’assaut de 30 mètres est hissée jusqu’aux remparts qui sont rapidement ébranlés par le bélier. Les assiégés improvisent un rempart de fortune, auquel les assaillants mettent le feu ; le lendemain matin, ces derniers envahissent la place… qui n’est plus défendue. Selon Flavius Josèphe, qui prétendait tenir le récit[5] des deux seules femmes rescapées, voyant leur situation désespérée, les Sicaires avaient préféré un suicide collectif plutôt que de subir les conséquences d’une capture par les vainqueurs (viol, torture, supplice ou, pire, esclavage) ; chacun aurait donc tué sa famille, puis dix bourreaux furent tirés au sort pour tuer tous les autres avant de s’entretuer – un seul homme commettrait ainsi un suicide, péché encore plus mortel que le meurtre.
Un complexe paradoxal
Des historiens, comme Pierre Vidal-Naquet, ont quelques doutes sur la véracité du récit de Josèphe, et même sur la découverte sur le site de tessons de poterie avec des noms gravés, accréditant le tirage au sort des bourreaux. Mais ces doutes n’existaient pas quand Israël fut fondé, en 1948, ou lors des fouilles conduites entre 1963 et 1965, peu de temps avant la troisième guerre israélo-arabe, dite « des Six Jours » (juin 1967). Massada était alors un symbole idéal du rôle de sanctuaire que le mouvement sioniste et les juifs du monde entier attribuaient au nouvel État. Aujourd’hui encore, les unités d’élite de l’armée israélienne viennent y réciter le poème Masada, écrit en 1927 par l’écrivain ukrainien Yitzhak Lamdan (1899-1954) et qui se termine par les vers suivants : « Non, la chaîne n’est pas rompue sur le sommet inspiré. Plus jamais Massada ne tombera. »
Forteresse imprenable, mais prise par les Romains.
Massada offre un parfait exemple du complexe de la citadelle assiégée, ce tropisme géopolitique qui commande une vision d’un monde hostile et menaçant, contre lequel la défense est légitime et permanente, et qui peut conduire à des agressions à titre d’attaques préemptives (comme Israël en 1967), voire préventives. En ce sens, l’histoire – incertaine – devient mythe, c’est-à-dire une parole intemporelle et incontestée qui explique le présent, malgré une leçon ambiguë. Transcendance de la faiblesse par un héroïsme désespéré, la défaite des zélotes magnifie la radicalité, en particulier religieuse, qui conduit pourtant à l’impasse – Flavius Josèphe raconte avoir lui-même échappé à un suicide collectif à Jotapata, en 67, préférant alors se livrer aux Romains. Mais elle valorise aussi la puissance, pour éviter d’être à nouveau dans la même impasse. Elle est donc un contre-modèle, une expérience historique douloureuse qui justifie, à l’image de l’Holocauste du xxe siècle, l’érection d’un État refuge qui devra s’imposer dans un environnement hostile – c’est le sens de la formule récitée par les militaires sur ses ruines.
A lire également
Carthage, Troie et les larmes de Scipion. Hommage à Marie-Rose Guelfucci
Historiquement, Massada s’inscrit dans la continuité d’un judaïsme persécuté, dominé et finalement défait ; le mouvement sioniste, dont les racines ne sont pas uniquement religieuses – les fondateurs d’Israël sont même laïcs et progressistes –, renoue au contraire avec l’histoire légendaire du royaume qui conquit la Terre promise aux dépens des autres peuples de la région. C’est pourquoi Massada ne peut être pour Israël qu’un contre-exemple, un avertissement des risques encourus par excès de faiblesse – ou par excès de divisions. Golda Meir (Première ministre d’Israël de 1969 à 1974) le reconnaissait : « Oui, nous avons le complexe de Massada. »
La géopolitique d’Israël est dominée par une alternative confiance/puissance : confiance dans les voisins arabes, pour négocier une paix durable ; ou puissance pour s’imposer en toute circonstance à des partenaires non fiables. En entretenant le sentiment d’insécurité d’Israël, en assimilant confiance et faiblesse, le mythe de Massada fait pencher la balance vers le second terme, renforçant ipso facto le rejet par les voisins. Il contribue ainsi à accroître le risque que l’État hébreu voudrait conjurer. La situation actuelle, dominée par la double radicalité du Hamas et des colonies juives illégales, a tout pour réveiller le « complexe de Massada » dans la population israélienne et la diaspora. Mais les Sicaires ont aujourd’hui la bombe atomique…
[1] Pris dans une embuscade, les Romains perdent près de 5 000 hommes, leurs bagages et artillerie de siège et, humiliation suprême, l’aigle de la Fulminata !
[2] Après la destruction du temple de Salomon en 586 av. J.-C., Hérode avait bâti au même endroit un second temple. Il n’en subsiste aujourd’hui que des vestiges d’enceinte, en particulier son « mur occidental » (Kotel), parfois baptisé par anachronisme Mur des lamentations.
[3] Chandelier à sept branches.
[4] Le bassin de la mer Morte est le point le plus bas de l’écorce terrestre (plus de 400 mètres sous le niveau des mers).
[5] Au moment du siège, Josèphe était à Rome auprès de son protecteur, l’empereur Vespasien, dont il a pris le prénom et le gentilice, selon la coutume – Titus Flavius Josèphe.