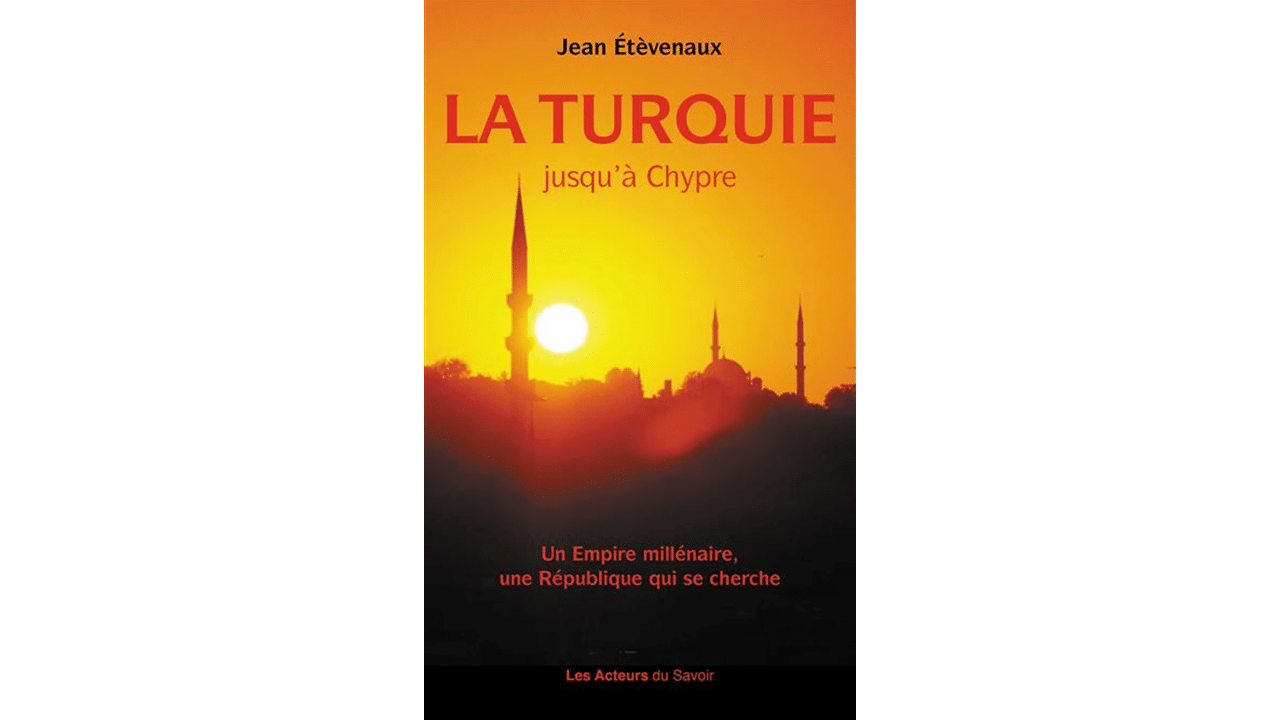L’attaque brutale menée par le Hamas et le Djihad islamique le 7 octobre dernier en territoire israélien n’en finit pas de diviser les 194 États composant l’ONU, notamment quant à la juste réponse à apporter aux massacres et atrocités commises par les deux organisations terroristes.
Le récent vote aux Nations unies de la résolution appelant à un cessez-le-feu « humanitaire » immédiat, le 17 octobre dernier, soit dix jours après les effroyables massacres dont ont été victimes près de 1 400 ressortissants israéliens et étrangers, ont fait voler en éclat, une fois de plus le frêle concept de « communauté internationale ».
Un vote qui divise
120 États ont voté pour, 14 contre, 45 se sont abstenus. La division est encore plus criante et inquiétante au niveau de l’UE, où sept pays (dont la France et l’Espagne, qui préside pourtant le Conseil de l’UE, jusqu’au 31 décembre prochain) ont voté en faveur de la résolution proposée par la Jordanie, tandis que quatre votaient contre (Hongrie, Autriche, Croatie et la République tchèque) rejoignant ainsi la position américaine et que 16 autres s’abstenaient (dont l’Allemagne et l’Italie) à l’instar, du reste, de l’Inde, du Japon et du Canada…
À cet égard, comme les 44 vétos américains brandis par les États-Unis (sur les 83 utilisés par Washington au sein du Conseil de Sécurité depuis 1946) en attestent, quand il s’agit de défendre l’État d’Israël, les polarités diplomatiques l’emportent sur la solidarité euro-atlantique et enterrent l’idée même d’une politique étrangère et de sécurité commune aux 27 États de l’UE.
Désormais, à la sidération qui prit de court les forces armées de Tsahal, ses services de renseignement, la société israélienne et l’opinion publique mondiale, ce sont avant tout les graves conséquences induites par l’attaque des terroristes palestiniens sur le plan de la stabilité régionale qui sont devenus les principaux sujets de mobilisation inquiète planétaire.
Comme en mai 1948, juin 1967 et octobre 1973, les préoccupations des pays arabes voisins, tout comme la légitimité palestinienne à un État, sont venues réveiller une certaine forme d’unité, notamment dans les « rues arabes », alors même que certains de ses mêmes États étaient engagés dans un processus de normalisation avec Tel-Aviv, à l’instar de l’Égypte, depuis les accords de Camp David, en 1978 ; la Jordanie, depuis les accords de Wadi Araba, en 1994 ; et, par le biais des Accords d’Abraham, depuis l’automne 2020, le Maroc, le Soudan, les Émirats arabes unis et Bahreïn.
Failles de sécurité
Sur le plan opérationnel, les failles sécuritaires sont accablantes quant à la prise à défaut de l’inviolabilité des frontières d’Israël. Celles-ci, supposément sanctuarisées par le truchement de son système de défense sol-air « Iron Dome Air Defence Missile System » – prétendument infaillible depuis sa mise en service en 2011 – n’a pu détruire la totalité des quelque 5 000 roquettes tirées depuis la bande de Gaza. Avec un taux de réussite – déjà exceptionnel – de 90% d’interception, quelque 400-500 roquettes ont pu ravager les principales localités du sud d’Israël, à l’aune, sinistre, du nom de l’opération « Déluge d’Al-Aqsa » lancée par le Hamas et le Djihad islamiste.
Par ailleurs, près de 2 500 terroristes du Hamas, notamment ses brigades Izz al-Din-al-Qassam et du Djihad islamique ont pu réduire à néant, en quelques heures, le mur protecteur érigé par Israël et provoquer la mort de 1 400 Israéliens, dont près de 300 militaires et 35 binationaux franco-israéliens, et ce à la stupeur générale mondiale.
Le sort tragique des 222 otages – dont vraisemblablement 9 sont franco-israéliens – encore retenus par l’organisation terroriste palestinienne dans la bande de Gaza est aussi un sujet de vive préoccupation, mobilisant acteurs régionaux (Égypte, Qatar, Turquie, Arabie Saoudite, Irak, EAU) et internationaux (USA, France, Allemagne, Italie, Canada, Vatican, Chine) dans des approches et objectifs radicalement différents.
Cette réalité vient d’ailleurs confirmer le profond fossé que la question israélo-palestinienne n’a cessé de mettre en exergue depuis la création de l’État d’Israël en mai 1948 et la première des centaines de vaines résolutions onusiennes ; à l’instar de la résolution 181 de 1947 ou encore, la résolution 242 de 1967, actant le plan de partage de la Palestine en deux États.
La question des civils
Sans oublier, bien sûr, les trop nombreuses victimes civiles et terroristes, à la suite des bombardements de Tsahal sur une bande de Gaza, prenant au piège 2,3 millions de Gazaouis, ayant provoqué le décès de plus de 6 500 Palestiniens et occasionné plus de 13 000 blessés (selon les chiffres « officiels » quoique interrogeables du ministère de la santé palestinien), en dépit de l’appel insistant à l’ouverture de corridors humanitaires et le déplacement des Palestiniens vers le sud de l’enclave. Sur ce dernier point, force est de constater néanmoins que c’est bel et bien le Hamas qui empêche les habitants de Gaza de fuir les zones qu’Israël a prévenu de frapper, voire d’envahir, dans le cadre de son opération « Épées de fer » dont la dimension terrestre a débuté, visant à « éradiquer » le mouvement islamiste.
Ainsi, la teneur des frappes aériennes israéliennes sur une bande de Gaza de 365 km2 mais qui, avec une population de 2,1 millions, est une des plus fortes densités démographiques au monde (13 000 habitants/km2) interroge, aussi, les règles mêmes du droit international des conflits armés et du droit international humanitaire, dans sa déclinaison des quatre conventions de Genève d’août 1949 et ses protocoles additionnels de 1977, notamment dans la dimension de la protection des populations civiles dans le cadre de conflits armés.
Ces tragiques événements viennent confirmer, en outre, la fragilité du système multinational onusien et mettre en exergue un hiatus aggravant entre les pays, reconnaissant la légitimité d’Israël d’exciper de l’article 51 – autorisant la légitime défense d’un État face à une attaque contre son intégrité territoriale – de la Charte de San Francisco, créant les Nations Unies, en juin 1945. Par ailleurs, les autres États qui, en défendant, le droit des Palestiniens à la création d’un État internationalement reconnu et, en appelant à une forme de « désescalade », n’en joue pas moins – le plus souvent à leur corps défendant – le jeu pervers du Hamas, qui use et abuse de cette légitime cause pour mener à bien son objectif de destruction de l’État d’Israël, depuis sa création en 1987 – nonobstant le retrait, quelque peu factice, depuis 2017, de l’article demandant spécifiquement la destruction d’Israël.
Il convient aussi de rappeler que cet objectif nihiliste va à contrario du Fatah et de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) qui en avait définitivement abandonné l’objectif, en avril 1996, en abrogeant sa charte fondatrice, datant de 1964.
Certes, l’instabilité politique chronique, née des réformes judiciaires et constitutionnelles impopulaires, induite par le 6e gouvernement de Benyamin Netanyahou, depuis décembre 2022 – principalement sous la coupe des partis juifs nationalistes orthodoxes – semblerait fournir une première explication aisée. Il convient de rappeler que ces derniers étaient plus prompts à défendre les colonisations illégales de Cisjordanie que soucieux de réengager le dialogue avec l’Autorité palestinienne et son chef, Mahmoud Abbas, même si ce dernier pâtit négativement de l’impossibilité à organiser une élection depuis 2006, à Ramallah.
Ce n’est, cependant, pas la seule raison explicative du grave fiasco sécuritaire et du drame que vivent les familles israéliennes endeuillées, même si indéniablement la responsabilité politique du Premier ministre israélien est ouvertement posée. Il en est de même pour celle de son ministre de la sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, multi-inculpé, que même le président de la République, Isaac Herzog qualifiait « d’inquiétude » pour Israël. Il en va aussi avec le ministre de la Défense, Yoav Gallant, qui a déclaré vouloir « éradiquer » le Hamas et le Djihad islamique et qui semble se placer dans les pas de son mentor en politique et au sein de Tsahal, Ariel Sharon.
Pour rappel, une grande majorité des Israéliens souhaitent que Benyamin Netanyahou démissionne et reconnaisse la légitimité du Cabinet de guerre mis en place le 11 octobre dernier, dans la grave période de crise que traverse Israël, associant le principal opposant de l’actuel Premier ministre, l’ancien ministre de la Défense, Benny Gantz. La perspective d’un gouvernement d’union nationale, réunissant les anciens Premiers ministres, Naftali Bennett et Yaïr Lapid, recueille aussi l’adhésion d’une large frange de l’opinion publique israélienne.
Par ailleurs, la pusillanimité des États européens – au premier titre desquels la France – qui s’étaient pourtant démenés en faveur de la « solution à deux États », de la Déclaration du Sommet de Venise en 1980, reconnaissant le « droit du peuple palestinien à l’autodétermination » ; la Conférence de Madrid, en 1991 ; les Accords d’Oslo en 1993, jusqu’au Plan de paix proposé par Riyad en 2002, n’en apparais que plus criante.
Une paix lointaine
La réunion du « Sommet de la paix » convoquée par l’Égypte, réunissant les États de la Ligue arabe, du Conseil de Coopération des États arabes du Golfe (CCG) de l’Union européenne, des États-Unis, de la Grande-Bretagne, n’aura ainsi, logiquement, débouché que sur un narratif récurrent appelant à la solution – presque devenue mécanique – à deux États, un vague appel à la désescalade, ainsi que l’ouverture de corridors humanitaires que viennent, fort heureusement confirmer l’entrée à Gaza, par le terminal égyptien de Karm Abou Salem – Kerem Shalom et de Rafah de 28 camions d’aide humanitaire.
L’on en viendrait presque à se demander si ce « mantra » ou figure de style diplomatique des deux États, pourtant répétée inlassablement depuis 1947, le plus souvent dans le vide, au profit de deux populations devenues de plus en rétives à cohabiter dans un même État ou dans deux États séparés, même reconnus internationalement, reste encore possible ?
Le piège irrémédiablement tendu par la coalition hétéroclite des ennemis d’Israël se referme.
Qu’il s’agisse des mouvements terroristes réputés proches de l’idéologie radicale des Frères musulmans, tels que le Hamas et le Djihad islamique ; Daesh, et sa déclinaison égyptienne du mouvement Ansar Beït al-Maqdess, pour qui la libération de Jérusalem – Al Qods est consubstantielle de sa création ; ou encore, les « proxies » chiites, tels que le Hezbollah libanais, les milices Hachd al-Chaabi irakienne, les Houthis zaïdites yéménites, répondant ainsi aux injonctions de l’Iran, qui menace ainsi logiquement Tel-Aviv d’une réponse si Tsahal entrait dans Gaza.
Le Hamas, le Djihad islamique et ses promoteurs – parrains qu’ils soient à Ankara, Téhéran et Doha, ont d’emblée obtenus ce qu’ils cherchaient : démontrer la faillibilité du dispositif sécuritaire d’Israël d’une part et remettre en cause par ailleurs les acquis du processus de normalisation avec Israël.
Les Accords d’Abraham du 15 septembre et 20 décembre 2020 ne devraient ainsi pas voir aboutir le rêve d’un dialogue approfondi entre l’Arabie Saoudite et Israël, du moins dans les prochains mois, comme le confirme la fin de non-recevoir à cet effet, du prince héritier saoudien, Mohammed ben Salmane.
Pire, l’initiative de sécurité et paix proposée par la Chine, qui avait vu Téhéran et Riyad reprendre à nos dépens et à notre surprise stratégique, leur dialogue diplomatique en mars dernier, risque de confirmer la « dé-occidentalisation » d’une éventuelle solution de stabilité régionale.
Le Président américain Joe Biden, en se déplaçant à Tel-Aviv et Jérusalem la semaine dernière, et en tenant de faire voter, au plus vite, dans un contexte politique tendu à la Chambre des Représentants, une aide exceptionnelle de 105 milliards de dollars (dont 14 milliards de dollars pour Israël, qui viendront s’ajouter aux 38 milliards de dollars d’aide militaire engagée par Barack Obama depuis 2017 jusque 2028, soit 3,8 milliards de dollars annuels) en a bien saisi le risque potentiel quoique bien réel.
Pour rappel, les États-Unis auraient le plus à perdre en cas de conflit régional, fragilisant le fragile statu quo militaire et diplomatique actuel, eu égard aux quelque 260 milliards de dollars octroyés par Washington à Tel-Aviv depuis 1948, dont 124 milliards de dollars, rien que sur le plan militaire !
Le risque d’un conflit régional est ainsi dans tous les esprits
Le Charles-de-Gaulle va ainsi rejoindre en Méditerranée orientale les deux porte-avions américains (USS Eisenhower et USS Ford) et ainsi « prévenir » le risque d’une escalade dont Téhéran et les groupes armés qu’il contrôle au Liban, Syrie, Irak et Yémen détiennent indiscutablement la clé. Téhéran est ainsi pointé d’un doigt accusateur, tant par le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou que le président américain Joe Biden. Ce dernier se veut de plus en déterminé à démontrer la responsabilité iranienne derrière les attaques menées très récemment et de plus fréquemment par les milices chiites irakiennes Kataeb Hezbollah contre les bases américaines dans le nord-est de la Syrie et le nord-ouest de l’Irak.
Dans ce contexte hautement crisogène, la tournée d’Emmanuel Macron, effectuée entre Tel-Aviv, Ramallah et Le Caire n’aura, hélas, permis de retrouver les accents gaulliens de 1967, quand la France imposait sa voix au Conseil de sécurité pour la reconnaissance des deux États autour de la résolution 242. Emmanuel Macron n’aura ainsi pu retrouver, non plus, la verve chiraquienne de 1996, quand le Président de la République rappelait, avec force et vigueur, le rôle protecteur de la France sur les lieux saints dans la ville de Jérusalem.
Pire, notre Président de la République, en proposant une singulière coalition anti-Hamas, liée ou copiée sur la coalition mondiale contre l’État islamique (The Global Coalition Against Daesh, regroupant 86 États et organisations intergouvernementales et institutions) n’aura guère plus convaincu nos alliés arabes (Jordanie, Égypte, Liban, EAU, Arabie Saoudite) a contrario de l’épique prise de parole de Dominique de Villepin, alors ministre des Affaires étrangères, le 14 février 2003, au Conseil de Sécurité des Nations Unies, quand la politique arabe de la France faisait les riches heures de notre diplomatie de prévention et de résolution des conflits. Il est vrai que l’accusation formulée par le roi de Jordanie, Abdallah II et son épouse Rania, quant aux « doubles standards » qui motiveraient le regard biaisé de « l’Occident » vis-à-vis de la question palestinienne, n’était pas formulée ni ressentie avec autant de prégnance, à Amman, à Beyrouth, à Rabat ou au Caire, il y a vingt ans.
Sans remonter jusqu’à Michel Jobert, qui comme ministre des Affaires étrangères de Georges Pompidou, dans les années 1970, portait haut une approche d’équilibre unanimement saluée par les capitales arabes comme par l’État d’Israël, force est hélas de constater que la politique arabe de la France ne fait plus écho, aujourd’hui, avec les doléances des principales capitales arabes et levantines. Pourtant, c’est dès 1974 que Valéry Giscard d’Estaing reconnaît l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), contribuant ainsi, le premier, à lui garantir son statut de membre observateur au sein de l’ONU.
Faut-il y ainsi voir dans l’incapacité française à imposer un cessez-le-feu, tout en reconnaissant le droit légitime d’Israël de se défendre ; en se réjouissant, malgré tout, des timides avancées sur le plan humanitaire que le déplacement présidentiel aura néanmoins permis d’obtenir, un assourdissant effet collatéral de l’effacement diplomatique occidental ?