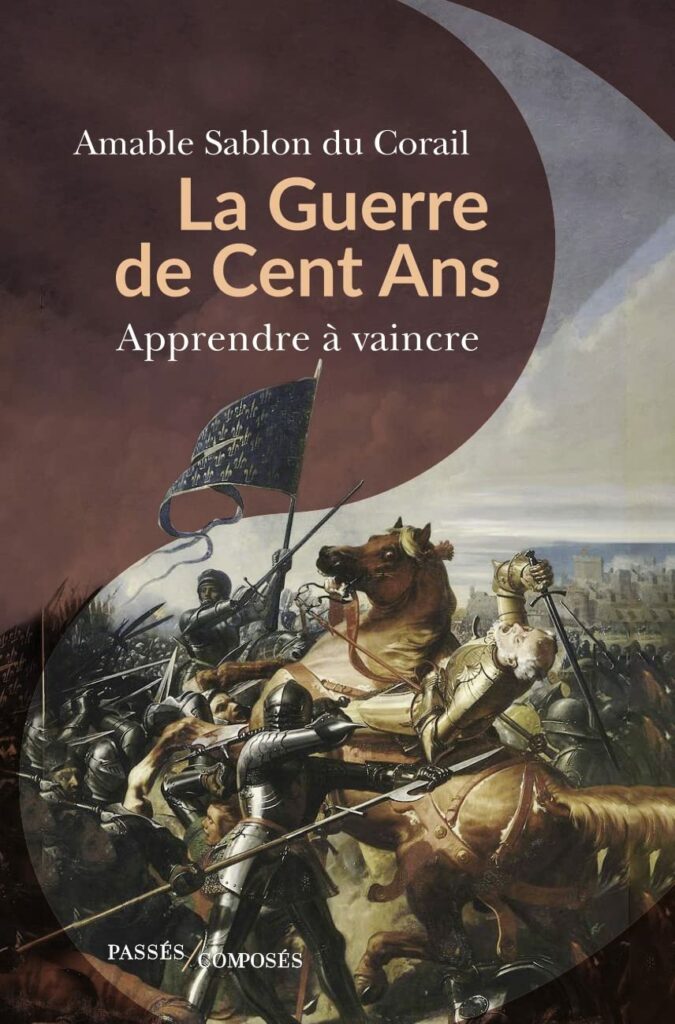Concept en mutation aujourd’hui devenu un slogan politique, la « Souveraineté » est un terme qui revient à la mode. Si la légitimité politique ne se définit plus par la complémentarité entre le pouvoir royal et le pouvoir papal, ce fut le cas au Moyen-Âge, où cette souveraineté était vue autrement. Entretien avec Amable Sablon du Corail.
Amable Sablon du Corail est historien, archiviste aux Archives nationales. Il a notamment publié La Guerre de Cent Ans. Apprendre à vaincre, (Passés Composés, 2022).
Découvrez les autres épisodes de la série sur la souveraineté.
Propos recueillis par Pétronille de Lestrade.
Comment définir la souveraineté au Moyen-Âge ? Comment distinguer majesté et souveraineté ?
Le mot de souveraineté vient du latin superioritas, qui s’applique à un pouvoir ne reconnaissant aucun supérieur. Il apparaît dans la langue française à la fin du XIIIe siècle, au moment précis où le roi de France affirme sa souveraineté en matière temporelle. La majesté, quant à elle, dérive de majus (plus grand), et désigne donc exactement la même chose, à savoir la position la plus élevée dans une hiérarchie de pouvoirs. Le jurisconsulte Jean Bodin ne s’y est pas trompé, qui, en 1576, a défini la souveraineté comme « la puissance absolue et perpétuelle d’une République, que les Latins appellent majestatem » – étant entendu que la République dont il parle est une communauté politique, gouvernée par un roi et ordonnée au bien commun. La distinction entre majesté et souveraineté est donc pour l’essentiel une affaire de chronologie : Tandis que les juristes romains parlaient de majestas (appliquée au peuple romain, puis transférée au prince), les auteurs médiévaux emploient concurremment les deux termes, la souveraineté finissant par évincer la majesté. Le roi est « souverain seigneur », et s’opposer à sa « royale majesté » constitue un crime de trahison, non seulement envers lui, mais aussi et peut-être surtout envers le royaume, la Couronne de France et la chose publique – ce que nous appelons aujourd’hui l’État, au sens le plus complet du terme, à savoir un gouvernement, un peuple et un territoire.
A écouter également :
Podcast – La souveraineté dans la guerre économique. Pierre-Marie de Berny
Quelle est la place de l’Église dans la conception du pouvoir royal et de l’État au Moyen-Âge ?
Naturellement, dans un monde chrétien, la souveraineté pleine et entière n’appartient qu’à Dieu ; celle des hommes ne peut être que relative. Se posent alors deux problèmes, celui de la distinction entre pouvoirs temporel et spirituel, et surtout celui des rapports entre les prêtres et les rois. Si ce qu’il est convenu d’appeler la « Réforme grégorienne » a résolu le premier au tournant du XIe et du XIIe siècle, le second sera l’objet d’une lutte féroce pendant très longtemps. Pour le pape, le prince – en l’occurrence d’abord l’empereur, qui aspire à la domination universelle sur le monde chrétien – n’existe qu’en temps qu’auxiliaire et serviteur, dont le rôle se définit en creux : il est là pour combattre l’injustice et les fauteurs de trouble et assurer la paix, à l’intérieur comme à l’extérieur. Le triomphe d’Aristote à l’Université, au cours de la seconde moitié du XIIIe siècle, conduit à redéfinir la mission du souverain, qui doit désormais agir en vue de l’utilité publique, du « commun profit » de ses sujets. Ce bien commun est indissociable du projet chrétien : il consiste à faire en sorte que la communauté, vivant en harmonie, puisse préparer son salut, adorer Dieu et contempler Ses œuvres. Dès lors commence un processus, non de laïcisation, mais de sécularisation (J.-M. Carbasse), c’est-à-dire que le pouvoir temporel usurpe massivement les attributs et les fonctions du pouvoir spirituel, pour mieux s’affirmer face à ce dernier. C’est ainsi que l’empereur, puis les rois d’Occident, se mettent à pourchasser et punir le blasphème, l’hérésie, puis la sorcellerie. C’est ainsi que l’empereur, puis le roi de France, prétendent réformer l’Église et la protéger contre les papes indignes ou incapables.
Comment se pense la souveraineté française entre la souveraineté politique voulue par l’Empire et la souveraineté religieuse défendue par le pape ?
On aurait pu en effet penser que le roi de France aurait eu bien du mal à se situer, par rapport au pape comme par rapport au roi de Germanie et d’Italie, qui avait relevé le titre d’Imperator augustus en 962. Au premier le glaive spirituel, au second le glaive temporel, auquel devaient être soumis les autres rois chrétiens. Et pourtant, les Capétiens s’émancipent de l’un comme de l’autre avec une étonnante facilité, et cela en raison même de la concurrence entre les deux pouvoirs, le conflit entre le pape et l’empereur étant la grande question qui agite et divise tous les penseurs, juristes et philosophes, du XIIe au XIVe siècle. Dès 1202, dans la décrétale Per venerabilem, le pape Innocent III fait valoir que le roi de France ne reconnaît aucun supérieur au temporel. Après l’effondrement de l’autorité impériale, qui suit la mort de l’empereur Frédéric II de Hohenstaufen en 1250, les empereurs doivent s’accommoder de la situation. Après l’empereur, le tour du roi de France viendrait-il ? Le conflit éclate, en effet, sous le règne de Philippe le Bel, mais il se dénoue très vite en faveur du Capétien. Le pape Boniface VIII menace d’excommunier le roi de France, mais les prélats français se rangent derrière Philippe le Bel, qui lance une procédure de destitution du pape et envoie un détachement armé se saisir de lui. Boniface VIII s’échappe de justesse, mais meurt peu après (c’est l’« attentat » d’Anagni, en 1303). Deux ans plus tard, un pape français est élu, qui s’installe à Avignon, sous la protection du roi. Après le Grand Schisme d’Occident (1378-1417) et malgré le retour de la papauté à Rome, le rapport de force ne changera plus guère. La Pragmatique Sanction de Bourges (1438), puis le concordat de Bologne (1516) consacrent la mainmise du roi de France sur l’Église gallicane.
A lire également :
Puissance et droit : la potestas et la souveraineté #7
Par quoi se caractérise la souveraineté du roi de France ?
Vis-à-vis de l’Église, elle se caractérise par la subordination croissante des tribunaux ecclésiastiques (les officialités) à la justice royale, et par la réduction constante de leurs compétences. Au terme de ce processus, seules les affaires de discipline, de foi et de sacrement restent de leur ressort exclusif. Les clercs eux-mêmes peuvent être poursuivis par la justice royale, notamment en matière de trahison. Très vite, l’exemption fiscale dont bénéficie l’Église est vidée de sa substance, et les décimes (un impôt de 10% sur les revenus du clergé) accordées au roi deviennent un des piliers des finances royales, avant même la généralisation de l’impôt chez les laïcs. Enfin, le roi exerce un contrôle de fait presque total sur les nominations aux bénéfices majeurs (évêchés, grandes abbayes), même s’il revient toujours au pape de les confirmer.
Vis-à-vis de ses vassaux laïcs, et en premier lieu les princes territoriaux, c’est également en matière judiciaire que le roi donne à sa souveraineté ses premières applications concrètes. Dès le XIIIe siècle, il est possible de faire appel d’une sentence d’une justice seigneuriale auprès de la justice royale, seule habilité à rendre des arrêts en dernier ressort. De plus, le roi se réserve certaines affaires en raison de leur nature (hérésie, fausse-monnaie, criminalité de grand chemin, infraction aux ordonnances royales, etc.), et multiplie les privilèges permettant à des communautés religieuses, des villes, ou certaines catégories de personnes (officiers, membres de l’hôtel du roi, etc.) de se soustraire aux justices seigneuriales. L’interventionnisme croissant des juges royaux est contesté de plus en plus violemment, non seulement par les barons et les grands seigneurs, mais aussi par de nombreux justiciables, qui trouvent la justice royale excessivement coûteuse, technique et lointaine – sauf lorsqu’ils peuvent en profiter pour faire appel d’un jugement défavorable ou faire traîner son exécution… Dès le règne de Philippe le Bel, les abus des officiers royaux sont l’un des thèmes récurrents du débat public, et il serait très réducteur de faire des opposants à l’emprise croissante de l’État royal des réactionnaires égoïstes, opposés à la marche triomphante et irrésistible d’un État moderne incarnant nécessairement le progrès et qui serait nécessairement plus souhaitable que « la féodalité ».
C’est finalement à l’intérieur du royaume que la souveraineté du roi met le plus de temps à s’imposer, et suscite le plus d’oppositions, qui dégénèrent en prises d’armes nobiliaires, voire en guerres civiles (en 1355-1358, 1407-1435, 1465). Cependant, le roi triomphe sur toute la ligne. Son autorité législative est reconnue dans toute l’étendue du royaume, et le roi s’affranchit vite de l’approbation des princes territoriaux. En matière monétaire également, l’unification est quasiment achevée dès le début du XIVe siècle. Restent l’impôt et le monopole de la violence légitime, à travers notamment l’interdiction des guerres privées, qui seront beaucoup plus longs à faire accepter ; ce sera l’œuvre des Valois pendant la guerre de Cent Ans.
On pense souvent à la bataille de Bouvines comme fondatrice de la souveraineté française, qu’en pensez-vous ?
La bataille de Bouvines, remportée par Philippe Auguste en 1214 sur une coalition réunissant Allemands, Flamands et Anglais, a fait aussitôt l’objet d’un récit officiel brillamment exploité par les historiographes du roi. Cependant, elle n’a fait que conforter la victoire du roi sur son adversaire Jean sans Terre, roi d’Angleterre, duc de Normandie et de Guyenne, comte d’Anjou, du Maine et de Touraine, qui a été absolument décisive pour la restauration de l’autorité royale. La confiscation des fiefs continentaux du roi d’Angleterre, prononcée en 1202, s’est traduite par le quadruplement du domaine royal, constitué par les terres qui relèvent directement de lui, sans médiation des princes territoriaux. Dès lors, le roi de France devient, et de loin, le seigneur le plus puissant, le plus riche, capable de mobiliser le plus grand nombre de chevaliers dans son propre royaume, mais aussi probablement en Occident. Sans le magistral coup de poker de Philippe Auguste, les juristes du roi auraient pu continuer de bêler avec conviction leurs belles maximes tirées du droit romain – « le prince est au-dessus des lois », « ce qui plaît au prince a force de loi » – le royaume de France aurait peut-être connu une évolution à l’allemande (fractionnement territorial et constitution d’entités politiques autonomes) ou à l’anglaise (affirmation de contre-pouvoirs institutionnalisés dans le cadre d’assemblées représentatives telles que le Parlement anglais). C’est donc bien la formidable accumulation des moyens matériels de la puissance réussie par Philippe Auguste qui a permis la mise en œuvre du projet politique capétien, qui du reste n’avait rien de spécifiquement capétien, puisque tous les monarques d’Europe poursuivaient le même objectif.
Est-ce seulement par les guerres que s’affirment les États ? Sinon, quelles sont les stratégies pour asseoir sa puissance par rapport aux autres États ?
La guerre est bien la matrice de l’État moderne, car c’est son coût qui déstabilise les monarchies féodales, notamment dans la seconde moitié du XIIIe siècle, lorsque disparaît le service féodal gratuit, et qu’il faut solder les gens de guerre. A contrario, le coût de l’administration civile et judiciaire ou même de la Cour du prince apparaît comme tout à fait dérisoire. La question fiscale est au cœur des rapports entre gouvernants et gouvernés, et détermine la nature des régimes monarchiques. La guerre de Cent Ans permet au roi de France de confisquer aux assemblées d’états (États généraux et locaux, qui réunissaient les nobles, les bourgeois des bonnes villes et les prélats) le droit de consentir l’impôt. Les Valois peuvent en effet légitimement invoquer l’état d’urgence qui découle de l’invasion anglaise et du chaos généralisé pour asseoir l’impôt d’autorité. C’est alors que la France prend un chemin qui lui est propre, et qui la distingue des autres États européens, à l’exception peut-être de la Castille. Cependant, les guerres peuvent être perdues, ou s’enliser, et alors, gare aux soulèvements ! Les défaites des Plantagenêts sur le Continent sont à l’origine du contrôle des barons et du Parlement sur l’action du roi. Plus rarement, un État peut également s’imposer par son rayonnement culturel, telle la Bourgogne des ducs Valois (1363-1477), mais le prestige de leur Cour est d’abord la conséquence de leur expansion territoriale, fruit d’une politique avisée, associant mariages, guerres, et détournement de la fiscalité royale. On songe également à la réussite économique des républiques maritimes et marchandes italiennes, Gênes et Venise en tête, mais leurs réseaux de comptoirs et de colonies doivent tout à l’usage de la force. Et c’est finalement la guerre, en Italie et contre les Turcs, qui ruine la prospérité de Venise au XVIe siècle. Il faut attendre la Révolution industrielle pour que la puissance militaire soit subordonnée et proportionnée à la puissance économique des États.
A lire également :
La souveraineté nucléaire française : un statut figé ?