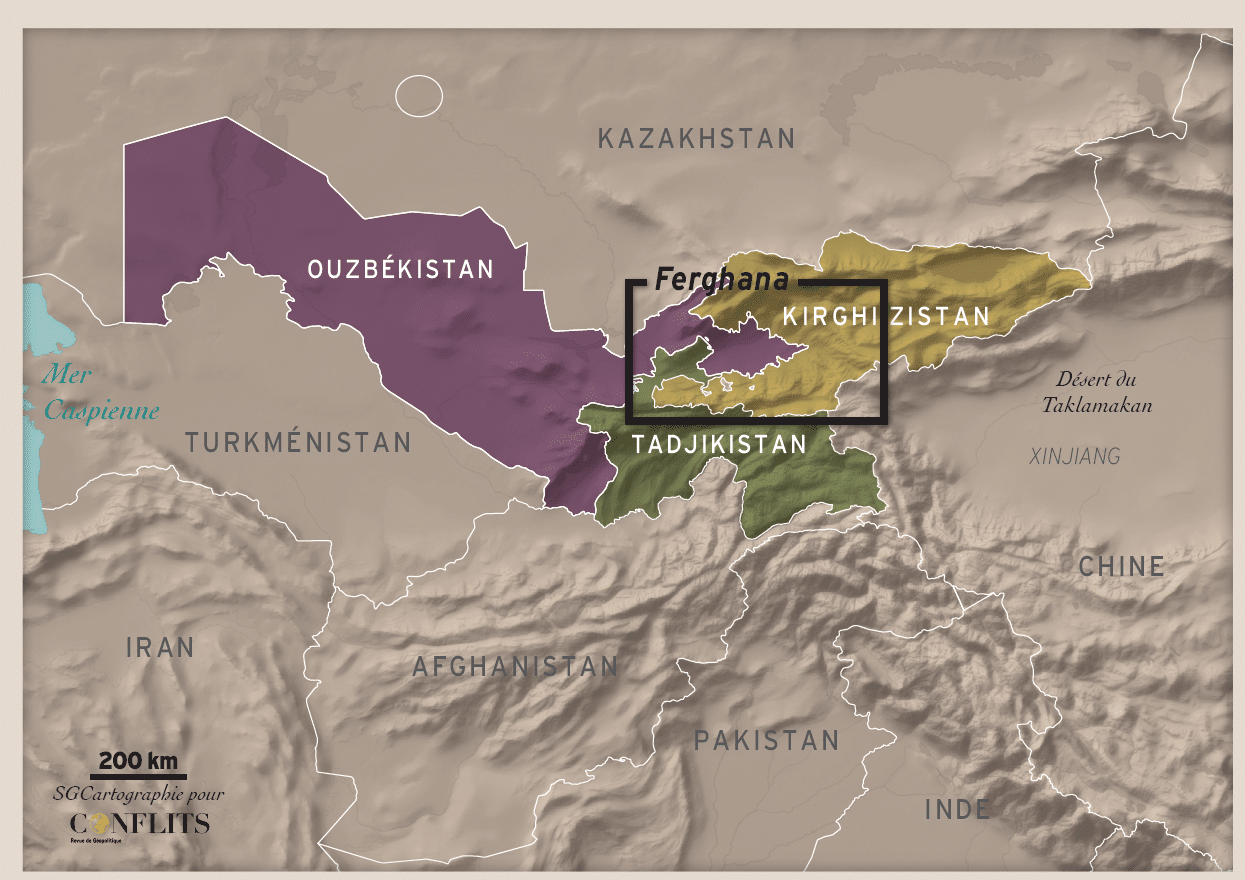Capitale du Kazakhstan depuis 1998, Astana fut le lieu, en 2017, d’un traité signé par la Russie, l’Iran et la Turquie au sujet de la Syrie. Ce traité, puis ce processus d’Astana, a placé le Kazakhstan au centre des questions diplomatiques du Moyen-Orient.
À l’origine : un traité
À l’origine du processus, il y a l’accord d’Astana. Signé le 4 mai 2017 par la Russie, la Turquie et l’Iran, il concernait la guerre civile syrienne dans laquelle ils étaient tous trois acteurs et présents au Kazakhstan en tant que pays garants (ou parrains) du processus de pacification. L’objectif de ce traité était ainsi de créer quatre zones de cessez-le-feu à Idleb, dans certaines zones d’Alep, de Hama et de Lattaquié, dans des régions du nord de Homs, dans la Ghouta orientale et enfin certaines régions du sud (Deraa et Kuneitra). Cet accord ne fut reconnu que par ces trois nations, le gouvernement syrien et l’opposition n’ayant pas ratifié le texte. De cet accord d’Astana provient le processus d’Astana, qui désigne les rencontres organisées de manière multipartite entre les différents acteurs de la guerre civile syrienne, dans le but d’y rétablir la paix et la sécurité.
Une alternative à l’ONU
Moscou et Ankara ont initialement signé un contrat bilatéral, voulant contourner l’ONU afin de passer outre les Européens et les Américains. Cette volonté d’indépendance n’aboutit pas puisqu’ils furent contraints de mener les négociations d’Astana sous l’égide de l’Organisation. À la différence des accords de Genève, qui reposent davantage sur les questions politiques et démocratiques, le processus d’Astana s’intéresse aux questions d’ordre militaires et stratégiques. Des sujets complexes qui ont été refusés par les opposants de Bachar al-Assad, estimant que les trois pays garants étaient du côté du gouvernement syrien. Un point qui semble d’autant plus important aujourd’hui car le Moyen-Orient ne semblait pas être la priorité de Joe Biden, même si ses visites en Israël et en Arabie saoudite montrent qu’il ne veut pas le quitter totalement non plus.
Les rencontres s’enchaînent en parallèle de celles de Genève et la Russie cherche à s’imposer comme la principale puissance de la région, au-delà du simple cadre syrien, créant des tensions entre le Kremlin et Damas mis sous pression. De nombreuses difficultés entravent le bon fonctionnement du processus à l’image de l’opposition qui boycotte certaines rencontres, comme celle de Sotchi (où deux des 18 réunions se sont tenues) sur l’avenir de la Syrie en 2018, car elle ne reconnaît pas de légitimité à ce processus.
Faisant partie du processus, l’accord de Sotchi a par exemple permis de « ménager les intérêts turcs, en préservant la zone de désescalade et en autorisant Ankara à y renforcer sa présence militaire pour neutraliser le risque d’une offensive syrienne » (discours de Jean-Yves Le Drian, Assemblée nationale, 4 mars 2020).
Et cinq ans après ?
Les 15 et 16 juin 2022 s’est déroulée la 18e réunion du processus d’Astana. Selon le communiqué de presse des affaires étrangères turques, « les parties ont souligné leur ferme engagement en faveur de l’unité politique et de l’intégrité territoriale de la Syrie et le rôle prépondérant du processus d’Astana dans le règlement pacifique de la question syrienne ». Parmi les principaux enjeux se trouvait la lutte contre le groupe terroriste PKK/YPG, la protection de leurs frontières et l’avenir des civils syriens. Le processus a mis en place en parallèle un groupe de travail qui se concentre sur la libération des prisonniers, le retour des corps et l’identification des disparus. Ce groupe se réunit la plupart du temps en marge de la rencontre principale.
Le conflit russo-ukrainien modifie quelque peu le paysage. La Russie semble chercher à maîtriser ses missions sur le territoire avec peut-être une arrière-pensée de repli pour renforcer le front ukrainien, tout en s’assurant que l’Iran et la Turquie continueront de tenir le coup.