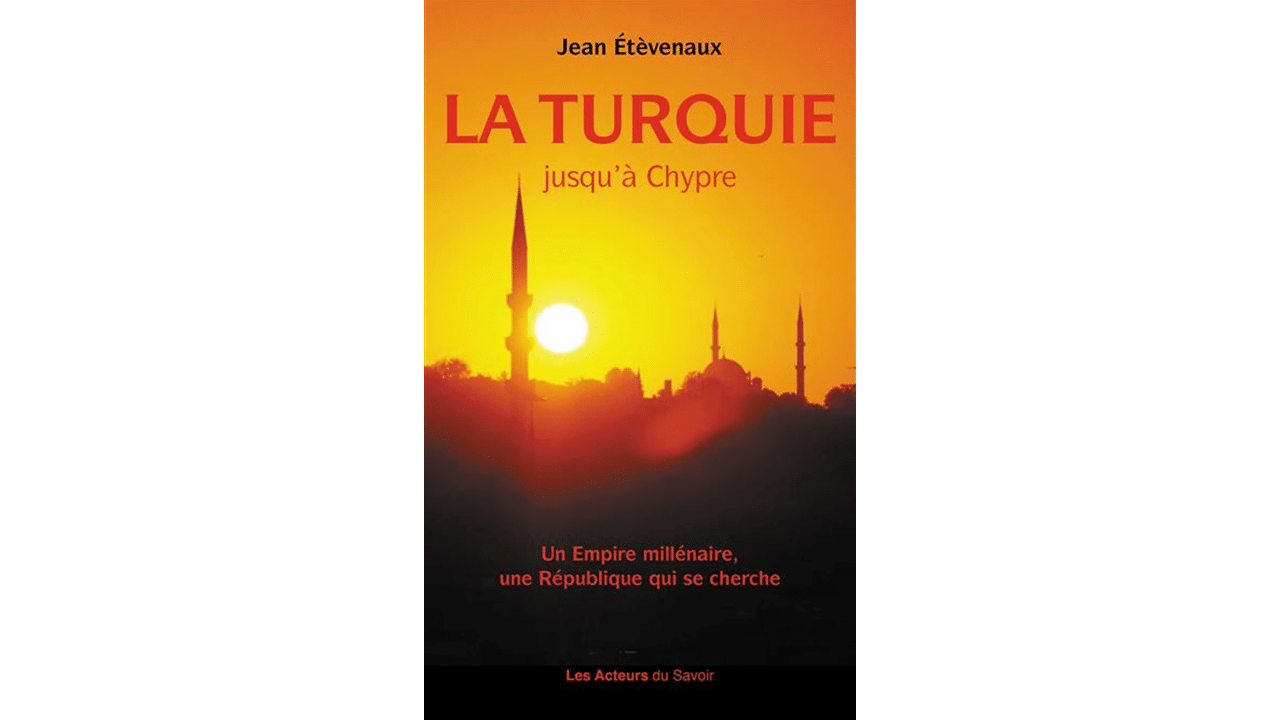La bataille de Munda est la dernière d’une trilogie qui permit à Caius Julius[1] de venir à bout du parti pompéien. Après avoir triomphé à Pharsale en 48, provoquant la fuite de Pompée vers l’Égypte où il périt assassiné, puis repris l’Afrique du Nord par sa victoire de Thapsus (46), César écrase la dernière armée pompéienne en Hispanie, ultime refuge habituel des dissidents vaincus.
Ainsi semblait réglé un conflit aussi vieux que la République romaine, qui avait pris un tour plus nettement belliqueux dans le dernier siècle avant notre ère, qui s’acheva par la disparition de la République et le passage au principat. Ce conflit concernait la place accordée au peuple – la plèbe – dans la direction des affaires, ouvrant sur deux conceptions divergentes de la démocratie : l’une la limitant à une oligarchie des classes sociales dominantes, l’autre se voulant à l’écoute du peuple.
Querelle d’aristocrates
Mais ne nous y trompons pas : sauf exception, il s’agit d’une querelle entre aristocrates, car même ceux prétendant parler et agir au nom du peuple sont membres de l’ordre sénatorial ou, au moins, chevaleresque, donc sont des « riches » qui ont accès au cursus honorum, le parcours des hautes fonctions de l’administration, de l’armée et du gouvernement. Le parti qui défend les prérogatives du Sénat, expression suprême de la classe dirigeante, s’appelle Optimates, les meilleurs, les plus dignes – traduction littérale du grec « aristocrates » ; tandis que leurs adversaires se nomment, logiquement, Populares.
La rivalité a dégénéré une première fois en conflit ouvert au début du ier siècle avant notre ère, après que Caius Marius (-157 / -86), chef du parti populaire, se fut saisi du pouvoir pendant l’absence du proconsul Sylla (Lucius Cornelius Sulla, -138 / -78) ; la décennie 88-77 connaît deux guerres civiles, remportées par Sylla, et une première révolte de l’Hispanie, alors bastion des Populares, soumise par le jeune proconsul Pompée, qui y gagne son surnom de « Grand » (Cnaeus Pompeius Magnus, -106 / -48). Après une longue accalmie, troublée par la troisième guerre servile contre Spartacus (-73 à -71), qui réconcilie les deux camps, la guerre reprend le 10 janvier 49, lorsque César franchit le Rubicon à la tête d’une légion. Ce petit fleuve côtier (35 km de long), à la limite sud de la plaine du Pô, marquait la frontière entre l’Italie romaine et la Gaule cisalpine, et les généraux romains avaient interdiction de le franchir avec des troupes pour protéger Rome d’un coup de force.
Le prétexte invoqué par César était de secourir Marc Antoine, alors tribun de la plèbe, qui venait d’être chassé du Sénat, avec d’autres Populares. Les tribuns de la plèbe, au nombre de dix par an, avaient été institués au tout début du ve siècle, juste après l’abolition de la monarchie ; ils incarnaient un contre-pouvoir à l’oligarchie sénatoriale, car un tribun pouvait s’opposer à certaines décisions des consuls, au nom de la protection du peuple. C’était une des rares fonctions restées pleinement électives, au sein d’assemblées réservées au peuple : les comices tributes plébéiennes. Le tribunat joua dans l’histoire romaine un rôle d’ascenseur social et d’intégrateur des populations italiennes : ce fut ainsi le cas pour Caius Marius, qui exerça cette charge au début de sa carrière, en 119. Mais le Sénat redoutait la pression démagogique que pouvaient exercer ses titulaires les plus brillants, car la seule limite au pouvoir des tribuns, compte tenu de leur caractère inviolable et sacré, était le territoire de l’Urbs, la ville de Rome elle-même.
Au-delà du prétexte, le conflit était aussi structurel. Avec l’extension des conquêtes – César mène à bien celle des Gaules entre 58 et 52 –, l’armée s’était étoffée et son recrutement élargi. Marius avait ouvert les légions aux volontaires plébéiens, qui s’étaient professionnalisés, stationnant longtemps dans les territoires conquis. Les légionnaires s’attachaient à leurs généraux en chef victorieux – c’est le sens initial du mot imperator, qui donnera en français « empereur » – dont ils soutenaient la carrière politique en espérant en tirer profit grâce au butin et aux attributions éventuelles de terres pour s’établir dans les nouvelles provinces. En théorie, la fin des opérations militaires devait entraîner le renvoi des soldats, mais les généraux ambitieux n’étaient pas prêts à renoncer à ce formidable instrument de popularité et moyen de pression sur le Sénat, surtout sans garantie que leurs adversaires feraient de même.
À lire également
Rome face aux invasions barbares
La guerre des clones
César a-t-il dit, en franchissant le Rubicon, alea jacta est (le sort en est jeté), comme le rapportent Plutarque et Suétone, qui écrivent plus d’un siècle après sa mort ? Si tel est le cas, le sort lui fut favorable : il entre dans Rome, que Pompée et ses plus ardents partisans ont évacuée, et rallie les indécis en évitant la répression brutale des guerres civiles précédentes ; par son talent militaire et le dévouement de ses soldats, il triomphe de Pompée dès 48 en Macédoine, puis de ses lieutenants les plus fidèles à Thapsus le 6 avril 46. Mais au moment même où il anéantissait les forces de Caton d’Utique et de Metellus Scipion, une révolte éclatait en Espagne autour des deux fils de Pompée, Cnaeus et Sextus Pompeius, âgés respectivement de 29 et 22 ans. Ces derniers ont réussi à rassembler une armée de 13 légions, mais de qualité inégale : autour de deux légions de vétérans, dont des survivants de Thapsus, une troisième est constituée de Romains vivant en Espagne et le reste, d’habitants de l’Hispanie ultérieure – à peu près l’Andalousie actuelle. À cela s’ajoutent, comme dans toute armée romaine, les troupes légères et auxiliaires et les cavaliers, évalués à 6 000 hommes chacun.
César a déjà des troupes sur place, mais leur infériorité numérique incite leurs chefs à occuper des points d’appui autour de leur camp principal, près d’Obulco[2], en attendant les renforts et César en personne. Ce dernier arrive en décembre 46 avec au moins quatre légions dont deux de vétérans, et commence une guerre de positions, dégageant des cités assiégées, prenant une ville rebelle mais échouant devant Cordoue. En mars, le moral des Pompéiens faiblit et leurs alliés locaux montrent des signes d’hésitation, incitant les fils de Pompée à rechercher une bataille « décisive ».
Les deux armées qui se font face le 17 mars 45 dans les plaines de Munda, autour de la ville actuelle d’Osuna, se ressemblent comme des jumelles. Leur colonne vertébrale est bien sûr constituée de l’infanterie lourde des légions : 13 pompéiennes, 8 césariennes. Au cours du dernier siècle[3], l’équipement des légionnaires s’est uniformisé, car il est désormais fourni par l’État ou par les chefs militaires eux-mêmes : si la cotte de mailles est encore trop chère pour être généralisée, tous les soldats ont au moins un plastron de protection et un grand bouclier ovale et disposent du fameux pilum, ce javelot lourd qui se rompt à l’impact et permet au légionnaire d’obliger l’ennemi à baisser son bouclier en appuyant sur la hampe qui traîne à terre. L’effectif théorique est de l’ordre de 6 400 hommes, répartis en dix cohortes, ce qui donnerait un peu plus de 80 000 combattants pour les Optimates et 50 000 pour les Populares – mais les effectifs maximaux ne sont sûrement pas atteints. Les Pompéiens ont aussi l’avantage du terrain puisqu’ils sont installés sur une colline, et leurs vétérans sont décidés à se battre jusqu’au bout, car beaucoup s’étaient précédemment ralliés à César et peuvent donc craindre sa vengeance en cas de défaite.
César ne peut compter que sur une supériorité numérique en cavalerie (8 000 hommes), arme rarement décisive dans les combats antiques, car l’absence d’étriers rend les cavaliers inaptes au choc. Comme toute rencontre entre deux armées aussi semblables, le combat fut acharné, et se décida par un coup du sort et la qualité des hommes : ayant échoué dans un premier temps à attirer les Pompéiens au pied de leur colline, César attaque leur aile gauche avec une légion d’élite, la Xe Equestris (« équestre »), qui réussit à progresser ; pour conjurer la menace, Cnaeus Pompeius prélève des troupes de son aile droite, mais donne alors l’occasion à la cavalerie maurétanienne de César de tourner sa droite et de prendre à revers l’armée des Optimates. La cavalerie pompéienne, dirigée par le légat Titus Labienus, manœuvre alors pour s’opposer à ce mouvement tournant, mais son action est interprétée par les légions du centre comme une fuite : le moral cède, entraînant la débandade des Pompéiens. Comme souvent, la défaite et la fuite provoquent un massacre et un bilan totalement déséquilibré : les sources évoquent 30 000 morts chez les vaincus, soit 30 à 50 % de l’effectif de départ, contre à peine 1 000 pour César. Symbole de cette lutte fratricide : la plus illustre victime chez les Optimates est Labienus, ancien lieutenant de César durant la guerre des Gaules. Les fils de Pompée se sont échappés, mais Cnaeus est capturé et exécuté le 12 avril, tandis que son plus jeune frère s’impliquera dans les combats des triumvirats jusqu’à son assassinat, en 35.
Les ides de mars
Si elle consacre la victoire des Populares, la bataille de Munda ne clôt pas le cycle des guerres civiles. Dans un premier temps, le vainqueur obtient du Sénat tout ce qu’il veut : un nouveau triomphe en octobre – le 3e en un peu plus d’un an ! –, la fonction de dictateur à vie, la puissance tribunicienne, bien qu’il ne soit pas officiellement élu tribun, la transmission héréditaire du titre d’imperator et le droit d’en porter en permanence les emblèmes – couronne de laurier et toge pourpre –, de remplacer par son gentilice le nom du 5e mois de l’année, qui devient ainsi le mois de juillet, à l’occasion de sa réforme du calendrier… Les conquêtes consolidées à la faveur des campagnes (Gaules, Numidie, protectorat sur l’Égypte) assurent l’approvisionnement alimentaire de la population de Rome et ont fourni un butin colossal, permettant toutes sortes de largesses pour la plèbe et les vétérans. César s’est aussi montré magnanime pour les anciens Pompéiens qui ont sollicité son pardon.
La surenchère d’hommages des sénateurs peut laisser perplexe : est-elle pure flagornerie, une forme de dénonciation ironique, ou même une tactique machiavélique pour le discréditer par ces outrances ? Car tant de pouvoirs réunis en une seule personne ne vont pas sans abus : célébrer un triomphe pour une victoire sur des armées romaines et non étrangères crée un précédent scabreux, comme en faire accorder à deux de ses lieutenants ; la dictature à vie, le port de la pourpre alimentent le soupçon d’aspiration à la monarchie, crime majeur dans la culture politique romaine. Ce n’est pas un hasard si les ennemis de César enrôlent dans leur complot Marcus Junius Brutus[4], qui se targue d’être le descendant du Lucius Junius Brutus qui chassa Tarquin le Superbe à la fin du vie siècle, abolissant la monarchie. Le jour des ides de mars 44 (15 mars), un an presque jour pour jour après la victoire de Munda qui asseyait son pouvoir, César meurt assassiné au Sénat. Son rêve de monarchie, s’il l’a jamais eu, ne sera atteint que par son neveu, et vrai fils adoptif, Octave, qui aura toutefois l’habileté de laisser au Sénat l’apparence d’un pouvoir en instaurant le principat en 27, après avoir écarté les derniers républicains et même d’anciens proches de son oncle, comme Marc Antoine et Cléopâtre VII, reine d’Égypte.
À lire également
La pensée stratégique de César
[1] Par un abus d’usage, le français le baptise Jules César, faisant un prénom du gentilice « Julius », qui se réfère à la gens Julii, une très ancienne famille romaine, et du surnom (cognomen) « César » le nom propre du personnage. Notre Caius Julius Caesar est le 4e à porter cette combinaison de tria nomina (les trois noms du citoyen romain) et le 16e à utiliser ce cognomen, devenu emblématique de sa lignée apparemment depuis les guerres puniques, avant d’entrer dans la titulature impériale sous le principat.
[2] Aujourd’hui Porcuna, entre Jaén et Cordoue.
[3] Cette transformation a longtemps été appelée « réforme marienne », mais les historiens sont aujourd’hui convaincus qu’elle s’est imposée progressivement, plutôt que par une décision unique de Caius Marius.
[4] Contrairement à une croyance fermement établie en France, ce Brutus n’a jamais été le fils, naturel ou adoptif, de César, qui l’appréciait cependant beaucoup.