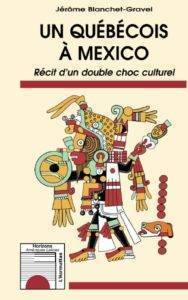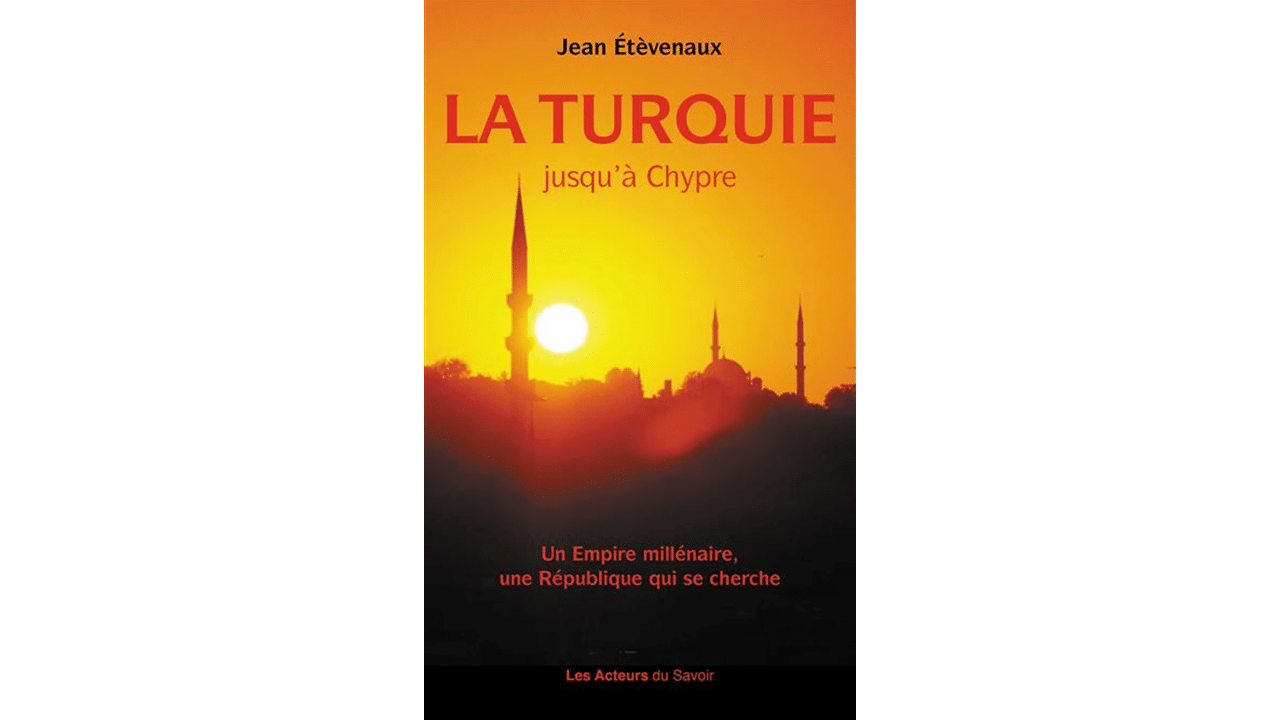Dans son nouvel ouvrage, l’essayiste et journaliste Jérôme Blanchet-Gravel brosse un portrait décapant de la société mexicaine et par effet de contraste, d’un Occident de plus en plus aseptisé. Pour Conflits, l’hispaniste Nicolas Klein s’est entretenu avec lui.
Nicolas Klein Votre ouvrage Un Québécois à Mexico nous donne l’occasion de réfléchir aux grandes différences entre pays, cultures et civilisations à travers l’exemple du Québec et du Mexique. Si vous ne deviez retenir qu’une seule différence majeure entre votre terre natale et celle de votre épouse, laquelle choisiriez-vous et pourquoi?
Jérôme Blanchet-Gravel Il en va de tout le rapport à la vie, et par le fait même, de tout le rapport à la mort. Ce sont bien sûr des réalités complémentaires. La première grande différence, c’est donc d’abord comment est envisagée la vie elle-même au Mexique et plus largement en Amérique latine. Je pense que la première question à laquelle j’ai essayé de répondre dans ce livre est la suivante : pourquoi la culture mexicaine m’apparaît-elle si forte, si entière, en comparaison de la mienne, la culture québécoise et plus largement occidentale? Comment une société autant marquée et hantée par la violence peut-elle être si dynamique?
C’est la sensation de me retrouver dans un monde beaucoup plus vivant que le mien qui m’a motivé à entreprendre la rédaction de ce récit. Ce livre est avant tout un plaidoyer pour la vie elle-même dans un monde qui tend plus que jamais à l’encadrer et à l’étouffer au moyen d’un appareil technocratique. Le Mexique n’est pas à l’abri des idées réglementaristes qui traversent la société occidentale, mais il s’agit d’une société à cheval entre la tradition et la modernité qui parvient à conserver un bel équilibre entre ces deux pôles.
À lire également
Nouveau Numéro : Mer de Chine, Taïwan prochaine prise ?
L’on doit à l’écrivain espagnol Federico García Lorca l’idée que l’Espagnol qui ne connaît pas l’Amérique ignore ce qu’est l’Espagne. Ne pensez-vous pas que l’inverse soit également vrai ? Est-il possible d’expliquer l’essence du Mexique en faisant table rase de la période espagnole, comme en rêvent certains?
Jérôme Blanchet-Gravel Il est consternant de voir s’étendre un peu partout en Amérique latine un courant décolonial rejetant la part espagnole de « l’ancienne Nouvelle-Espagne ». Non seulement le discours décolonial qui mène au déboulonnage de statues s’appuie sur une vision manichéenne et revancharde de l’histoire, mais il véhicule une vision erronée de l’identité mexicaine. Le nouveau courant décolonial se sert aussi du mythe du bon sauvage pour présenter l’Amérique précolombienne comme une sorte d’Éden où toutes les nations du continent vivaient en harmonie les unes avec les autres et avec la nature. On baigne ici en plein fantasme.
Comme je l’ai expliqué dans les pages de Conflits dans un article intitulé « La race cosmique », le Mexique est une société métisse au double héritage. Le Mexique a un pied en Espagne et un pied dans les Amériques. Il n’y aurait rien à comprendre à ce pays en ignorant cette donnée fondatrice. Il m’apparaît donc évident qu’une grande partie de l’âme mexicaine échappe à ceux qui préfèrent nier son caractère ibérique pour des raisons idéologiques. À l’arrivée du conquistador Hernan Cortés en 1519, le sang versé s’est mélangé. La fusion de deux peuples dont les conceptions du monde étaient aux antipodes a donné naissance au peuple mexicain. On convient que la rencontre a été brutale, mais elle n’en demeure pas moins irréversible.
Nul besoin d’ailleurs de rejeter la part espagnole du Mexique pour se montrer sensible envers la destinée amérindienne et rejeter ce « racisme sans haine » que la colonisation a engendré. Dans mon livre, je raconte quelques anecdotes illustrant la persistance d’attitudes discriminatoires envers les gens métissés ou d’origine autochtone. Comme le président Andrés Manuel López Obrador, j’estime qu’il faut revaloriser l’apport des Autochtones à la société mexicaine – apport qui est immense et indéniable –, mais contrairement à lui, je ne pense pas que ce travail doit être fait au détriment de l’héritage espagnol. Autrement dit, le Mexique ne peut pas revenir en arrière pour effacer la moitié de lui-même, qu’il s’agisse de sa moitié espagnole ou précolombienne.
De manière plutôt moqueuse, vous décrivez dans le neuvième tableau de votre ouvrage le Canada comme un pays « libidicide » en opposition à l’Amérique latine. Que voulez-vous dire exactement par là?
Ce n’est pas un cliché que de dire que l’Amérique latine est une civilisation marquée par l’exaltation des passions, y compris les passions érotiques. On y sent bien cette tension dans l’air. On y trouve un appétit pour la vie sous la forme du désir qui tend à disparaître dans les pays occidentaux, en particulier dans les pays de culture anglaise marqués par le protestantisme. Le Canada fait bien sûr partie de ces pays ultra aseptisés où la pornographie se nourrit paradoxalement de la réduction des contacts physiques et sociaux que la pandémie a accélérée. En Amérique latine, cet esprit gourmand et cette célébration du corps qu’on perçoit très bien au quotidien et dans la rue contrastent fortement avec ce qu’est devenu le Canada, pays à l’avant-garde de tous les courants puritains. Ces courants woke, sanitariste et néo-féministe visent ce que je nomme l’avènement du safe space global, c’est-à-dire cette société qui aspire à protéger ses membres de tous les dangers et périls imaginables.
Tout se passe comme si le but ultime de l’Occident était maintenant d’offrir à ses citoyens un espace à l’intérieur duquel ils seraient enfin à l’abri de tout, y compris du désir vu comme une menace à l’émancipation des femmes. Cette vision du monde est encore embryonnaire en France, mais elle s’impose déjà fortement à des endroits comme le Canada, l’Australie et plusieurs États américains. Durant la crise sanitaire, des États occidentaux ont même conseillé aux gens d’éviter les rapports sexuels, sinon d’en encadrer la pratique grâce à de nouvelles techniques prophylactiques. Il faut venir en Amérique latine pour constater à quel point ce nouvel hygiénisme social est stérile et malsain.
Vous opposez souvent, aussi bien dans votre livre que sur les réseaux sociaux, les choix faits par le Québec et le Mexique dans la lutte contre la Covid-19. Ne croyez-vous pas que lesdits choix ont été conditionnés, au sud du Río Bravo, plus par la nécessité économique que par de véritables options idéologiques ou une identité profonde?
La gestion de la crise du Covid-19 au Mexique a bien sûr été conditionnée par des facteurs économiques. Compte tenu du grand nombre de personnes vivant de l’économie informelle –je pense seulement aux vendeurs ambulants –, le gouvernement central et les États ne pouvaient tout simplement pas contraindre leurs populations à des confinements aussi stricts que ceux qui ont été imposés en Occident. Empêcher les gens de sortir de chez eux aurait équivalu à les empêcher de pouvoir se nourrir.
En revanche, comme ailleurs dans le monde, la gestion de la pandémie et la réaction de la population ont clairement aussi été influencées par des facteurs culturels. La souplesse qu’on a pu observer au Mexique durant la pandémie reflète bien le relâchement caractéristique de ce pays et la faible obéissance des Mexicains aux autorités. À Mexico, lorsque les bars et les restaurants ont été sommés de fermer plus tôt qu’à l’habitude, la direction de plusieurs d’entre eux se contentait de fermer les volets de l’établissement après l’heure fixée. En marchant le soir dans les rues, on pouvait facilement désigner au son les établissements qui ne se conformaient pas au décret de la ville. Personne ne s’en est jamais vraiment formalisé.
Sur le plan sanitaire, je précise tout de même que le Mexique n’est pas une île déserte – le port du masque dans la rue à Mexico peut étonner les visiteurs –, mais la vie en temps de pandémie tranche radicalement avec la grande intolérance au risque que manifestaient et que manifestent encore aujourd’hui les Québécois. De revenir à Mexico au plus fort de la pandémie m’a fait comprendre à quel point le Canada baignait dans un réglementairement correct à l’image de sa vision bureaucratique du monde.
Votre témoignage, qui célèbre la vie au Mexique, ne cache cependant aucun des aspects plus sombres de ce pays, notamment la violence et les trafics en tout genre. Que vous inspire la stratégie du président Andrés Manuel López Obrador face aux groupes criminels ?
Le président AMLO applique toujours sa politique du abrazos no balazos (des câlins et non des balles) qui est fort critiquée dans la presse. Il faut toutefois admettre que rien de ce qu’entreprend ce président de gauche ne semble apprécié dans les grands médias, lesquels défendent bec et ongles le libéralisme économique et social contre l’étatisme. Il s’agit en gros d’une stratégie fondée sur le laisser-faire. López Obrador pense qu’il vaut mieux acheter la paix que de provoquer une nouvelle guerre entre l’armée et les cartels.
Le Mexique n’est pas loin d’être un État failli, ce qui inquiète de plus en plus les Américains. Pour reprendre la formule de Hobbes, l’État mexicain n’a clairement pas le monopole de la violence, légitime ou non. Le rayonnement de l’État est très partiel : certaines régions du pays vivent carrément à l’ombre de lui, ce qui en fait des zones dangereuses où les citoyens se font souvent justice eux-mêmes. On pourrait parler d’une sorte de « narco-séparatisme ». Les territoires perdus de la République mexicaine. Dans ce contexte, attribuer tous les maux du pays au président comme le font plusieurs est illusoire, car son pouvoir sur situation est très limité.
Dans le cinquième tableau de votre ouvrage, intitulé « Shakira et la Reconquista », vous montrez à quel point le monde hispanophone reprend ses droits aux États-Unis d’Amérique après en avoir été chassé. Quel regard portez-vous sur l’hostilité d’une partie de l’opinion publique américaine envers l’immigration latina et la place croissante prise par la langue espagnole dans son pays ?
Que les Américains le veuillent ou non, les États-Unis vont s’hispaniser en grande partie. Il y a maintenant plus de 55 millions d’hispanophones au pays de l’Oncle Sam, c’est-à-dire plus qu’en Espagne ! Il est intéressant de constater que les États où le castillan s’impose le plus sont les anciens États mexicains, annexés par les États-Unis après la signature du traité de Guadalupe Hidalgo, en 1848. Après la guerre américano-mexicaine, c’est près de la moitié du territoire que perdit le Mexique au profit de son voisin protestant. Nous pourrions donc parler d’une sorte de douce Reconquista.
Une partie de l’électorat américain de droite est en effet plutôt hostile à ce profond changement identitaire et linguistique, mais force est aussi de constater que des Américains de sensibilité conservatrice s’accommodent déjà assez bien de cette nouvelle donne. Il faut dire qu’une partie des Latinos des États-Unis votent à droite, en particulier les Cubains et Vénézuéliens de Floride. Cette communauté fut particulièrement choquée de voir des statues de grands personnages liées à l’histoire de l’hispanité en Amérique être déboulonnés ces dernières années. Je suis peut-être optimiste, mais je pense que les États-Unis sauront tranquillement intégrer cet esprit latino qui résonne déjà un peu partout au rythme du reggaeton.
À lire également
Les cartels de la drogue au Mexique : une puissance qui défie l’Etat