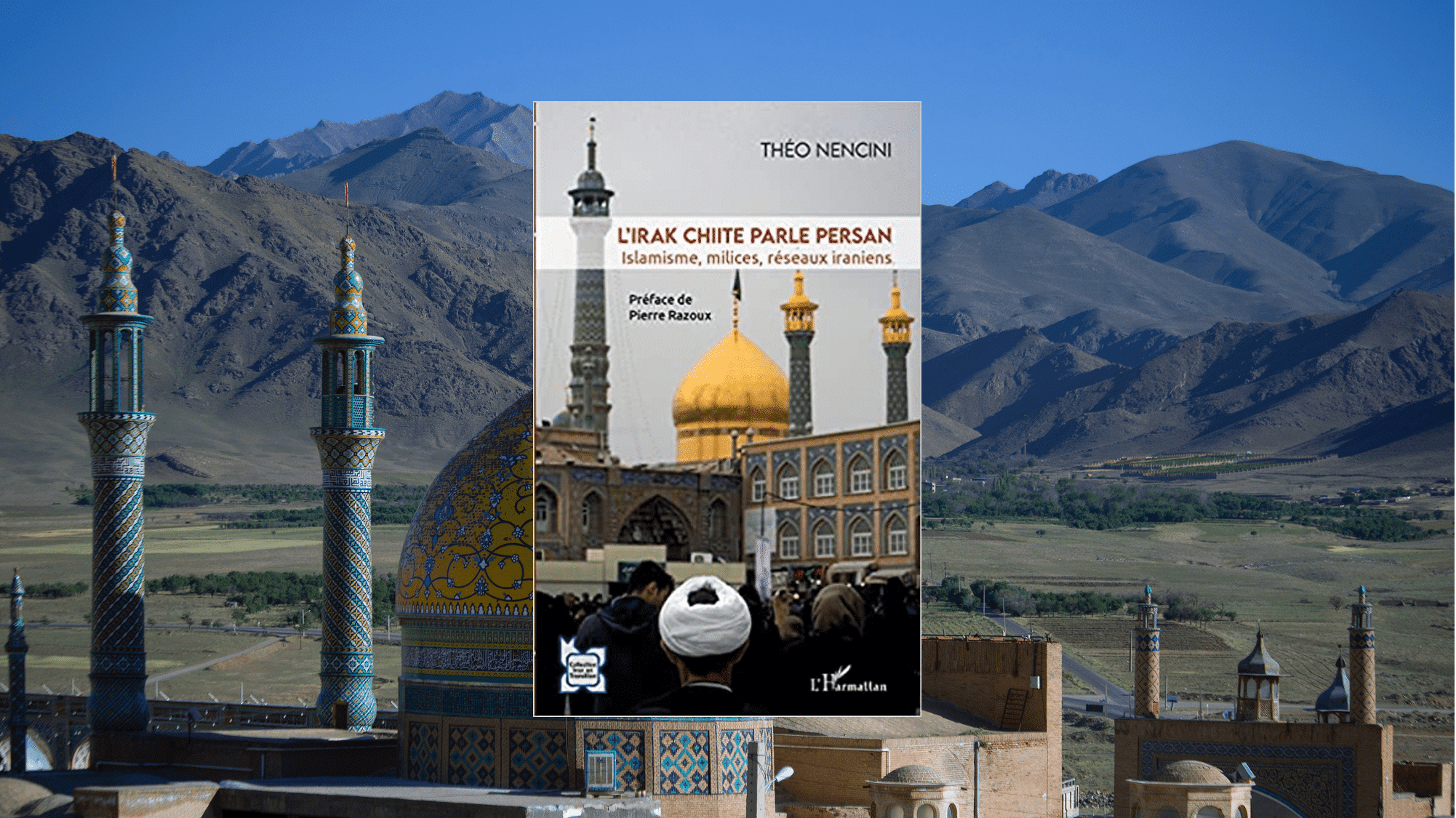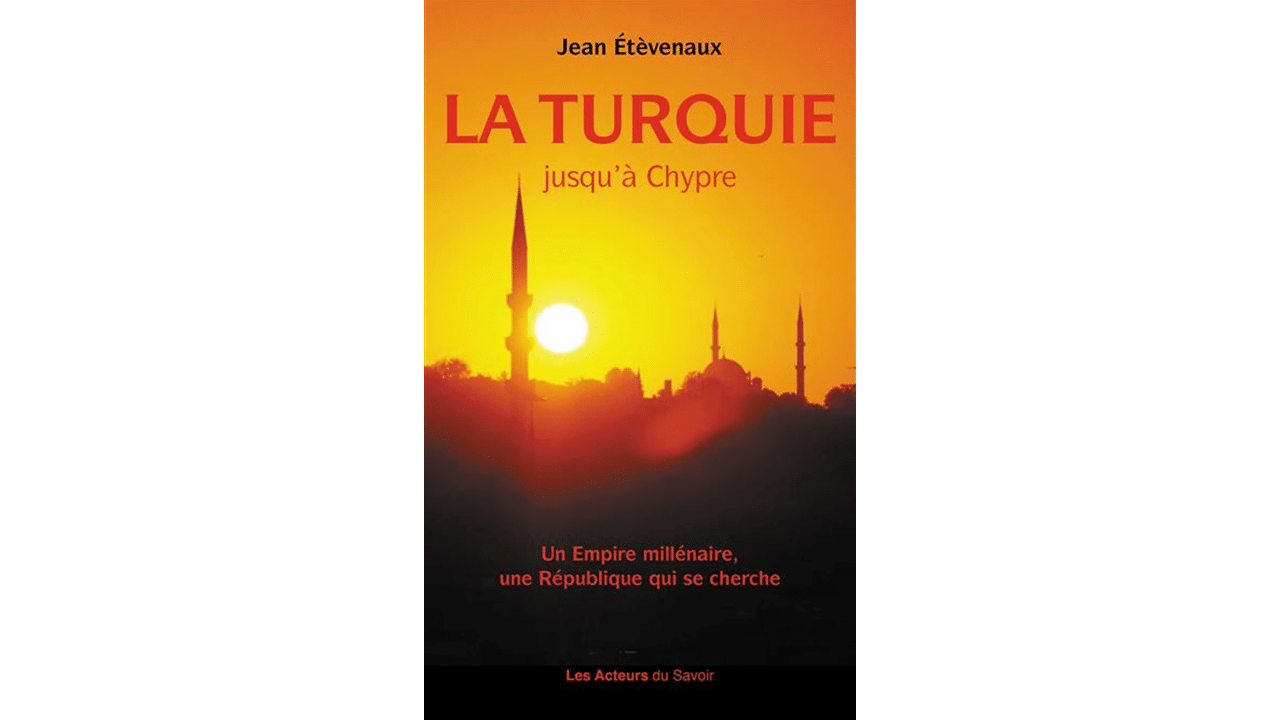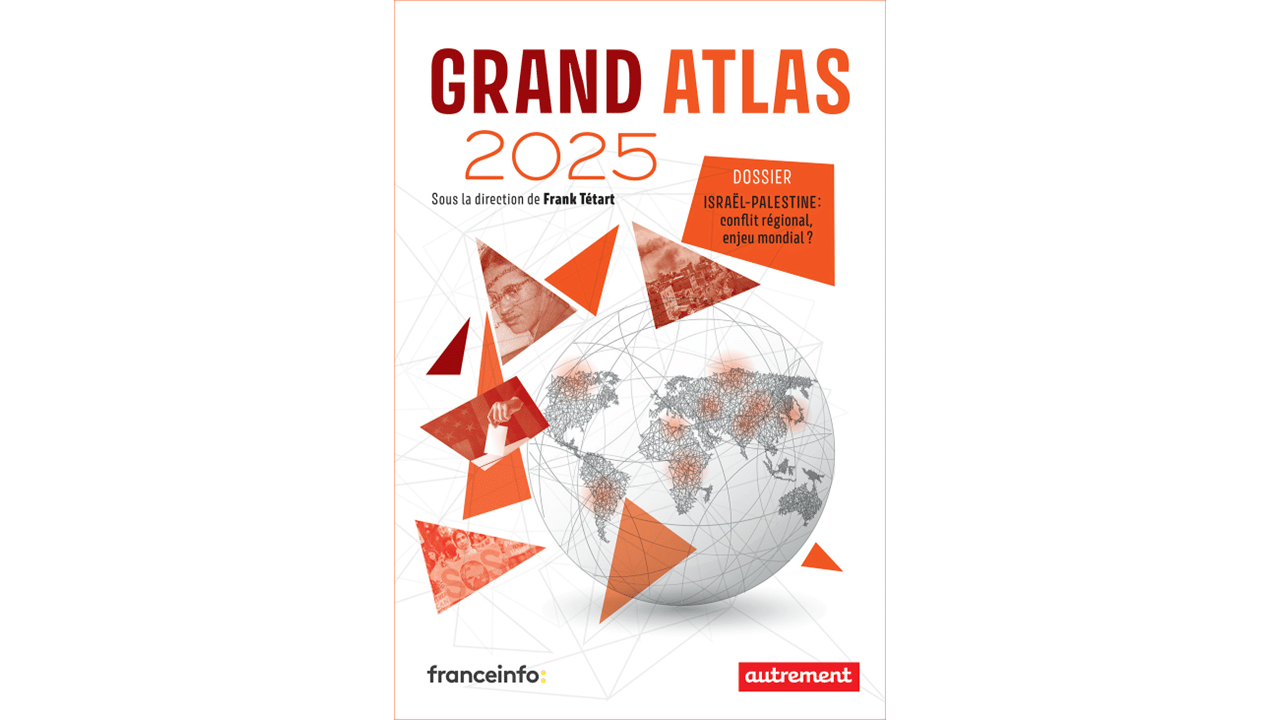Théo Nencini, diplômé de Sciences Po Grenoble, fin connaisseur de l’Iran, persanophone, a écrit cet ouvrage au retour d’un séjour académique à l’université de Téhéran. Spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires au Moyen-Orient, il a été consultant en sûreté internationale. Cette triple expérience lui a permis de se poser les bonnes questions tout en inscrivant sa recherche sur le temps long, prisme indispensable pour décrypter les évènements d’aujourd’hui.
Ce qu’il démontre bien, c’est que les rapports de force ont changé au Moyen-Orient. Les combats en Irak ont fragilisé ce pays, attisant les ambitions de ses voisins, mais aussi celles de tous ceux qui rêvent de jouer un rôle dans cette région éminemment stratégique. A cet égard, avant même la guerre de 2003, c’est la première guerre du Golfe en 1991 qui opéra la césure décisive. Avec 88 500 tonnes de bombes lâchées, l’opération Desert Storm a été une des campagnes aériennes les plus intenses de l’Histoire, faisant « seulement » 3 000 victimes civiles, proportionnellement une des moins meurtrières. Le nombre de morts par tonnes larguées en janvier-février était de 0,034, contre 40,83 sur Guernica, le 22 avril 1937 et 50,33 sur Tokyo, les 9 et 10 mars 1945[1]. Le bilan des morts reste cependant difficile à établir, aucun chiffre officiel n’a été promulgué. De vagues estimations les situent dans une fourchette très large entre 400 000 et 100 000[2]. Le conflit n’a provoqué « que » 446 morts dans les rangs alliés mais entre 30 000 à 100 000 victimes irakiennes, sans compter les 200 000 vétérans malades d’un mystérieux syndrome provoqué par les armes nouvelles. La « rue arabe, les masses arabes, n’ont pas réagi à l’unisson face à cette grave crise intervenue au sein du monde arabe et de l’oumma, ce qui a contribué » à rendre illusoire l’existence d’une unité automatique d’opinion et même l‘absence d’une opinion proprement dite. En dehors des monarchies du Golfe, acquises d’emblée à la cause koweïtie, c’est en Égypte que la « rue » a été la plus calme, alors même que Le Caire s’est engagé politiquement et militairement au côté de la coalition anti-irakienne. L’effet du rapatriement de 400 000 émigrés dans des conditions douloureuses et humiliantes a marqué les esprits. C’est en revanche au Maghreb que se sont déroulées de nombreuses et massives manifestations de soutien à l’Irak dès la réunion de la Ligue arabe, dès les 9-10 août. Les gouvernements d’Alger, de Tunis et de Tripoli se sont plus ou moins dissociés de la coalition, sans toutefois approuver l’annexion du Koweït. Seul le gouvernement marocain s’est rangé à ses côtés et a décidé d’envoyer des troupes en Arabie Saoudite. Quant au Yémen, qui venait de se réunir un an auparavant, il fut le seul gouvernement de la péninsule à avoir refusé de se joindre à la coalition. Il en fut de même pour la Jordanie.
À lire aussi : La guerre Iran-Irak, de Pierre Razoux
De ce fait, le Moyen-Orient est aujourd’hui scindé en deux grandes zones d’influence qui se chevauchent et se recoupent, engendrant des frictions et des tensions comme deux plaques qui se télescopent le long d’une ligne de fracture tectonique. Cette ligne de partage longe le détroit d’Ormuz et le golfe Arabo Persique, traverse l’Irak, longe les frontières jordano-syrienne et libano-israélienne pour rejoindre la Méditerranée orientale. La zone qui s’étend au nord de cette ligne est dominée à la fois par l’Iran et la Russie. Celle qui s’étend au sud est téléguidée par les États-Unis qui s’appuient sur Israël, l’Égypte et les monarchies sunnites de la péninsule Arabique. Chacun de ces deux camps dispose d’une enclave dans l’autre : la zone kurde au profit des États-Unis et d’Israël au Nord ; le Yémen au Sud, pour l’Iran. La Turquie néo-ottomane de Recep Tayyip Erdogan fait à cet égard figure de chevalier isolé. Elle pensait avoir quasiment de facto quitté le camp américain tout en s’y rattachant encore un peu ; mais elle a conscience qu’elle fait géographiquement et stratégiquement partie de la plaque Nord, ses voisins immédiats restant la Russie et l’Iran, tour à tour amis, alliés ou concurrents selon les lieux et les circonstances. C’est ce qui l’a poussé à rejoindre le dialogue d’Astana pour tenter d’améliorer ses relations avec Moscou et Téhéran, tout en multipliant les provocations à l’encontre des Européens, au moins jusqu’en mars de cette année. Les dirigeants russes, iraniens et turcs jouent aux échecs. Quant à la Chine, celle-ci pose patiemment ses pions sur le jeu de Go mondial qui l’oppose aux États-Unis. Elle mise partout au Moyen-Orient qui lui fournit près de 80% de ses approvisionnements pétroliers ou gaziers, investit sur le long terme, et attend de voir comment la situation évoluera dans les prochaines années. Comme l’Europe, elle a besoin d’apaiser les tensions, à défaut de résoudre les conflits, mais ses motivations sont différentes. Pour elle, cette région reste d’abord et avant tout un carrefour stratégique au croisement de ses nouvelles routes de la soie terrestres et maritimes. L’Union européenne enlisée par la gestion de la Covid-19 et son futur plan de relance économique, le Brexit et ses querelles, faute de stratégie et surtout de volonté et de capacité pour la mettre en œuvre, reste la grande absente de ce nouveau Grand Jeu régional, ce qui contraste avec la diplomatie active qu’elle avait mené les précédentes décennies.
À écouter aussi : Podcast. Où en est l’Irak aujourd’hui ? Fabrice Balanche
Quid de l’Irak ? Ce pays est en guerre quasi-permanente depuis le début des années 1970. Ses dirigeants ont affronté la population kurde pendant près de vingt ans, puis l’Iran pendant huit ans (1980-88). Ils ont combattu à deux reprises une coalition internationale conduite par les États-Unis (1991 et 2003), puis ont lutté contre l’occupant américain de 2003 à 2011, et enfin contre l’État islamique depuis 2014. Pendant cinq décennies, le territoire irakien n’a cessé d’être un terrain d’affrontement pour ses voisins iraniens, turcs et saoudiens. Même les Jordaniens sont intervenus en Irak, mais c’était pour combattre les troupes iraniennes aux côtés de l’armée de Saddam Hussein. Quant aux Israéliens, ils se sont contentés de frappes aériennes et d’action clandestines… Il n’est donc pas étonnant que les milices aient proliféré, jouant à la fois leur propre partition et celle de leurs multiples sponsors. Les États-Unis resteront-ils présents en Irak ou bien finiront-ils par se lasser et quitter militairement le pays ? C’est l’une des questions que devra trancher la nouvelle administration démocrate. Le président Joe Biden avait voté pour la guerre en Irak en 2003 et pour le surge militaire quelques années plus tard. Il ne cache son attachement au lobby des vétérans. Il apparaît tiraillé entre son cœur qui l’incite à rester, et son cerveau qui lui commande de négocier un retrait en bon ordre, peut-être pour marchander certaines concessions régionales avec un régime iranien conscient que le temps joue pour lui. C’est en Irak que les États-Unis ont fait la démonstration de leur toute puissance en 1991, avec leur Tempête du désert, imposant vingt-cinq années de domination sur la région, que l’Iran post révolutionnaire n’a pas osé contester, et c’est l’Irak qui restera – plus que l’Afghanistan – le tombeau de l’hybris américaine. Il n’est toutefois pas sûr que le régime iranien en profite. Celui-ci fait face à des défis colossaux, tant sur le plan intérieur qu’extérieur : la mise en place d’un système économique performant, la prise en compte de contraintes environnementales qui minent le pays, le rajeunissement des cadres, et la modernisation d’une gouvernance cléricale de plus en plus contestée par une majorité de la population.
En définitive, demeure la question fondamentale : la réintégration du régime des mollahs, engoncé dans ses rigidités idéologiques, stratégiques et politiques dans le concert des Nations est-elle éloignée ? On sait qu’hormis une guerre généralisée, une révolution ou un changement de régime, toutes les hypothèses sont très peu probables, l’apaisement de la région passe par un dialogue, formel ou informel, avec les États-Unis, les monarchies du Golfe et pourquoi pas avec Israël à terme, afin d’aboutir à une sorte de CSCE moyen-orientale. À tous égards, l’élection présidentielle iranienne de juin 2021 sera cruciale pour l’avenir du pays. L’Histoire rappelle que ce sont souvent les conservateurs qui parviennent à la paix car leur camp, majoritaire en Iran, peut difficilement leur reprocher de brader les intérêts de sécurité de la Nation. Mais ce délai paraît bien court pour s’attendre à d’heureuses surprises.
À lire aussi : Irak, la guerre par procuration des États-Unis
[1] Mondes en guerre, tome IV, Temps composés 2021pp.490 – 491.
[2] P. 209-210.