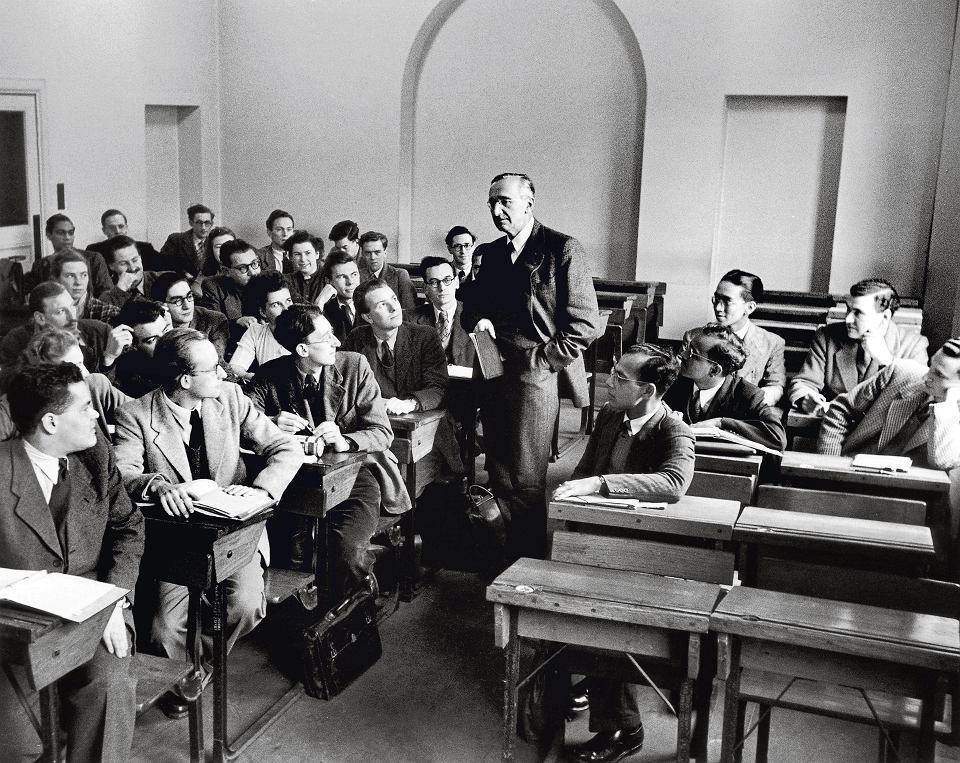Depuis le XVIIIe siècle, la galaxie d’idées regroupées sous le terme de « libéralisme » est au cœur de la politique occidentale. Les mouvements traditionalistes et socialistes du XIXe siècle peuvent être compris comme des réactions à l’influence du libéralisme en Europe. À notre époque, les débats font rage pour savoir si les aspirations à l’ordre libéral poursuivies par les administrations Démocrates et Républicaines sont responsables des malheurs actuels de l’Amérique.
Article paru sur le site Law and Liberty.
Traduction de Conflits.
Ces débats occultent souvent la vérité selon laquelle il y a toujours eu des traditions libérales concurrentes. L’une de ces écoles fait l’objet d’un nouveau livre du politologue Kenneth Dyson. Dans Conservative Liberalism, Ordo-Liberalism, and the State: Disciplining Democracy and the Market, Dyson a produit l’étude la plus complète en langue anglaise sur un groupe de penseurs européens qui ont exercé une influence considérable sur la pensée et la politique économique européennes du XXe siècle.
Le libéralisme conservateur et son corollaire en économie, l’ordo-libéralisme, ont été largement étudiés dans des publications allemandes et françaises, souvent par le biais de biographies intellectuelles comme celle de Jean Solchany, Wilhelm Röpke, l’autre Hayek : aux origines du néolibéralisme (2015). Kenneth Dyson, cependant, nous propose une analyse historique qui montre comment le libéralisme conservateur, en dépit de désaccords internes, a formé une famille intellectuelle qui reflète « une certaine cohérence interne et des contours distinctifs, tout en évoluant de manière à ne pas avoir une forme unique, définitive et finalisée. »
L’auteur s’appuie sur de nombreux livres, articles de journaux, articles d’opinion et documents politiques rédigés par des économistes et d’autres chercheurs associés au libéralisme conservateur et à l’ordo-libéralisme, tels que Wilhelm Röpke, Walter Eucken, Alexander Rüstow, Franz Böhm, Luigi Einaudi et Jacques Rueff, mais aussi par des individus moins connus comme le juriste, théologien et économiste protestant Constantin von Dietze et l’économiste libéral français et penseur social catholique Daniel Villey. Ce travail a été complété par des recherches archivistiques exhaustives de la part de Dyson, notamment la volumineuse correspondance privée de nombreux libéraux conservateurs.
S’appuyant sur ce corpus, Dyson montre que ces penseurs adhéraient à un ensemble de propositions qui, malgré des affinités avec l’école autrichienne d’économie et le libertarisme de l’école de Chicago après 1950, s’en distinguaient et les critiquaient souvent. Le libéralisme conservateur du XXe siècle s’est surtout distingué par son insistance à traiter la loi, l’État, l’économie et la société comme des ordres interdépendants. Selon eux, c’est en se concentrant sur la manière dont ces interdépendances favorisent ou sapent la liberté que l’on peut réellement agir.
Cette orientation reflète l’appartenance des libéraux conservateurs à la classe moyenne supérieure européenne de la fin du siècle, qui attachait une grande importance à l’excellence académique dans tous les domaines. Tous parlaient et lisaient plusieurs langues modernes et classiques. Dyson souligne également l’ampleur et la profondeur de leurs connaissances dans de multiples domaines. Jusqu’au début des années 1920, l’économie était généralement étudiée dans les facultés de droit de la plupart des pays d’Europe continentale.
Les ordo-libéraux étaient donc familiers avec des disciplines telles que la philosophie, la jurisprudence, l’histoire et les sciences politiques.
Cette connaissance approfondie du droit permet d’expliquer l’importance accordée par les libéraux conservateurs à l’idée d’ordre dans leurs recherches économiques. Les ordo-libéraux, souligne Dyson, étaient sceptiques quant aux théories de l’ordre spontané. Selon eux, l’attachement au « laissez-faire » avait empêché une génération libérale plus âgée de comprendre que les économies de marché devaient être protégées non seulement contre ceux qui colportaient des projets socialistes et corporatistes, mais aussi contre les entreprises qui se protégeaient de la concurrence du marché en obtenant un traitement préférentiel de la part des gouvernements, aux dépens des consommateurs et des contribuables.
A lire aussi : La géopolitique au service du néolibéralisme
La question de l’État et des institutions
Cet accent mis sur le rôle de l’État n’était pas simplement une manière de répondre aux menaces permanentes pesant sur les marchés. Selon Dyson, ces libéraux conservateurs ont été particulièrement marqués par les crises politiques et économiques qui ont englouti l’Europe après la Première Guerre mondiale et ont contribué à porter au pouvoir les partis fasciste, national-socialiste et communiste.
Le coeur des thèses avancées par les libéraux conservateurs était la nécessité d’un État fort mais limité pour 1) établir et défendre les institutions constitutionnelles et juridiques qui maintenaient un ordre de marché concurrentiel contre tous les adversaires (en particulier les capitalistes de connivence), et 2) protéger les arrangements politiques démocratiques des démagogues et des mouvements de masse. Pour ce faire, ils se sont appuyés sur une longue tradition de droit public européen qui mettait l’accent sur le rôle désintéressé de l’État pour tempérer les pressions politiques quotidiennes.
Mais les libéraux conservateurs étaient également convaincus que les meilleures institutions ne suffiraient pas à résister au comportement prédateur des socialistes, des corporatistes et du capitalisme de connivence, si ces structures n’étaient pas animées par des principes moraux qui placent certaines choses au-delà du vote majoritaire et de la tyrannie de l’immédiat. Les libéraux conservateurs ont investi autant d’énergie à essayer de persuader leur public de cet impératif qu’à réfléchir à l’économie.
Selon Dyson, de nombreux ordo-libéraux et libéraux conservateurs se sont tournés vers le droit romain, la philosophie kantienne ou la théorie du droit naturel comme sources potentielles de fondements normatifs de la liberté. Les écrits de Goethe, Lord Acton et Tocqueville étaient également des références courantes. Certains, comme Rüstow et le philosophe libéral et anti-chrétien Louis Rougier, se sont concentrés sur les sources des Lumières, humanistes et classiques.
Mais c’est la religion qui occupe une place prépondérante dans les réflexions des libéraux conservateurs sur ces questions. La plupart des libéraux conservateurs étaient d’authentiques croyants (l’un d’entre eux, Dietze, a même été président de l’Église évangélique d’Allemagne de 1955 à 1961). Ils étaient inflexibles sur la nécessité d’associer l’économie de marché aux valeurs chrétiennes – souvent au point, note Dyson, d’irriter les libéraux plus attachés à une stricte laïcité.
Dans une certaine mesure, il s’agissait d’une question de stratégie. Les libéraux conservateurs étaient suffisamment réalistes pour savoir qu’ils étaient des généraux sans armée. Par conséquent, s’ils voulaient que leurs principes économiques soient concrétisés politiquement, il leur fallait convaincre la seule alternative populaire à la gauche dans l’Europe occidentale d’après-guerre : les partis démocrates-chrétiens.
Quid de la nature humaine et de la liberté ?
Il existait cependant un hiatus entre les conceptions libérales du XIXe siècle sur la nature humaine, la raison et la liberté elle-même, et la pensée libérale conservatrice. Dans des lettres privées, Eucken et Röpke ont beaucoup écrit sur ce sujet. De nombreux libéraux conservateurs ont donc cherché à rattacher leurs principes économiques et juridiques à des traditions de pensée protestantes et catholiques particulières. Converti au catholicisme, Rueff se référait abondamment à Thomas d’Aquin pour décrire les soutiens moraux requis par ce qu’il appelait le « marché institutionnel ».
C’est là que l’idée d’ordo entre en jeu. Pour Thomas d’Aquin et d’autres scolastiques catholiques, les premiers théologiens protestants comme Philippe Melanchthon, et certains philosophes stoïciens, l’ordo était une façon de décrire des réalités fondamentales créées par Dieu et données à l’avance, que la raison humaine peut connaître et ensuite concrétiser par l’exercice de la sagesse. Le concept d’ordo soulignait également l’interdépendance des choses ; si la politique, l’économie et le droit étaient des ordres distincts dans lesquels se déroulaient différentes activités, ces ordres n’étaient pas autosuffisants. Cela signifie que ceux qui étudient, par exemple, la politique monétaire peuvent et doivent réfléchir à la manière dont elle est liée au droit, et vice-versa.
Les libéraux conservateurs ont adopté la théorie de l’ordo pour cinq raisons. Premièrement, ils pensaient qu’elle était vraie. Deuxièmement, ils savaient qu’elle était prise au sérieux dans les cercles chrétiens luthériens et réformés autour desquels gravitait l’aile protestante de la démocratie chrétienne allemande. Troisièmement, l’idée trouvait un écho chez les catholiques et ouvrait ainsi une connexion vers un groupe d’électeurs anticommunistes fiables, ayant un poids intellectuel et électoral considérable dans l’Europe d’après-guerre. Ce n’est pas un hasard si des protestants fervents comme Eucken et Böhm ont donné le titre ORDO à l’influente revue qu’ils ont fondée en 1948. Quatrièmement, ordo rappelait aux libéraux conservateurs de « penser par ordre » lorsqu’ils concevaient, par exemple, une politique fiscale, afin d’éviter de tomber dans le piège de l’économisme. Enfin, le mot lui-même véhiculait des notions de stabilité morale fondées sur des vérités universelles dans une Europe en plein désarroi culturel et éthique.
Malgré tous leurs efforts pour développer une théorie distincte, Dyson montre que les libéraux conservateurs étaient également définis par ce à quoi ils s’opposaient. En plus d’être profondément sceptiques à l’égard de la gauche, ils critiquaient ceux que Dyson nomme les « libéraux sociaux ». Des penseurs comme Keynes étaient considérés comme problématiques, en raison de leur propension à mener des politiques interventionnistes fondées sur un perpétuel court-termisme. Ils s’opposaient aussi à leur tendance à subordonner les mœurs traditionnelles à l’impératif d’épanouissement personnel, alors que les libéraux conservateurs accordaient une place centrale à l’autodiscipline, la culture de la vertu et la nécessité d’enraciner la liberté et la justice dans des principes moraux objectifs.
Les libéraux conservateurs se sont également souvent trouvés en désaccord avec les libéraux adeptes du « laissez-faire ». Face aux multiples crises qui ont frappé l’Occident, ils considéraient que ce libéralisme avait échoué, notamment par son incapacité à combattre le capitalisme de connivence.
De nombreux adeptes de l’école autrichienne et de l’école de Chicago étaient mal à l’aise face aux tendances socialement conservatrices et religieuses de la plupart des libéraux conservateurs, et se méfiaient ouvertement de la vision proactive du pouvoir de l’État de l’ordo-libéralisme. Cela a conduit à des affrontements entre Eucken et Ludwig von Mises lors de la deuxième réunion de la Société du Mont-Pèlerin en 1949, et entre Rueff et Mises lors d’un colloque à Ostende en 1957.
Ces tensions n’ont pas empêché les libéraux conservateurs de chercher à influencer directement la vie politique. Traditionnellement, les universitaires européens avaient tendance à se tenir à l’écart de la politique. Cependant, l’ampleur de la catastrophe allemande et européenne était telle que les libéraux conservateurs ont décidé qu’ils devaient être « activement et éthiquement engagés » dans la conduite de la politique économique.
Röpke et les démocrates-chrétiens
Depuis sa chaire de l’École supérieure d’études internationales de Genève, Röpke correspondait abondamment avec le chancelier allemand Konrad Adenauer et des penseurs démocrates-chrétiens comme Luigi Sturzo en Italie, qu’il poussait à adopter des positions plus favorables au marché. En France, Rueff tenta de persuader chacun des ministres qui se succédèrent à la tête des innombrables gouvernements de la Quatrième République chancelante, de la nécessité de réformer les finances du pays. Finalement, il a fourni à Charles de Gaulle le programme de libéralisation qui a sauvé la France de l’effondrement fiscal et monétaire en 1958.
Les efforts de persuasion des libéraux conservateurs impliquaient également de travailler avec des journalistes, des fonctionnaires, des banquiers centraux et des ecclésiastiques qui exerçaient une influence politique. De nombreux libéraux conservateurs ont servi de conseillers officiels et officieux auprès des gouvernements d’Allemagne de l’Ouest, d’Autriche, de France, de Belgique, d’Italie et des Pays-Bas. Certains ont occupé de hautes fonctions. Einaudi, par exemple, a été gouverneur de la Banque d’Italie, ministre des finances, vice-premier ministre et président de l’Italie. Böhm a été élu au parlement allemand, tandis que Rueff est devenu juge à la Cour européenne de justice. D’autres se sont concentrés sur l’identification d’individus partageant les mêmes idées et dont ils pensaient qu’ils feraient carrière, et ont appris à leurs protégés à faire de même. L’un des élèves d’Eucken, par exemple, était Josef Höffner, un prêtre catholique et économiste ami de l’ordo-libéralisme, qui devint plus tard cardinal-archevêque de Cologne. Parmi les élèves de Höffner, Hans Tietmeyer est celui qui a le mieux réussi. Catholique conservateur et ordo-libéral en économie, la carrière de Tietmeyer a atteint son apogée lorsqu’il a pris la tête de la puissante banque centrale allemande en 1993.
Ces stratégies supposaient que des élites relativement homogènes resteraient à la tête des gouvernements européens et pourraient réussir à maîtriser les crises économiques, si elles avaient le courage de s’en tenir aux principes fondamentaux et d’écouter les bonnes personnes. Mais à partir des années 1960, de profonds changements ont balayé l’Occident, remettant en question cette prémisse.
Sur le plan culturel, les transformations qui ont affaibli le poids politique et intellectuel des libéraux conservateurs sont notamment la diffusion des médias de masse et de la culture du vedettariat, le glissement incessant des universités vers la gauche et l’hyper-spécialisation, les révoltes étudiantes de 1968, l’autodestruction des églises chrétiennes dans certaines parties de l’Europe occidentale et l’éclipse de l’enseignement classique.
Dans les cercles économiques, la mathématisation croissante de l’économie de l’après-guerre et la concentration subséquente sur les méthodes quantitatives, l’ascension des idées néo-keynésiennes parmi les économistes et les ministères des finances européens, et l’utilisation croissante de l’hypothèse des marchés efficients par les économistes américains du marché libre se sont combinées pour marginaliser les ordo-libéraux et leur insistance sur les règles, le droit et les institutions.
Tout cela a été éclipsé par la réticence grandissante des hommes politiques européens à faire des choix économiques difficiles, alors que le soutien aux groupes politiques autrefois dominants se fragmentait et que les partis recouraient de plus en plus aux dépenses publiques pour s’assurer le soutien des électeurs.
Une tradition cohérente du libéralisme
Ce contexte ouvre la voie à l’évaluation globale que Dyson fait du libéralisme conservateur et de l’ordo-libéralisme. Selon lui, il ne fait aucun doute qu’ils constituent une tradition largement cohérente du libéralisme. Il est également incontestable qu’ils ont connu quelques succès politiques pendant deux décennies après 1945 au niveau national et européen.
Néanmoins, Dyson suggère que l’efficacité du libéralisme conservateur s’est estompée avec le temps. En l’absence d’un électorat de masse, les libéraux conservateurs ont été marginalisés lorsque les partis démocrates-chrétiens se sont orientés vers la gauche et ont commencé à perdre du soutien dans les années 1970. La vision libérale conservatrice de l’autorité et l’importance qu’elle accorde aux normes traditionnelles en tant que condition préalable indispensable à la liberté étaient également de plus en plus en contradiction avec l’esprit de libération des « baby-boomers » européens.
Dans le domaine de la politique économique, les ordo-libéraux n’ont jamais pu surmonter les pressions concurrentes des dirigistes et des partisans des positions corporatistes. S’ils ont réussi à exercer une influence significative dans des institutions clés comme la Bundesbank, les ministères allemands de l’économie et des finances et (pendant un certain temps) la Banque Centrale Européenne, les ordo-libéraux n’ont jamais réalisé de percées institutionnelles décisives et durables ailleurs. Une faible présence dans les universités et une influence déclinante dans les journaux de qualité ont également limité la capacité de l’ordo-libéralisme à construire une infrastructure et influencer le monde des idées.
Pourtant, alors que les arguments en faveur des marchés s’essoufflent dans tout l’Occident aujourd’hui, ses défenseurs feraient bien d’étudier la tradition libérale conservatrice et ordo-libérale. Comme le souligne Dyson, ceux qui s’inscrivent dans cette tradition ont refusé de succomber aux visions déterministes de l’histoire et du développement économique. De plus, en se concentrant sur la manière de soutenir les marchés à long terme, ils ont attiré l’attention sur la nécessité de discuter sérieusement des fondements éthiques requis par les économies libres, et ont refusé de détacher la raison des questions de jugement moral. Ils n’ont donc pas hésité à relier les principes et les institutions qui sous-tendent les économies de marché aux fondements civilisationnels de l’Occident. À une époque caractérisée par le populisme économique, l’oubli de l’histoire et des tendances toujours plus fortes au court terme, ces voies méritent certainement d’être explorées.
A lire aussi : Podcast. Paoli et la Corse : le libéralisme latin. Antoine-Baptiste Filippi