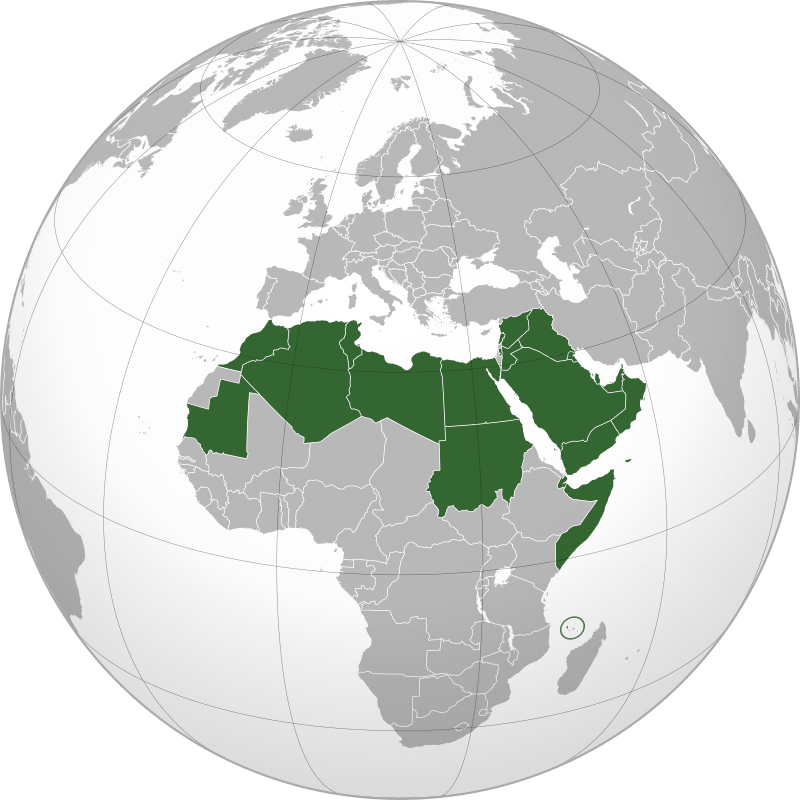[colored_box bgColor= »#f7c101″ textColor= »#222222″]Voici le témoignage complet de Christian Lefèvre sur son engagement au Biafra dont nous avons publié un extrait dans le numéro 2 de Conflits.[/colored_box]
Ce texte a une histoire. Il m’avait été confié par Yves Van Gheele qui voulait rédiger un ouvrage de souvenirs de mercenaires et qui y avait renoncé. Il m’avait donné l’ensemble de ces témoignages en me disant d’en faire ce que je voudrais, plus tard.
Yves est décédé il y a une quinzaine d’années, Christian en 2012. C’est le moment, me semble-t-il, de faire connaître ce court récit. D’abord parce qu’il éclaire les motivations des « mercenaires » des années 1960 mais aussi les conditions plus que difficiles de leurs combats. Ensuite parce qu’en contrepoint se devinent les manipulations dont ils furent l’objet – comment quitter Paris sinon et être transféré au Portugal sous la protection des autorités – avant d’être jetés dans la fournaise dotés d’armes et de moyens dérisoires. Surtout parce que ce texte, que nous avons retranscrit tel quel, est rédigé en un style parlé qui évoque Céline et parcouru d’un étonnant humour distancié.
Pascal Gauchon
Photo ci-dessus : mercenaire en partance pour le Biafra, août 1968. Crédit : BM Lyon – Auteur : Georges Vermard
Dans quelles conditions es-tu parti ?
Sans conditions. On est parti à 7, les 7 mercenaires, pratiquement tous des gars de l’OAS. C’était une époque où nous avions encore besoin de mouvement et de liberté. On est parti là-bas parce que ça se présentait et parce que c’était une cause perdue, une de plus ; d’ailleurs, les morts, les morts qu’on a eus là-bas, étaient presque tous de l’OAS, du combat pour l’Algérie française. Je suis parti par le camarade W., avec, au-dessus, le chapeautant, le commandant Le Be.. J’avais envie d’aventure, je suis parti en sortant de prison, fin 67, un peu d’air pur et de vacances… Par la suite, j’ai retrouvé des types comme Schliedermann, Ca. qui étaient déjà là-bas.

Odumegwu Emeka Ojukwu (1933 – 2011), proclame l’indépendance du Biafra en mai 1967 et en devient le chef militaire. Crédit : DR
Par l’intermédiaire de Winter j’ai rencontré Faulques à Paris qui a donné les conditions. Au point de vue fric, il faut bien en parler quand il s’agit de mercenaires, je crois que c’était 400 $ par mois pour un officier et 300 pour un sous-off. Ça n’est pas très important, ce qui l’est plus c’est ce qu’il m’a dit : « Tu vas te battre et tu vas faire une belle guerre, parce qu’il y aura du matériel, tu seras à un niveau de commandement que tu n’as jamais eu, tu vas te fendre la gueule ». Il s’est trouvé que là-bas on n’avait pas du tout de matériel, on a fait cette guerre avec un matériel d’infanterie au niveau de la section, fusil et 15 cartouches pour les Biafrais, très peu d’armes lourdes, vraiment ridicule. On devait avoir une aviation et des chars, Ojukwu avait envoyé un homme à lui en Espagne avec je crois un milliard de francs en livres pour acheter des avions, T 27 ou T 28, et qui s’est volatilisé. On avait donc cette promesse d’une belle guerre.
On est partis d’Orly pour Lisbonne. La PIDE [1] nous a accueillis, pas très discrètement, on a traversé tout l’aéroport au pas de charge, à 7, un type balafré, on est allé en bout de piste où un avion commençait à ronfler, mais on a dû rester deux jours à Lisbonne parce que l’avion n’avait pas de radio, c’était vraiment artisanal. Pour les convoyages de mercenaires, les pilotes étaient américains, des vieux, cheveux blancs, briseurs de grèves aux USA, interdits de séjour pratiquement partout, correspondants de la CIA. Le voyage coûtait X milliers de $, il fallait amener la somme au moment du décollage, les avions leur appartenaient, Faulques venait avec sa petite mallette et payait cash. Pas question pour eux d’embarquer un mec de plus.
On a atterri au Biafra de nuit, les Nigérians n’avaient qu’une chasse par jour, après une escale à Sao Tomé où régnait une atmosphère comme celle qu’on avait pu connaître en Algérie. La piste était balisée par des petits brûlots d’essence, on a été accueillis par le commandant P., on entendait des tirs, une ambiance de guerre, ce qui nous a fait plaisir. Le commandant nous a dit : « Je crois que vous apportez du matériel », il pensait qu’on avait du matériel anti-chars neuf, pas du tout, on avait des vieux anti-chars de l’armée allemande. Il a dit : « Bouark, encore ! On en a déjà une douzaine, personne ne sait les mettre en œuvre, on n’a pas l’huile pour les vérins de recul, c’est des trucs qui ne servent strictement à rien ». Ça faisait partie des livraisons d’armes d’Europe sur le Biafra. On ne les a jamais utilisés. On avait passé 17 heures de vol pratiquement assis dessus, avec les caisses d’obus, ça nous a surpris qu’il fasse cette gueule. Il s’en est pris un peu à nous, alors qu’on n’y était évidemment pour rien, on avait été convoyés depuis Orly. Le tout sur un fond de petite guerre, Pffuit !, des tirs de mortier.
On a atterri à Port-Harcourt, on a été conduits à une sorte de mess, des villas anglaises avec du gazon, bar, piscine, et, comme j’étais le plus ancien, j’ai discuté de la situation avec P., devant un verre de scotch. Il dramatisait un peu, il me dit : « Ici, c’est Dien Bien Phu ». Bon. La gueule, Dien Bien Phu, merde. Il me parle de volontaires souffrant de dysenterie, le climat à l’arrivée n’était pas bon du tout. Il me dit : « Voilà, toi tu iras sur le front dur ». Il y avait un front dur, Calabar, et un plus calme, Enugu. C’est sur Enugu que ça été le plus dur par la suite en particulier des pilonnages de mortier incroyables, les gars ayant creusé leurs trous individuels étaient pratiquement tous blessés à la tête, par éclats, c’était monstrueux.
Je suis parti le lendemain en Land-Rover avec un chauffeur noir et un officier, Biafrais également. Sur Calabar, ils envoyaient des gens qui avaient déjà fait la guerre. Mais il y avait aussi parmi nous des novices, Po., par exemple, n’avait même pas fait son service. Ces éléments considérés comme militairement faibles étaient envoyé sur Enugu. Je suis donc parti vers Calabar ; pas d’essence, il a fallu en réquisitionner, presque se battre pour en avoir, c’était logique dans un pays en guerre ; ils cherchaient des espions dans les fourrés. Je suis arrivé en pleine nuit, ils avaient été avertis par radio de l’arrivée d’un Français, ils devaient donc nous attendre et baliser la route puisque c’était le front. C’était vers la Noël ; me voilà dans la jeep avec des Biafrais qui ne connaissaient pas le terrain ; évidemment, on a dépassé nos positions, ne voyant pas la sentinelle promise. On s’est engagés sur un pont en planches, sur la rivière Calabar, le pont en dur, miné par les Biafrais ayant été détruit par les MIG adverses dans un de leurs jours de chance. Un mec a sifflé, je ne sais pas qui, on était à l’intérieur des lignes nigériennes, pour nous avertir que c’était miné ? On a fait demi-tour et on a fini par être accueillis par le lieutenant B., S. et d’autres, des gars qui avaient participé à l’Algérie française. B., un ancien du Ier REP, avait le commandement du front de Calabar. J’ai couché dans une villa, c’était une brousse, mais aménagée par les Anglais, une plantation d’hévéas.
Quelle est ton opinion sur Faulques ?
Elle est très bonne, on s’est retrouvé complètement encerclés, on a vraiment failli se faire couper les… Il aurait pu considérer qu’on était des mercenaires, s’en laver les mains, pas du tout. Le front de Calabar a cédé très vite, on a eu plusieurs morts sur une seule journée, il est revenu d’Europe pour renégocier avec Ojukwu, pour lui faire valoir que de son côté, le contrat n’était pas respecté, qu’il n’y avait pas d’aviation, pas d’armes anti-char… Ça n’était pas évident, à l’intérieur du gouvernement biafrais, certains étaient très hostiles aux Blancs en général et aux mercenaires en particulier, il faut se rappeler comment Steiner a été expulsé par la suite, c’était vexant pour eux d’avoir recours à des mercenaires. Faulques est revenu et nous a sorti de ce merdier ; il a laissé le choix à chacun de partir ou de rester. Ojukwu a admis sa position, il a reconnu ses faiblesses, certaines propres à son peuple, qui est charmant, cultivé, commerçant, très ouvert, mais pas guerrier – nos gars se faisaient tuer comme éclaireurs de pointe, c’est ce qu’on faisait. Faulques ne nous a jamais laissés tomber, j’ai la plus grande estime pour lui. On est partis la queue entre les jambes, il est venu se foutre dans un piège alors que rien ne l’y obligeait, il y avait une opposition très forte à notre encontre d’une partie de la population.
Que penses-tu de Steiner ?
Il avait une activité très différente de la nôtre ; il organisait des camps d’entrainement pour former des commandos. Il a fait un bon boulot de formation mais ne participait pas directement aux combats.
Quel était exactement votre rôle ?
C’était d’encadrer les Biafrais à l’échelon de la compagnie ou du bataillon. Je pense que c’était une erreur, groupés en commando notre efficacité aurait été bien supérieure.
On a fait un coup de main un jour derrière les lignes nigériennes ; on était 4 ou 5 avec deux compagnies biafraises. Ça n’a pas été une très grande réussite. Le lieutenant B. a organisé un jour une opération « à la légionnaire ». Ils sont partis avec 4 tubes de mortier, sans carte – d’ailleurs personne n’en avait, on se repérait à l’estime et avec des guides. Il a bombardé un village et a eu la chance de tomber sur un groupe de mercenaires anglais. Un bon petit coup de commando. Stimbre c’était un peu le cow-boy. Il est mort là-bas. Il se trouvait confronté à une avance à la blitzkrieg : une percée avec des Ferrets et des EBR ; les Biafrais décrochaient dès qu’ils entendaient les bruits de moteur. Un jour ils sont tombés sur Stimbre ; il a piégé un passage obligé ; il a buté une soixantaine de mecs bien groupés autour d’un EBR. Mais nous n’avions pas de moyens, pas de possibilité pour les patrouilles de piéger les axes. Pas de mines assiettes, pas d’explosifs ; rien. C’était décevant ; même pas moyen de pratiquer une petite guerre des nerfs. On avait un bazooka pour l’ensemble du groupement de Calabar et 7 à 8 tubes de 81 servis par un Européen, un type extraordinaire, un italien. Il avait subi des bombardements atroces dans la région de Monte Cassino ; pendant deux jours ils étaient soufflés de bombe en bombe – de trou en trou – sans possibilité de s’enterrer. Il maniait ses mortiers à la main. C’est lui qui nous a sauvés plusieurs fois de l’encerclement. N. aussi ; il était là depuis plus longtemps que nous et avait pris en main une équipe. Il avait une très bonne équipe défensive, ça a contribué à freiner l’avance des Nigérians. En une journée on a eu 7 morts : Stimbre le matin, Schliedermann l’après-midi. Le lieutenant était effondré…
Stimbre est mort pendant la manœuvre d’encerclement sur Calabar. Il était parti relever la section de Schwartz tué le matin. Le front, c’était la rivière et on surveillait les gués. En fait les Nigérians sont passés de nuit sur des radeaux. Il est parti en land-rover avec une mitrailleuse de 7,62 montée sur pivot. Il est tombé dans une embuscade. Je suis donc parti le chercher avec une compagnie. Plus on avançait et plus on sentait que les Biafrais lâchaient.
Le terrain était vallonné. On escalade une ligne de crête toujours sur la route. On n’avait pas de jumelles ; les types se tenaient debout sur la crête ; on voit une colonne nigériane qui nous avait déjà dépassés. Je me suis demandé ce que j’étais venu faire là pour 400 $ par mois ; on était complètement encerclés. Avec ces crétins debout ça n’a pas tardé – on s’est fait repérer. Mitrailleuses, mortiers ; heureusement qu’on était sur une crête. La tête de colonne ennemie a immédiatement manœuvré pour essayer de boucler le dispositif. On avait une MG, le pourvoyeur avait une lessiveuse sur la tête pour porter les bandes. Il trottinait. Ils mettent la MG en position – j’étais dans l’axe – ce crétin commence à lâcher une rafale putain ! Me voilà à plat ventre et que je roule et que je roule ! C’était un émotif. Mon pote lui fout une baffe et prend la MG. Les Nigérians commençaient vraiment à s’approcher. Ils étaient à 150 mètres. La MG évidemment s’enraye. On les a tiré un peu au FAL et on a décroché. C’est alors que j’ai vu la voiture de Stimbre renversée. On avait peur parce que les Biafrais n’étaient pas une troupe. J’ai dû tirer au fusil sur les fuyards pour les rassembler. On était vraiment dans la merde.
Les Nigérians étaient beaucoup plus solides, en plus étaient kiffés. Ils avaient des MG comme tu as une paire de ciseaux. C’était un véritable tapis roulant, 40 morts, on relevait 8 MG. Tout le monde tirait a priori pour ouvrir la route. Le terrain était haché. C’était d’abord une blitzkrieg puis la stabilisation sur un front et ensuite l’écrasement. Il n’y avait rien à faire – la disproportion était trop grande. À Calabar on avait une Ferret de la 2e guerre. Les Nigérians avaient 300 mercenaires britanniques. Le seul chez nous, Williams, s’était trompé de camp. Eux, très rarement engagés, ils servaient de conseillers militaires. Nos pn devait être au maximum 40. Quand on est partis c’était complètement foutu, on était parti pour faire une guerre – pour une bouffée d’oxygène. Une dizaine de morts sur 40 nous avaient suffis.
À combien chiffres-tu le nombre de mercenaires ?
Quand j’y suis allé, c’était l’époque où il y en avait le plus, une quarantaine du côté biafrais. Sur le front de Calabar, nous étions une quinzaine.
Propos recueillis par Yves Van Gheele
[divider]
Notes
[1] Police politique portugaise
#Guerre du Biafra : témoignage complet de Christian Lefèvre http://t.co/EPJrWJkiOm #mercenaires #années60 #Afrique pic.twitter.com/M9RC0djZy8
— Revue Conflits (@revueconflits) 15 Juillet 2014
[divider]
Boutique. Voir l’intégralité des numéros : cliquez ici
[product_category category= »numero-papier » orderby= »rand » per_page= »4″]