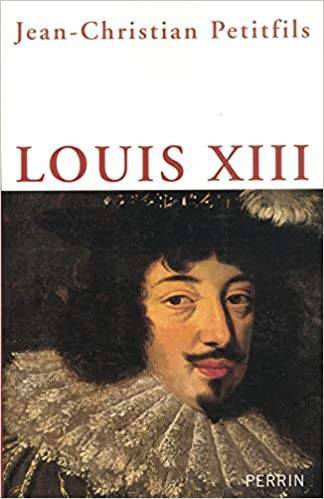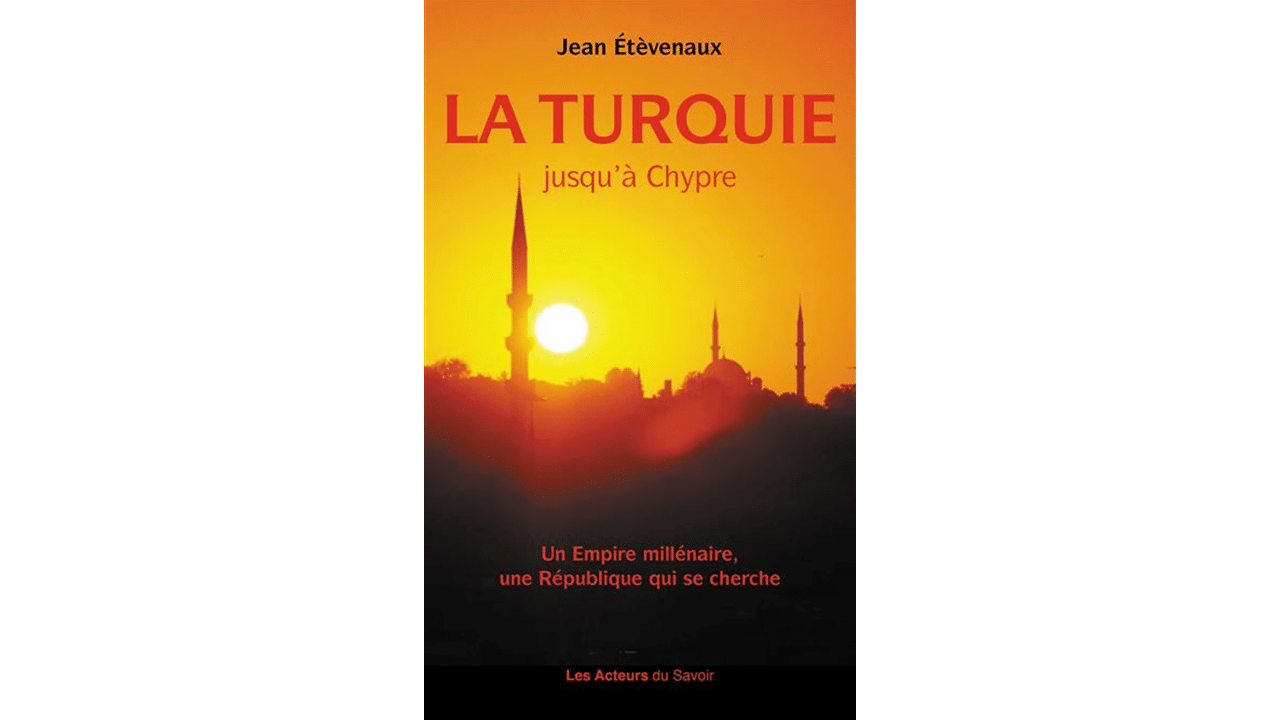Étouffé entre la popularité du Vert Galant et le prestige du Roi Soleil, terni par la légende noire et l’œuvre monumentale du cardinal de Richelieu, Louis XIII est un de ces grands malchanceux que la mémoire historique française accable de sa disgrâce. Et pour cause, plusieurs générations d’écrivains et d’historiens lui ont bâti une réputation de sombre personnage, fade et sans couleurs, désintéressé du pouvoir et à vrai dire transparent. Voltaire l’a sacré « esclave couronné », Michelet dans un de ses élans lyriques le bafoue en « maigre Jupiter à la moustache pointue » et évidemment Alexandre Dumas, dont les immortels Trois Mousquetaires ont parachevé la constitution de cet injuste mythe. L’éducation nationale l’a repris à son compte dès la IIIe République, les manuels scolaires des hussards noirs aimant à le dépeindre en roi fainéant tout à fait inféodé au bon vouloir de l’homme rouge. Devant ces fabulations et ces calomnies de l’historiographie, Jean-Christian Petitfils réhabilite Louis XIII comme un homme qui a non seulement pleinement exercé ses fonctions souveraines, mais aussi comme un grand roi dont le règne pose les bases de l’absolutisme et annonce l’éclat sans précédent de son fils.
Le portait restauré d’un grand roi
Dans un style fluide et flamboyant, l’historien restaure, étaye, détaille et révèle avec talent le portrait d’une personnalité riche et complexe. Comme dans ses autres biographies, il s’appuie sur un travail considérable des sources dont beaucoup étaient jusqu’alors inexplorées [1].
Qu’en est-il véritablement de ses défauts ? Louis XIII est soupçonneux, tatillon, jaloux, neurasthénique et facilement irritable. Délaissé par sa mère qui lui préfère son cadet, traumatisé par le meurtre de son père alors qu’il n’avait que huit ans, c’est assurément un homme fragile. Sa santé chancelante, — ce qu’on identifie comme étant probablement la maladie de Crohn et qui le condamnera à mourir jeune (41 ans) —, l’immobilise régulièrement au lit à cause d’insupportables douleurs abdominales. Ses rapports avec ses favoris (Luynes, Saint-Simon et surtout Cinq-Mars) comme avec ses confidentes (Louise de La Fayette, Marie de Hautefort) sont d’une mièvrerie infantile dont les conséquences furent parfois désastreuses. Sans parler de ses rapports conjugaux chaotiques avec la coquète Anne d’Autriche qui complote contre lui avec ses frères espagnols.
Mais il demeure que ces faiblesses sont largement contrebalancées par des qualités incontestables que les clichés tenaces ont toujours occultées. Comment en effet ne pas parler de son courage surprenant, lui qui n’hésitait pas à s’exposer sous le feu ennemi pendant ses campagnes militaires, de son goût pour la gloire et le rayonnement de la France, de ses talents artistiques et de sa passion pour la musique, de sa fermeté et de sa détermination à mâter les rebellions et les complots perpétuels des Grands, des protestants et des membres de sa propre famille ? On ne saurait taire non plus sa clairvoyance à choisir Richelieu comme son principal appui, tout en le maintenant dans l’état de la « créature » qui doit tout à son maître. Comme le sera son arrière-arrière-petit-fils, Louis XV, il est aussi secret et dissimule habilement ses émotions ou ses projets. Il prend d’ailleurs un malin plaisir à se révéler au grand jour à la surprise de tout son entourage, un art qu’il portera au comble de la maîtrise lors de la fameuse journée des Dupes. Loin du caractère sans scrupules, rigide et autoritaire dont on l’affuble trop souvent, Louis est au contraire un être aux grandes qualités humaines. On le retrouve périodiquement tenaillé d’incertitudes avant de prononcer des sentences de mort ou devant les souffrances que provoquent ses guerres nécessaires. On le voit pardonner sans compter à son frère Gaston, à sa mère Marie de Médicis ou au duc de Lorraine. On remarque constamment son christianisme assidu et méticuleux, ses nombreux examens de conscience avant et après l’action. Petitfils va jusqu’à en faire l’inspirateur du Cid, un héros cornélien déchiré entre l’amour et le devoir, mais distinguant parfaitement le bien commun du bien des particuliers.
Un roi-seuil : la naissance de l’État moderne
Louis le Juste fut le dernier roi-chevalier qui aimait sillonner les champs de bataille, qui chevauchait des journées entières à la tête de ses armées et partageait sans ambages le lit de camp du soldat. Il fut probablement le dernier roi de France attaché aux vieilles traditions médiévales de la guerre juste, prenant soin de ne s’engager qu’en position de légitime défense et d’assurer une paix acceptable pour tous les partis. Il avait une très haute idée de la fonction qu’il incarnait, élevant à des hauteurs jamais atteintes avant lui la sacralité de la monarchie de droit divin. Dernier grand roi guerrier et premier roi moderne, Louis XIII est indiscutablement un roi-seuil.
On peut dire sans détour que c’est véritablement sous son règne que l’absolutisme se fonde et prend un essor décisif. Petitfils entend par là le mouvement, qui à partir de l’Édit de Nantes de 1598 [2], tend à centraliser le pouvoir politique au détriment de la société de corps et d’ordres et donc des particularismes régionaux, des droits coutumiers, des vieilles libertés. En effet, si le roi reçoit et détient la plénitude de la souveraineté, il est loin d’être tout-puissant et doit composer avec les différents corps sociaux qui sont tous attachés à conserver leurs privilèges ou à en conquérir de nouveaux. Par exemple, la vénalité et l’hérédité des offices (la fameuse Paulette) ont rendu leurs bénéficiaires autonomes et dangereusement indociles. La lutte qui s’engage dès lors contre le parlement parisien et les parlements de province [3], préfigure le coup de majesté de Louis XIV en 1673, celui de Maupeou en 1771 après leurs sempiternels blocages sous le règne de Louis XV, et l’erreur impardonnable de Louis XVI de les rappeler en 1774, qui engendrera la convocation des états généraux et la Révolution française.
C’est bien sous le règne de Louis XIII que naît l’État moderne. Face au pouvoir des gouverneurs de province, l’État se dote de plus en plus de fonctionnaires royaux compétents dans les affaires sociales, fiscales et juridiques : les intendants. La monarchie administrative se développe également dans la marine, l’armée et le renseignement. Grâce à elle et à l’imposant réseau de clientèle que le cardinal de Richelieu s’était constitué, le pouvoir royal a pu étendre son emprise sur les territoires relevant de sa souveraineté, augmenter considérablement la charge fiscale, limiter la marge de manœuvre et la propension à la révolte des Grands et des protestants, influencer l’opinion publique naissante. La définition officielle de l’État moderne aux traités de Westphalie de 1648, cinq ans après la mort de Louis XIII, n’est que la conséquence de sa vision politique, coédifiée avec Richelieu, et de la victoire franco-suédoise à l’issue de la guerre de Trente Ans. On ne peut pas pour autant parler d’uniformisation, car la mosaïque sociale et juridique qu’était l’Ancien régime reste farouchement attachée à ses coutumes et privilèges. L’État, encore embryonnaire et juridiquement tenu de respecter et protéger ces particularismes, n’est pas en mesure de modeler le pays comme il le voudrait.
La genèse de l’État moderne s’accompagne de profondes mutations sociales qu’engendre notamment le désastre financier provoqué par les guerres. Elles contribuent à l’émergence d’un puissant groupe social de publicains venant de la haute bourgeoisie, de la noblesse de robe et d’une certaine aristocratie affairiste dont la réussite est totale. « Financiers, fermiers, entrepreneurs, munitionnaires, banquiers, riches négociants internationaux, agioteurs professionnels », ils noyautent progressivement les finances de l’État. « Le pouvoir perdait des prérogatives au profit d’une forteresse financière qui n’était pas près d’être démantelée. Les conséquences fiscales de la guerre menaçaient ainsi la nature même de la monarchie. Au milieu d’une gabegie généralisée imposée par les circonstances, on glissait d’un État de justice à un État de financier. Grande révolution moderne dont les répercussions sur l’ordre social allaient être considérables. »
A lire aussi : Promenade dans l’ombre des éminences grises – Entretien avec Charles Zorgbibe
Le sceptre et la barette : collaboration ou subordination ?
C’est dans la relation mal connue entre le roi et son principal ministre que Petitfils met toute son énergie scientifique. Leurs zones de pouvoir respectives, leurs visions communes pour la France, leur correspondance, leurs échanges, mais aussi leurs rapports personnels et affectifs, leurs désaccords sont pour ainsi dire le fil conducteur de l’ouvrage. Comment ce tandem cohabitait-il, comment fonctionnait-il ? Quelle est sa singularité ?
Il convient de rappeler qu’Armand Jean du Plessis de Richelieu a mis du temps à s’asseoir définitivement à la table des affaires. Initialement destiné à une carrière militaire, il devient évêque du petit diocèse de Luçon [4] où il se fait d’abord remarquer pour ses écrits spirituels et ses talents d’orateur aux états généraux de 1614. Avec l’appui de la reine mère Marie de Médicis, il parvient à rentrer dans le gouvernement de Concino Concini, principal ministre de la régence. Lorsque celui-ci est déposé par Louis XIII qui s’empare du pouvoir par la force en 1617, Richelieu est exilé tout comme le reste de l’entourage de la régente. On dit que le roi, le croisant dans les couloirs du Louvre, l’aurait assommé d’un « me voilà délivré de votre tyrannie, Monsieur de Luçon ». C’est le début d’une lente descente aux enfers. Animé d’une folle ambition et chef du conseil de Marie de Médicis, il fait le pari de revenir aux affaires par l’intermédiaire de la reine qui lui porte une vive affection. Pari perdant dans un premier temps, car les guerres de la mère et du fils le condamneront au comble de la disgrâce jusqu’à l’exil à Avignon où, piteux et désespéré, il rédigera même son testament. Ce n’est qu’en 1624, après avoir servi d’intermédiaire dans la réconciliation de Louis XIII avec sa turbulente mère et reçu en 1622 la dignité cardinalice, qu’il rentre enfin au conseil du roi.
Ces rappels historiques ne sont pas sans conséquence. On comprend dès lors que la confiance que lui accordera Louis XIII n’avait rien d’une évidence. Il faudra en effet beaucoup de temps au monarque pour réparer les cicatrices du passé et lui accorder sa pleine protection. Durant toutes ses années à la tête du conseil, le cardinal aura souvent le sentiment d’être sur une ligne de crête au bord du gouffre et exigera du roi le renouvellement régulier de son affection. D’abord largement dépendant du soutien de la reine, c’est seulement à partir de la journée des Dupes en 1630 que Richelieu est définitivement reconnu et défendu par Louis XIII comme son principal serviteur. Car c’est bien de service dont il s’agit. Si le roi est séduit par le « génie fulgurant » de cet homme au « charisme étonnant », il n’en demeure pas moins profondément jaloux de son autorité. Se méfiant du tempérament impérieux de son ministre et de son goût du pouvoir, il lui fait régulièrement sentir, l’obligeant de facto à déployer un « art de présenter au roi différentes solutions tout en le guidant doucement vers celle qui avait sa préférence ». Et de se plaindre « je m’estime heureux quand de quatre de mes propositions, deux sont agréables. »
« Sa situation était instable, précaire, il le savait bien avant la journée des Dupes. Il pouvait être remercié du jour au lendemain sans justification. La clé de Richelieu ? Ni l’ambition, ni l’orgueil, ni le tempérament dominateur, mais la crainte, la crainte qui le tenaillait au ventre, le poussait à avancer, le forçait à se dépasser, la crainte d’être congédié brutalement, la crainte d’une impulsion irraisonnée du roi, lui faisant subir le sort de Concini. D’où son besoin d’un attachement constamment réaffirmé. Cette crainte de tous les instants, de combien d’insomnies la paya-t-il ? Beaucoup ont fait grief à Louis XIII de sa fatigante jalousie, de son éternelle méfiance qui retardait inutilement la marche des affaires, sans comprendre que sans elles il aurait abdiqué son pouvoir. Disons-le, il sut élever ces deux défauts en vertus royales… ». Voilà une synthèse bien différente de celle communément répandue.
Il serait néanmoins exagéré de réduire leurs relations à la seule méfiance mutuelle. Bien au contraire, « le cardinal et lui se retrouvaient sur des objectifs essentiels : la grandeur, la prospérité de la France, la gloire de ses armes, son rayonnement extérieur. Leurs pensées, leurs desseins étaient en ce domaine si en phase, disait Goulas dans ses Mémoiresque le cardinal ne proposait presque jamais rien que le roi n’eût déjà à l’esprit ». Et le fait est que Louis XIII lui laissera souvent une marge de manœuvre presque complète autant dans les affaires intérieures qu’extérieures.
Louis XIII adhère à la politique de Richelieu
Les deux hommes étaient presque parfaitement en phase sur leur vision géopolitique de la France et de l’Europe. Mais c’est bien le génial Richelieu qui conçoit, met en œuvre et déploie la politique française reposant sur deux axes majeurs : pacifier à l’intérieur, desserrer l’étau des Habsbourg à l’extérieur.
Sur le plan intérieur, l’enjeu est d’une part de mater l’ambition forcenée et l’esprit rebelle des grands féodaux du royaume. Richelieu les surveille et les manipule pour en faire une noblesse disciplinée et dévouée à la couronne. Louis XIII fait preuve d’une intransigeance à toute épreuve contre chaque contestation brutale de son autorité. Pardonnant souvent, il fut inflexible à plusieurs reprises et refusa sa grâce à des grands noms comme Chalais, Montmorency-Bouteville, le maréchal de Marillac ou encore le duc de Montmorency. D’autre part, l’impératif était de ruiner définitivement ce « parti huguenot » disposant d’une autonomie partielle, proche des puissances étrangères et aspirant clairement à créer un État dans l’État. Le tableau épique d’Henri Paul-Motte illustrant le siège de La Rochelle (1627-1618) a immortalisé cette lutte implacable dont l’issue victorieuse mit un terme décisif aux guerres de Religion. Ne faisons pourtant pas de Richelieu ni de Louis XIII des extrémistes religieux. L’objectif était politique et jamais religieux. « Rêvant de convertir les hérétiques protestants par « les voies de la douceur », sans asservir les consciences, ils ne leur demandaient que de se comporter en sujets humbles et soumis, pratiquant leur culte sans causer scandale ni désordre. »

Le cardinal de Richelieu au siège de La Rochelle (1627-28) peint par Henri-Paul Motte en 1881 (c) Wikipedia
À l’extérieur, la menace est clairement désignée : les deux maisons de Habsbourg de l’Empire et d’Espagne qui rêvent de créer une monarchie catholique universelle sous leur tutelle. La politique de Richelieu, solidement appuyée par son éminence grise le Père Joseph, est d’abord de briser l’encerclement en investissant la vallée géostratégique de la Valteline. Ce petit canton d’Italie permettant aux troupes habsbourgeoises de faire leur jonction est absolument vital pour la survie du royaume. Le cardinal l’appelle le « centre du monde ». Ailleurs, la France se pose partout comme le défenseur de la liberté des petits États contre les velléités de prépondérances des deux branches, n’hésitant pas à s’allier avec des puissances protestantes comme la Suède ou les Provinces-Unies pour faire front contre le très catholique Ferdinand II du Saint-Empire romain germanique. C’est la terrible guerre de Trente Ans, à l’issue de laquelle Richelieu envisageait un nouvel ordre de paix qui ferait de la France l’arbitre de l’Europe. Ce programme se matérialisera quelques années après à sa mort lors des fameux traités de Westphalie menés d’une main de maître par son disciple Jules Mazarin.
Ne prêtons pas pour autant de trop vastes perspectives aux visées géopolitiques de Richelieu. Qu’il voulût faire de la France la première puissance en Europe est une certitude. Mais Petitfils écarte « l’idée anachronique des frontières naturelles, qui ne font pas partie de son univers conceptuel. Sans doute a-t-il rêvé de reconquérir les terres autrefois relevées de la suzeraineté française : l’Artois, les Flandres et le Franche-Comté. C’est ce qu’on peut déduire de son Avis au roi de janvier 1629. Il ne s’agissait pourtant pas de pratiquer une politique agressive. Son système de portes permettant de contrôler et de faire passer en cas de nécessité des troupes, soit en Italie, soit en Allemagne, répondait à une logique défensive et non offensive ». La France n’est pas encore la puissance qu’elle sera dans la deuxième moitié du XVIIe siècle.
Si Louis XIII laisse à sa mort un royaume exsangue, épuisé de violences et de famines, il n’en demeure pas moins que son règne pose les bases qui permettront la gloire de son fils. Roi malheureux, il ne verra pas les conséquences de sa politique. Mort en 1643 quelques mois après Richelieu, les grands traités de paix de Westphalie (1648) et des Pyrénées (1659) qui consacrent les succès français seront ratifiés sous la régence d’Anne d’Autriche et de Mazarin. Quant à l’éblouissante victoire de Rocroi du Grand Condé qui signe le déclin de la puissance espagnole, elle aura lieu cinq jours après sa mort, le 19 mai 1643.
[1] Source mine d’or du médecin de Louis XIII : Héroard. Un monument de 1054 pages manuscrites conservé à la Bibliothèque nationale de France écrit jour pour jour jusqu’à la mort de l’auteur en 1628.
[2] Moment historique où pour assurer l’unité nationale le pouvoir royal se positionne au-dessus des divisions religieuses.
[3] Qui n’étaient censés qu’enregistrer les édits royaux ou faire remonter exceptionnellement d’humbles remontrances jusqu’au conseil du roi.
[4] Car son frère aîné se fait moine, les évêchés se transmettant alors au sein des mêmes familles en tant qu’importantes sources de revenus et de prestige.