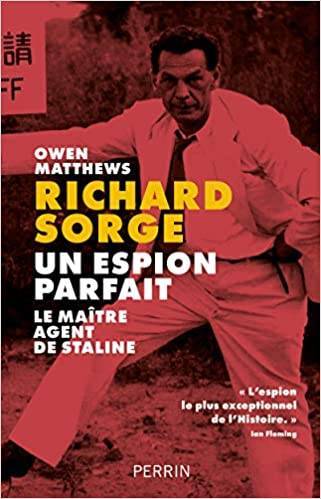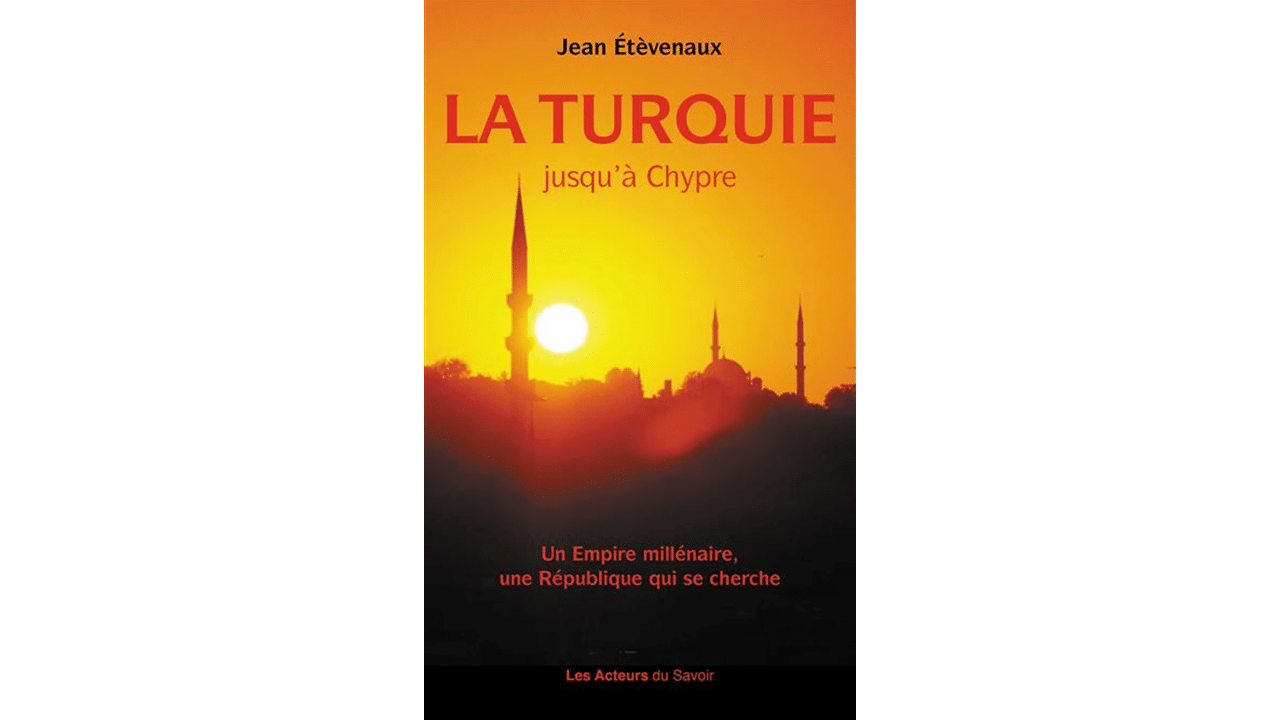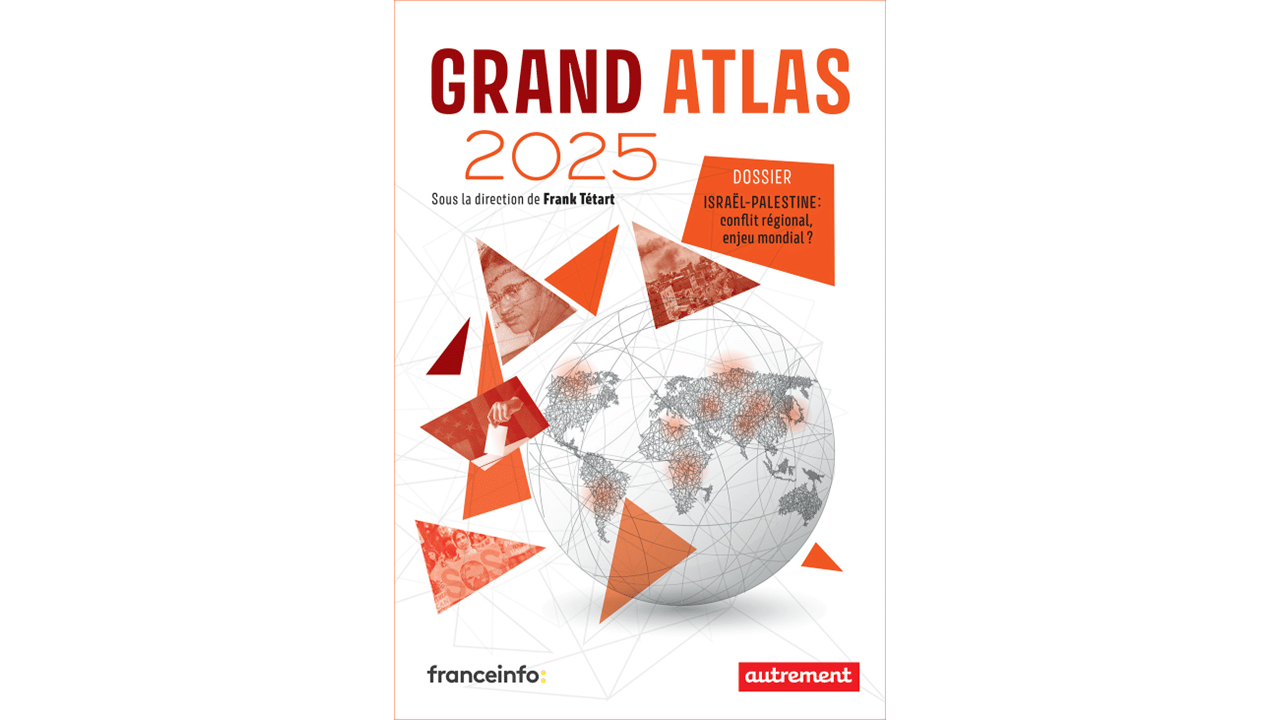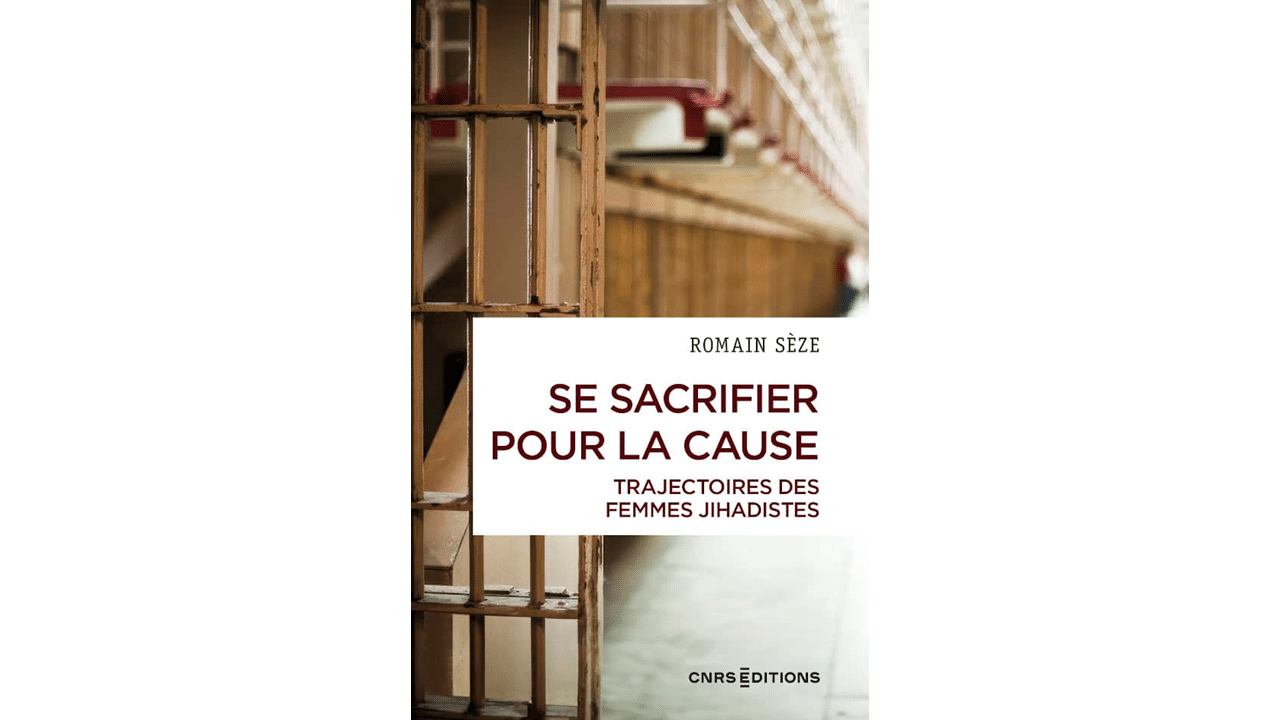Comment un mauvais garçon est devenu un grand espion – l’un des plus remarquables que le monde eût jamais connus, tel est l’un des objets de cette biographie consacrée à Richard Sorge, ce journaliste allemand, né à Bakou, en 1895 et fusillé à Tokyo le 7 novembre 1944, le jour anniversaire de la révolution d’octobre, qu’il servit avec un rare talent.
Que l’on en juge : le réseau d’espionnage qu’il créa dans le Tokyo d’avant guerre, le mit en relation avec les plus hautes sphères du pouvoir, en Allemagne, au Japon et en Union soviétique. Son meilleur ami, Eugen Ott, ambassadeur d’Allemagne au Japon et à son insu son employeur et son informateur à la fois, s’entretenait régulièrement avec Hitler. Son plus grand agent japonais, Hotsumi Ozaki, était membre du conseil consultatif du gouvernement, avec le Premier ministre, le prince Konoye. A Moscou, il avait libre accès au bureau de Staline. C’est donc un véritable miracle si, pendant presque neuf ans, ce maître espion soviétique, passa carrément inaperçu à Tokyo, alors même qu’une vague d’espionnite déferlait sur l’archipel nippon et que la police se tenait constamment à l’affût de tout ce qui permettrait de découvrir la source des transmissions radio cryptées qu’il envoyait régulièrement.
Sorge réussit l’exploit de dérober les secrets d’État militaires et politiques les mieux gardés d’Allemagne et du Japon et à rester caché tout en s’exposant à la vue de tous, c’est là l’un des traits les plus marquants de sa personnalité à multiples facettes. Car communiste idéaliste, l’homme était aussi menteur et cynique. Il se voyait comme un soldat de la révolution, membre d’une classe supérieure de cadres du Parti investis d’une mission clandestine et sacrée : pénétrer à l’intérieur des places fortes des ennemis impérialistes de l’Union soviétique.
C’était aussi un pédant, un ivrogne et un homme à femmes. Il aimait fanfaronner et se montrait furieusement indiscipliné, le danger était une drogue. Au cours de ses fréquentes beuveries, il lui arriva de casser voitures et motos, d’affirmer ouvertement son amour immodéré de Staline et de l’Union soviétique devant un parterre de nazis et de commettre l’imprudence de séduire les épouses de ses meilleurs agents et de ses collègues les plus proches. Il se présentait souvent comme un héros romantique, baron voleur sorti tout droit de la poésie allemande, comme Till Eulenspiegel. Ce défenseur des masses laborieuses, d’un snobisme intellectuel ravageur, avait pour milieu naturel le monde des casinos, maisons closes et bastringues de Shanghai et de Tokyo. Comme la plupart des espions parvenus au sommet de leur art, Sorge cédait au besoin compulsif de tromper. La duperie était l’expression de son talent et une fatale addiction. Il passa la plus grande partie de sa vie à mentir à son entourage, à ses nombreuses maîtresses et à ses amis Peut-être s‘est-il menti à lui-même.
Mais au-delà de la description des profondeurs psychologiques de ce personnage, à maints égards exceptionnel, l’un des intérêts de ce livre est aussi de replacer l’homme au cœur de bien des intrigues ou des interrogations des premières années de la guerre. Contrairement à l’activité de la plupart des espions du XXe siècle, surtout durant les temps de la guerre froide qui en constitua l’âge d’or, l’espionnage que pratiquait Sorge ne consistait pas à trahir des agents ou à éventer des opérations secrètes. Il avait une incidence directe sur le cours de la guerre. L’un des aspects les plus étranges de l’histoire de Richard Sorge est que, contrairement à beaucoup d’autres récits du monde mystérieux des agents secrets, la sienne est extrêmement bien documentée. Après leur arrestation par les autorités japonaises en octobre 1941, tous les membres du réseau, à l’exception notable de Kawai, l’un des agents les plus novices de Sorge, ont avoué, poussés par l’instinct de survie. Sorge lui-même, cet incompris qui, pendant des années, n’avait pas été apprécié à sa juste valeur par ses maîtres de Moscou, écrivit de sa prison une longue confession mettant en exergue ses exploits, son professionnalisme et son intégrité.
A lire aussi : Entretien – Le Japon : le pays qui ne fait rien comme les autres
Les deux gros volumes rassemblant confessions et transcriptions du réseau Sorge ont été intégralement publiés après guerre, pour être abondamment cités par les anticommunistes du maccarthysme comme preuve éclatante de la capacité des services de renseignement soviétiques à infiltrer les plus hautes sphères gouvernementales. Pourtant nous ne savons pas à ce jour l’opinion que se faisaient les Soviétiques de Sorge. Aucun historien occidental n’a eu accès aux archives de l’Internationale communiste à Moscou, ni des services de renseignement soviétiques à Podolsk, et aucun n’a évoqué l’énorme travail accompli récemment par les historiens russes sur la base d’une partie des archives militaires interdites aux chercheurs étrangers depuis 2000.
Pourtant on connaît presque tout de sa carrière tumultueuse d’agent : son apparente disgrâce lors des purges implacables visant tous les non-Russes de l’organisation n’ayant pas manifesté une loyauté servile envers Staline, son recrutement par le renseignement militaire soviétique et les cycles de méfiance et de paranoïa ultérieurs et leur corollaire, le rejet des précieux renseignements qu’il envoyait, traités comme exemple de désinformation venant de l’ennemi. De même y voit-on de l’intérieur les efforts désespérés de Sorge pour avertir Staline de l’invasion prochaine de l’Union soviétique par les Allemands, en juin 1941, avertissements systématiquement occultés par les chefs d’état-major de l’Armée rouge, terrifiés à l’idée de contrarier le Vojd dans sa certitude qu’Hitler ne tenterait jamais rien contre lui.
Richard Sorge était un homme courageux. Qu’il s’agît de prendre des clichés de documents secrets en profitant de ce qu’on le laissait, seul, quelques minutes dans le bureau de l’ambassadeur allemand ou de lutter pour ne pas perdre conscience jusqu’à l’arrivée d’un ami et lui permettre de récupérer des papiers compromettants dans la poche de son veston, après une folle équipée d’ivrogne à moto qui l’amena à finir grièvement blessé sur un lit d’hôpital, il gardait un calme quasi surnaturel.
Si l’on excepte toutes les indiscrétions commises en état d’ébriété, il mena toujours une vie frénétique, se levant tôt et consacrant des heures à l’écriture, à la lecture et à ses activités d’espion. C’était un excellent militaire. Et, à certains égards, c’était aussi un gentleman. En prison, il a toujours refusé de parler des femmes de sa vie, et devant les enquêteurs, il n’a jamais évoqué la jeune Japonaise avec qui il entretenait une liaison de longue date. L’officier du ministère public chargé de l’interroger n’hésita pas à dire que c’était le « plus grand homme qu’il [lui] fût donné de rencontrer ». Il était aussi une manière d’intellectuel. Dans ses mémoires rédigées en prison, il écrivit qu’en temps de paix, il aurait versé dans l’érudition. Il vécut comme l’acteur principal d’un one man show avec un public réel inconnu de spectateurs physiquement présents –, il s’agissait de ses maîtres espions de l’état-major de l’Armée rouge, presque toujours à l’écart.
Le drame de Sorge fut qu’au moment le plus crucial de sa carrière, ils mirent en doute sa loyauté et le considérèrent comme un traître, bien que, par bonheur, lui-même n’ait jamais su le peu de cas que l’on faisait des précieux renseignements qu’il transmettait. John Le Carré, qui avait côtoyé le monde des espions, comprenait le personnage mieux que quiconque : « C’était un comédien au sens où l’entendait Graham Greene, un artiste comme les voyait Thomas Mann », écrivit-il. Comme Spinell dans le Tristan de Thomas Mann, il travaillait toujours sur un livre inachevé. Ce n’est pas le premier espion à sortir du rang des artistes ratés.