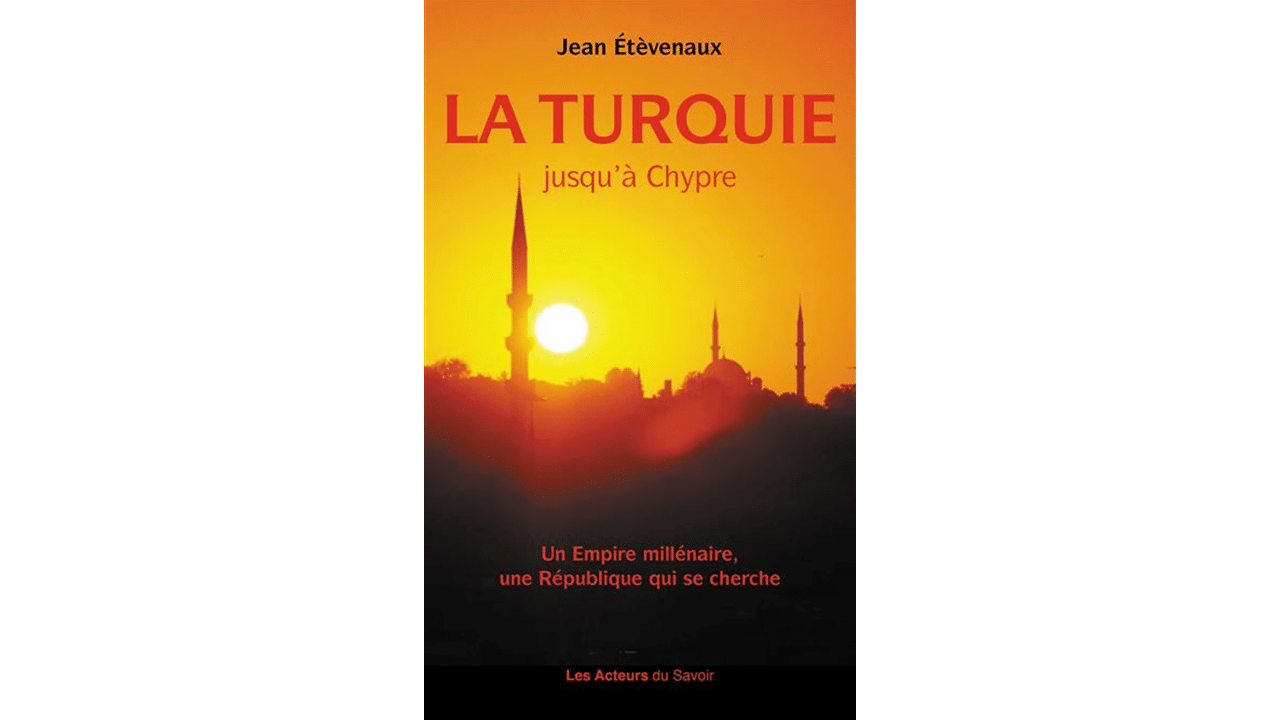Les chocs énergétiques se produisent dans un contexte de peur de la pénurie. La prise de conscience des risques de pénurie énergétique date des années 1960 et s’aiguise dans les années 1970, comme on le voit avec le rapport Meadows, publié par le Club de Rome en 1972 : il annonce une pénurie de pétrole pour la fin du siècle (ce qui ne s’est pas produit) et une panne sèche de l’économie mondiale.
Aux États-Unis, Fritz Schumacher, un économiste d’origine allemande appelé comme expert au Conseil national du charbon, est un des premiers à annoncer l’épuisement des ressources pétrolières et le choc qui doit s’ensuivre. Il finit par démissionner de ses fonctions, car il n’est pas entendu, mais publie peu après son ouvrage Small is beautiful.
Dans ce contexte, les chocs pétroliers surviennent comme une prophétie auto réalisatrice. Un éditorial du New York Times, en octobre 1973, résume bien le changement sur les marchés énergétiques : « La question ne se pose plus de savoir si le pétrole trouvera des marchés, mais si les marchés trouveront du pétrole. » Désormais, la peur de manquer prévaut.
Premier choc, premier coup
Les événements se précipitent à partir de 1971.
En 1971, l’accord de Téhéran entre pays de l’OPEP et représentants des grandes Majors occidentales est un véritable tournant historique. Il enterre le principe du fifty-fifty vieux de deux décennies. Il stipule que les gouvernements recevront au moins 50 % du prix du baril et que ce dernier augmentera immédiatement de 35 cents, avant d’autres augmentations annuelles : un véritable tournant, car l’OPEP prend l’initiative face aux Majors.
Cette offensive sur les redevances et sur les prix s’accompagne d’une action visant à restituer aux pays producteurs la pleine souveraineté de leurs ressources pétrolières : l’Algérien Houari Boumediene donne l’exemple dès février 1971, en décidant que son pays détiendrait désormais la majorité dans les sociétés françaises opérant sur son territoire, tandis que les oléoducs et gisements de gaz naturel sont purement et simplement transformés en biens d’État.
Les pays du Nord tentent d’enrayer cette évolution, sous la houlette des États-Unis. Dès le printemps 1971, le président Nixon lance un avertissement sur la surconsommation de pétrole à ses compatriotes : ne représentant que 6 % de la population mondiale, ils consomment un tiers du pétrole mondial. Il accélère le programme nucléaire : projet de surgénérateur, déblocage de nouveaux crédits… En même temps, il est à l’origine du premier choc pétrolier avec la décision unilatérale de suspendre la convertibilité or du dollar et en le dévaluant (deux fois, en 1971 et 1973), provoquant une baisse du billet vert, donc une baisse des revenus des pays pétroliers puisque le prix du pétrole est fixé en dollars ; les pays exportateurs vont chercher à compenser cette perte en relevant leurs tarifs.
En pleine guerre du Kippour, le 17 octobre 1973, les ministres du pétrole des pays arabes membres de l’OPEP décident d’instaurer un embargo et optent pour une réduction de 5 % de la production. Le communiqué final, rédigé seulement en arabe (un défi lancé aux Occidentaux), précise que ce pourcentage de 5 % sera appliqué chaque mois jusqu’à la complète évacuation par les Israéliens des territoires occupés en 1967 et la reconnaissance d’un État palestinien. L’Arabie Saoudite, alliée traditionnelle des Américains, réduit de 10 % sa production et cesse toute livraison aux États-Unis et aux Pays-Bas, du fait de leur soutien appuyé à Israël. Le choix des Pays-Bas tient aussi au fait que le port de Rotterdam reçoit une grande partie des chargements de pétrole du Moyen-Orient à destination de l’Europe, de quoi mettre la pression sur le continent dans son ensemble : des pays amis, des pays ennemis, des pays neutres… Le but est de diviser l’Occident. Ces décisions font quadrupler en quelques mois le prix du baril.
Pourtant, l’Arabie Saoudite a toujours été réticente à l’usage de l’arme pétrolière. Ce n’est qu’en septembre 1973 que le roi Fayçal se rallie à cette option pour éviter de se trouver isolé au Moyen-Orient. Encore peut-on douter de la réalité de l’embargo imposée par Riyad, celui-ci utilisant les services d’opérateurs indépendants et de spéculateurs pour écouler sa production. De même, Moscou, bien que soutenant les pays de l’OPEP, viole l’embargo en achetant du pétrole à son allié irakien et en le revendant aux États-Unis, après qu’il a transité par la Roumanie.
De 1974 à 1978, les recettes pétrolières de l’OPEP s’envolent. Elles atteignent 108 milliards de dollars en 1974 contre 33 milliards de dollars en 1973, puis 140 milliards de dollars en 1977 : on a pu parler d’un véritable « impôt-OPEP ».
Ces mesures historiques sont complétées par des nationalisations. La décision de prendre le contrôle d’au moins 51 % des concessions pétrolières non encore nationalisées est adoptée unilatéralement dans certains pays : c’est le cas de l’Irak de Saddam Hussein en 1972 et, en 1973, quelques semaines avant le déclenchement de la guerre du Kippour, de la Libye. D’autres pays préfèrent une solution négociée afin d’acquérir une partie des Majors anglo-saxonnes : ainsi, l’Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït et l’émirat d’Abu Dhabi obtiennent avec l’accord de New York signé en octobre 1972 leur participation dès 1973 à hauteur de 25 % du capital des compagnies concessionnaires et 51 % en 1983. Mais les choses évoluent rapidement : fait symbolique, en 1976 l’Arabie Saoudite nationalise l’Aramco qui devient rapidement la première entreprise pétrolière mondiale. Les nationalisations s’enchaînent ainsi et réduisent l’importance des Majors qui ne sont plus dominantes qu’au Nigeria, en Équateur et en Indonésie.
A lire aussi : Des énergies renouvelables de plus en plus diversifiées, de moins en moins brésiliennes
Second choc, second coup
La révolution islamique en Iran entre novembre 1978 et janvier 1979 crée les conditions d’un second choc pétrolier. L’arrêt brutal et total de la production de pétrole en Iran entraîne une immense pénurie sur les marchés mondiaux. Les pays de l’OPEP, réunis à Genève les 26 et 27 mars 1979, profitent de ce contexte très tendu pour à nouveau passer en force, en anticipant au 1er avril l’augmentation des prix prévue pour octobre : le prix du baril passe de 13,33 dollars à 14,54 dollars. Mais le 28 juin 1979, une nouvelle conférence de l’OPEP va plus loin encore en décidant la plus forte hausse du prix du baril depuis 1973 : le baril passe à 21 dollars en moyenne.
La crise des otages de l’ambassade américaine de Téhéran à partir de novembre 1979 aggrave encore les choses. Jimmy Carter réplique en décrétant l’embargo sur les importations de pétrole iranien aux États-Unis et le gel de tous les avoirs de Téhéran. Les Iraniens ripostent en refusant aux firmes américaines travaillant dans le pays le droit d’exporter leur pétrole.
Toutefois, la baisse des livraisons est limitée, car elle est compensée par la hausse de la production saoudienne : un impact total de 5 %. Ce qui compte le plus, c’est l’effet psychologique. Les compagnies constituent des stocks qui ne sont pas consommés et augmentent de moitié la pénurie : 10 % de pétrole manquent sur le marché, 5 % du fait de l’Iran, 5 % du fait de l’augmentation des stocks selon l’historien Daniel Yergin.
À partir de 1980, la guerre Iran-Irak entretient un temps les effets du choc. La guerre est déclenchée entre les deux très gros producteurs de la région (ils représentent à eux deux plus du tiers de la production du Golfe) pour un litige territorial : les frontières sur le Chott-el-Arab et les îles de la zone dont les délimitations contestées remontent à un traité bancal signé en 1975 alors que la zone regorge de pétrole. Ajouter à cela une opposition religieuse irréductible : le chiisme iranien contre le sunnisme des dirigeants irakiens.
Au total, 15 % de la production de l’OPEP est retirée du marché. À l’OPEP, le représentant de l’Indonésie doit siéger entre ceux de l’Irak et de l’Iran pour éviter qu’ils en viennent aux mains. À la fin de l’année 1980, le prix moyen du baril de l’OPEP est de 36 dollars. La manne des pétrodollars dépasse les 200 milliards de dollars en 1980.
À la recherche de nouveaux équilibres énergétiques et économiques
Le pétrole joue alors un rôle déstabilisateur, provoquant la première grande crise économique de l’après-1945. Ainsi, pour l’ensemble de l’OCDE, la croissance passe de 5,7 % en 1973 à 0,9 % en 1974 et – 0,5 en 1975. Dans le sillage du pétrole, tous les marchés des matières premières s’envolent (cacao, café, bananes, minerais…) : ce sont les « années folles des matières premières » (Éric Fottorino), ce qui contribue au renchérissement des produits intermédiaires pour les entreprises, en plus des énergies, et précipite une grave crise industrielle et sociale.
La fameuse « crise de 73 », selon l’expression consacrée, mais inexacte, est marquée par la conjonction inédite d’une croissance lente, voire nulle, d’une forte inflation et d’une montée du chômage de masse. En 1981-1982, les pays développés à économie de marché (PDEM) connaissent à nouveau une récession très semblable à celle de 1974-1975, mais moins grave dans l’ensemble. Le recul du PNB n’atteint en moyenne « que » 3 % et le déficit de la balance commerciale n’augmente pas. Quoi qu’il en soit, une trop forte dépendance au pétrole a montré ses effets néfastes, ce qui doit mener à une réorientation pour des raisons économiques.
Les pays occidentaux tentent de s’organiser face aux chocs énergétiques : diversification des sources de pétrole pour abaisser les risques géopolitiques et substitution d’autres sources d’énergie au pétrole (plan Messmer en France pour développer le nucléaire, plan Carter – présenté par le président américain comme l’« équivalent moral d’une guerre »), rationalisation de la consommation d’énergie (« chasse au gaspi »). En ce qui concerne les relations internationales, les États-Unis poussent à la création d’une anti-OPEP (l’Agence internationale de l’énergie), constituent des stocks stratégiques, créent une force d’intervention rapide et consolident leur présence militaire dans l’océan Indien (avec la base de Diego Garcia). En 1981, Ronald Reagan décide de déréglementer totalement le marché de l’énergie.
Grâce à l’AIE, les États-Unis sont rapidement rejoints par les autres membres de l’OCDE en ce qui concerne le charbon et les hydrocarbures : il est possible pour n’importe quel acteur du marché national d’importer n’importe quel produit énergétique provenant de n’importe quel pays (sauf embargo) au meilleur prix possible. Réciproquement, les fournisseurs peuvent vendre au plus offrant. L’OPEP perd ainsi son privilège : le pétrole est mis en concurrence avec d’autres énergies chaque fois que c’est possible ; la disparition des contrats d’approvisionnement à long terme permet à de nouveaux producteurs de s’implanter sur le marché mondial (Royaume-Uni, Norvège, URSS) ou d’y revenir (Mexique). L’Arabie Saoudite se retrouve quasiment seule, car les autres membres de l’OPEP jouent le court terme et s’intègrent clandestinement au pool énergétique mondial par le jeu des dépassements de quotas. Le renversement de la politique saoudienne que concrétise le contre-choc pétrolier de 1985-1986 traduit la victoire des États-Unis.
L’OPEP échoue
En réalité, le second choc pétrolier s’explique par une mauvaise analyse de la situation du marché pétrolier. La hausse du prix du pétrole a conduit à un ralentissement de la hausse de la demande : l’intensité pétrolière et plus largement l’intensité énergétique (c’est-à-dire la quantité de pétrole ou d’énergie nécessaire pour produire un point de PIB) a commencé à diminuer. Parallèlement la prospection et l’exploitation ont repris ; apparaissent sur le marché les « non OPEP » comme le Mexique, la Malaisie ou Oman. La peur de la pénurie n’était qu’un fantasme et les prévisions catastrophiques du club de Rome étaient erronées.
Face à cette situation, les pays de l’OPEP mettent en place un système de quotas : chaque pays dispose d’un quota d’exportation qu’il s’engage à ne pas dépasser ; l’Arabie Saoudite joue le rôle de producteur d’appoint qui fournit la différence entre la demande mondiale adressée à l’OPEP et le total des quotas de ses partenaires de l’OPEP. Mais la production des non-OPEP progresse ce qui réduit la demande adressée à l’OPEP, et surtout de nombreux pays contournent la règle des quotas comme le Koweït ou le Nigeria. Dès lors l’Arabie Saoudite est contrainte de réduire sa production qui chute des trois quarts entre 1980 et 1985. Elle se sacrifie pour sauver le prix du pétrole des autres…
C’est qu’un autre changement majeur est intervenu. Jusqu’en 1973 le prix du pétrole mondial était fixé par les Majors. Ensuite il a été fixé par l’OPEP. De plus en plus ce sont les marchés qui déterminent le prix, qui oscille en fonction du rapport entre l’offre et la demande. L’échec de la politique des quotas démontre que l’OPEP n’a plus les moyens de déterminer seule ce prix. On parle d’une marchéisation du pétrole.
Riyad en tire la conclusion en relevant sa production en 1985. Il s’agit de « punir » ses partenaires de l’OPEP qui n’ont pas respecté les quotas et de chasser du marché une partie des « non-OPEP » : un prix du pétrole faible n’empêchera pas l’Arabie Saoudite de produire puisque ses coûts de production sont parmi les plus faibles du monde, les nouveaux producteurs devraient cesser de produire espère-t-on. Mais la chute du prix du pétrole est gigantesque, ce qui démontre à quel point la peur de la pénurie était excessive : il tombe à 7 dollars le baril ce qui affecte aussi l’Arabie Saoudite. C’est que la production des non-OPEP ne diminue pas autant que prévu. Ces pays (ou les compagnies qui y travaillent) ont déjà effectué les investissements nécessaires au développement de leur production, ils doivent maintenant rembourser les sommes empruntées pour cela, ils continuent donc à produire. Finalement, à la suite de la venue du vice-président Bush, l’Arabie Saoudite relève sa production. Le couple Washington/Riyad réussit à stabiliser le marché pour une dizaine d’années.
Dans ce contexte, l’invasion du Koweït par l’Irak en août 1990 n’a pas de conséquence durable sur le prix du pétrole. Elle est motivée par la volonté de Bagdad de contrôler d’immenses ressources en or noir. Les États-Unis interviennent avec le soutien de l’Arabie Saoudite et mettent fin à l’aventure.
Équateur et Gabon se retirent de l’organisation respectivement en 1992 et 1994. La marge de manœuvre de l’OPEP est de plus en plus étroite : nombre de pays de l’OPEP ne sont jamais parvenus à diversifier leur économie et demeurent très dépendants de la rente pétrolière (on parle d’« intoxication pétrolière »). D’où l’impossibilité de manier efficacement la politique de quotas sous peine de perdre des parts de marché. Arabie Saoudite, Koweït, Iran, Irak, Qatar, Nigeria, Venezuela, Émirats arabes unis ou Algérie réalisent plus de la moitié de leur PIB dans le pétrole et le gaz.
A lire aussi : Les grands marchés de l’énergie aujourd’hui et demain
L’après-pétrole, une illusion ?
Il ne faut pas conclure trop vite à un renversement de l’ordre énergétique mondial, pour trois raisons.
Primo, les États-Unis, bien qu’ils soient directement visés par les chocs énergétiques, sont en fait peu touchés : le pétrole importé du Golfe ne représente que 5 à 6 % des besoins globaux du pays. Les avantages tirés de la crise dépassent les inconvénients sur le plan économique : le choc pétrolier donne un coup de fouet à la production nationale (freinée jusqu’ici par des frais d’extraction 10 à 20 fois supérieurs à ceux du Golfe), il renforce les positions économiques des entreprises américaines à terme en diminuant la compétitivité des firmes industrielles européennes et japonaises ; surtout, les profits des Majors explosent, les nouveaux contrats signés avec les pays producteurs, bien que moins juteux sur le papier, ne les désavantagent pas du fait de l’explosion des prix : les cinq premières Majors voient leur chiffre d’affaires passer de 195 milliards de dollars en 1978 à 285 milliards de dollars en 1988.
Secundo, les États producteurs qui amassent une quantité phénoménale de pétrodollars les recyclent en grande partie dans les circuits de la finance internationale, via les grandes banques d’affaires, ce qui contribue à entretenir l’investissement et la croissance dans les pays de l’OCDE. Les pétrodollars sont ainsi un levier de la mondialisation économique dans les années 1980 sur fond de déréglementation des marchés qui facilite la concurrence et la baisse des prix.
Tertio, les entreprises des pays occidentaux augmentent le prix final des produits manufacturés pour répercuter la hausse du prix des matières premières, ce qui pèse sur les balances commerciales des pays en développement, tout en accélérant également l’inflation dans les pays riches. En fait, les pays les plus lésés sont les pays en développement qui disposent de trop peu (ou de pas du tout) de pétrole.
Ainsi, le pétrole n’est pas détrôné. Beaucoup de monde peut gagner dans ce marché gigantesque et donc a intérêt au statu quo. Le pétrole représente 2 300 milliards de dollars de revenus annuels, des dizaines de millions d’emplois dans le monde, 40 % du trafic de marchandises mondial. La rente pétrolière est souvent vitale pour les producteurs, mais il faut souligner que le pétrole génère pour les États des pays consommateurs des rentrées fiscales également colossales, via des prélèvements (comme en France la TIPP, taxe intérieure sur les produits pétroliers) que l’on évalue dans le monde à quelque 1 500 milliards d’euros (« surplus pétrolier »).
Ainsi, la production mondiale de pétrole a augmenté d’un milliard de tonnes entre le milieu des années 1970 et le milieu des années 2000, et ce malgré un fort relèvement des prix, passant d’environ 2,8 à 3,8 milliards de tonnes. À la fin du xxe siècle, on produit plus de 3 milliards de tonnes par an et la capacité de raffinage mondial est d’environ 80 millions de barils par jour. Les réserves exploitables sont alors évaluées à environ 45 ans de production. Les forages très profonds, entre 700 et 3 000 mètres, sont rentabilisés par la hausse des prix et se développent surtout à partir des années 1990. Entre 1980 et 2000, les réserves prouvées de pétrole ont augmenté de presque 80 %.
Priorité aux économies et aux énergies d’appoint
La transition énergétique ne s’amorce que timidement. Le charbon connaît un début de résurrection, les énergies vertes un début d’émergence et le gaz naturel un développement désormais plus rapide que le pétrole, avec des réserves plus abondantes et de grands progrès technologiques permettant d’exploiter le gaz de schiste. Toutefois les marchés se développent essentiellement à l’échelle régionale et la localisation des gisements demeure dans les zones à risques, comme le pétrole.
Dans le secteur des transports, gros consommateur de pétrole, plusieurs solutions se développent à la fin du xxe siècle : véhicules fonctionnant à l’électricité, au gaz de pétrole liquéfié (GPL), au gaz naturel (GNV), avec des moteurs hybrides (électricité + carburants), à pile à combustible (sur le principe d’une réaction chimique inverse à l’électrolyse de l’eau produisant du courant électrique).
Et les biocarburants (ou agrocarburants, voir encadré), de deux types : 1/. Éthanol ou bioéthanol, alcool obtenu à partir de la fermentation du sucre, produit avec des plantes riches en sucre (betterave, canne à sucre) ou en amidon (maïs, pomme de terre) ; il est combiné avec des carburants dans des proportions allant de 5 % (Europe) à 25 % (Brésil). 2/. Biodiesel ou diester, carburant principalement tiré du colza ; il est déjà un composant du gazole à hauteur de 5 %, mais peut être utilisé dans des proportions bien supérieures. Le bioéthanol est produit et consommé essentiellement au Brésil et aux États-Unis (respectivement 50 % et 35 % du marché), l’Europe est leader pour le biodiesel. Ces produits permettent de réduire les importations de pétrole, de moins polluer et de régler le problème des jachères agricoles. Ces solutions coûtent cher, mais deviennent rentables avec un baril de pétrole supérieur à 40-50 dollars. Au cours du xxe siècle donc, on observe une première « transition énergétique » qui mène du règne du charbon à celui pétrole mais, quoi qu’il en soit, ce sont les énergies fossiles qui dominent et sont mises au service du développement économique et social, de la transformation des territoires, mais également de la puissance.