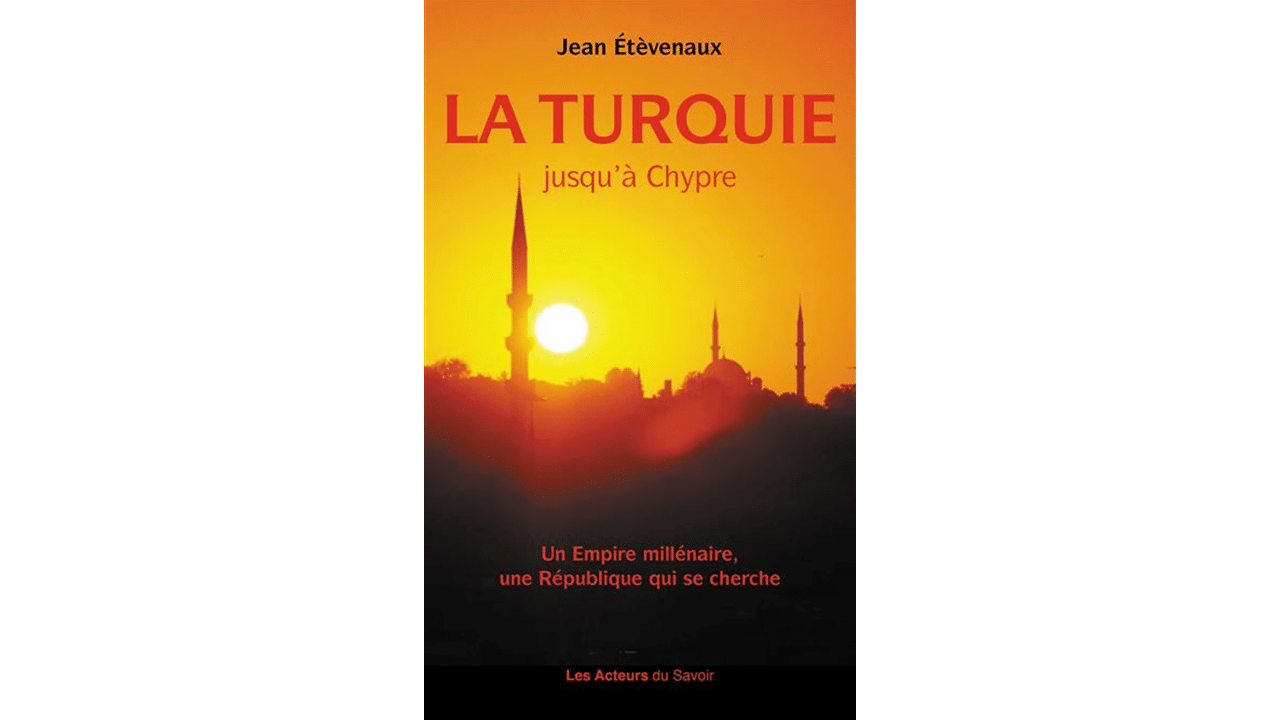La fin de la guerre froide, loin de marquer la « fin de l’Histoire », a rendu à nouveau les conflits possibles en éloignant la menace d’un dérapage nucléaire. Le Moyen-Orient, région instable presque par nature, semble le champ clos idéal du nouvel ordre mondial puisque dès 1991 s’y livre une guerre « classique », sans recours aux armes atomiques, pour libérer le Koweït de l’occupation irakienne.
Cet affrontement conventionnel avait tout – sauf sa localisation ! – du western : un méchant bien identifié (et moustachu), un terrain dégagé, non discriminant (le désert), une large coalition de « gentils » agissant sur mandat du « shérif » onusien… Et comme la supériorité technologique, sinon numérique, des gentils était écrasante, malgré le faux suspense entretenu par les médias autour de la prétendue « troisième armée du monde », l’issue ne faisait guère de doute. Seule l’ampleur de la défaite politique irakienne était incertaine, Saddam Hussein réussissant à limiter la casse et à se maintenir au pouvoir plus d’une décennie.
Un western en Orient
Il fallut donc une seconde intervention en 2003, non validée par l’ONU cette fois, pour que les États-Unis parviennent à éliminer le dictateur irakien. Mais l’armée irakienne rapidement surclassée, les Américains et leurs alliés furent confrontés à un conflit beaucoup plus significatif des guerres actuelles et à venir : asymétriques, urbaines et « civilisationnelles ».
La (ou les) bataille(s) de Falloujah incarne(nt) bien cette triple dimension : cette ville moyenne (environ 300 000 habitants aujourd’hui), parfois surnommée la « ville des mosquées », située presque exactement au centre de l’Irak, au cœur du « triangle sunnite », fut un noyau de résistance au pouvoir baasiste laïc du temps de Saddam Hussein, et se mua au début de l’année 2004 en foyer de résistance à l’occupation étrangère et au nouveau gouvernement, dominé par les chiites, majoritaires. En mars, en effet, quatre Américains de la firme de sécurité Blackwater sont lynchés par la foule, leurs corps traînés dans les rues et exhibés sur un pont, traitement rappelant aux Américains le douloureux souvenir de l’équipage de l’hélicoptère Blackhawk massacré à Mogadiscio (Somalie) en 1993.
La réaction ne se fait pas attendre : la 1re division de Marines encercle la ville et engage sa reconquête en avril, mais finit par renoncer au vu de l’émotion suscitée par l’ampleur des pertes civiles « collatérales » liées notamment au soutien aérien – et de la débandade des deux bataillons irakiens qui l’accompagnent, qui désertent, voire rallient les insurgés.
Ce n’était que partie remise : en novembre, la réoccupation de Falloujah reprend avec un rapport de force très favorable (trois contre un environ en ne comptant que les forces américaines). Elle s’achève début décembre sur un bilan positif, tant géographique – la ville est repassée sous le contrôle de la coalition et du gouvernement légal – qu’humain (à peine 100 morts du côté de la coalition, plus de 2 000 chez les insurgés).
A lire aussi: « Nous allons vous faire le pire des cadeaux : nous allons vous priver d’ennemi ! »
Le récit événementiel n’est pas des plus passionnants, puisqu’il s’agit d’un siège et d’un « nettoyage » méthodique des môles de résistance constitués par une guérilla irakienne plus ou moins fédérée, allant des fidèles de Saddam Hussein à des mouvements djihadistes parfois nourris de volontaires étrangers (dont des Français). Ce qui ne veut pas dire que tout y fut affaire de moyens et de logistique : le commandement américain, qui a pris la peine de prévenir la population pour l’inciter à quitter la ville, réussit pourtant à surprendre ses adversaires en attaquant par le nord alors que la préparation aérienne la plus intense avait visé le sud ; la maîtrise tactique du iiie Corps américain dans le combat urbain fut décisive, ainsi qu’une organisation sans faille – préparation d’artillerie ou aérienne systématique, arrêt de la progression et mise en défense avant la tombée de la nuit, débriefing quotidien…
Le terrain choisi est aussi emblématique : le milieu urbain est bien plus propice à un défi « du faible au fort » que la campagne
La fin des batailles
Plutôt que la fin de la guerre, l’ère nouvelle est marquée par la fin des batailles, et singulièrement des batailles « décisives ». Dans les guerres asymétriques, caractérisées par une forte disproportion de puissance mais aussi de statut institutionnel (un État ou une coalition face à un ennemi plus ou moins nébuleux), le « faible » évite la confrontation directe, au profit d’une stratégie d’attrition à la fois physique et morale : plus un matériel est sophistiqué, plus il réclame un important effort logistique et plus vite il s’use ; de même, les combattants habitués à un certain confort et soutien n’ont pas aisément l’avantage face à des ennemis plus « rustiques » et furtifs, et les opinions habituées à la paix supportent mal la guerre et son cortège de morts et d’images violentes.
Le terrain choisi est aussi emblématique : le milieu urbain est bien plus propice à un défi « du faible au fort » que la campagne. L’écart de puissance est moins sensible, la guérilla peut préparer des réseaux souterrains reliant des points fortifiés, des caches d’armes… qui sont l’équivalent des tranchées en campagne mais avec l’avantage d’être dissimulées au regard et, dans une certaine mesure, aux frappes d’artillerie ou aériennes.
De Sarajevo à Falloujah ou au Donbass, le « sniper » (tireur d’élite) est ainsi devenu un combattant clé, dans la défense comme dans l’attaque : le milieu urbain lui permet d’échapper au repérage grâce à la portée des fusils modernes et de frapper durement grâce à la puissance de certaines munitions (fusils de calibre 12,7 mm, voire 20 mm, par exemple, capable de perforer des blindages légers ou de traverser des murs même à grande distance). À Falloujah, Chris Kyle (1), des Navy Seals, est crédité de quelque 40 tirs meurtriers.

Un soldat américain à Falloujah © Wikipedia. Auteur: Nicoleon
La dimension civilisationnelle de la guerre : la technique contre la foi
D’autant que, comme le révolutionnaire de Mao Zedong, le combattant de guérilla est au milieu de la population « comme un poisson dans l’eau » ; le « fort » ne peut donc utiliser toute sa puissance sans atteindre les civils, ce qui est moralement inacceptable. Nous touchons là à la dimension « civilisationnelle » : la vie humaine est « sanctuarisée » aux yeux des Occidentaux, à quelque camp qu’elle appartienne, ce qui est moins vrai dans des sociétés où l’opinion est moins aisément mobilisable, et plus du tout pour des groupes fanatisés, que ce soit pour des causes religieuses ou idéologiques.
A lire aussi: Irak, la guerre par procuration des États-Unis
Falloujah est une préfiguration de ce qui attend les Américains s’ils persistent à se considérer comme un modèle universel – ce qui a pu être vrai ou justifié du temps de la guerre froide, quand la polarité était politique, mais ne l’est plus dans un monde dont la multipolarité est avant tout économique et culturelle : des guerres ingagnables, des demi-victoires (beaucoup d’insurgés ont pu s’échapper et les attentats ne cessent pas à Falloujah, ni surtout dans la province alentour qui échappe à tout contrôle en 2006), une hostilité latente propice à des explosions au gré des « scandales » (torture, tromperie sur les motivations, frappes aveugles et meurtrières…). Et la « guerre à distance », grâce aux drones et autres satellites, n’est sans doute pas une réponse pertinente pour pallier l’impuissance croissante du « big stick », car si elle anesthésie les opinions occidentales, elle est vue comme un signe de lâcheté dans des sociétés où on sait encore qu’un « poilu » n’était pas un soldat crasseux mais un homme courageux et viril – un homme, un vrai, en somme.
- Il revendique 255 tirs mortels durant toute la guerre d’Irak, le Pentagone n’en confirmant que 160, ce qui fait tout de même de lui le sniper le plus efficace de l’histoire américaine. Son autobiographie, American Sniper, a été adaptée au cinéma par Clint Eastwood.