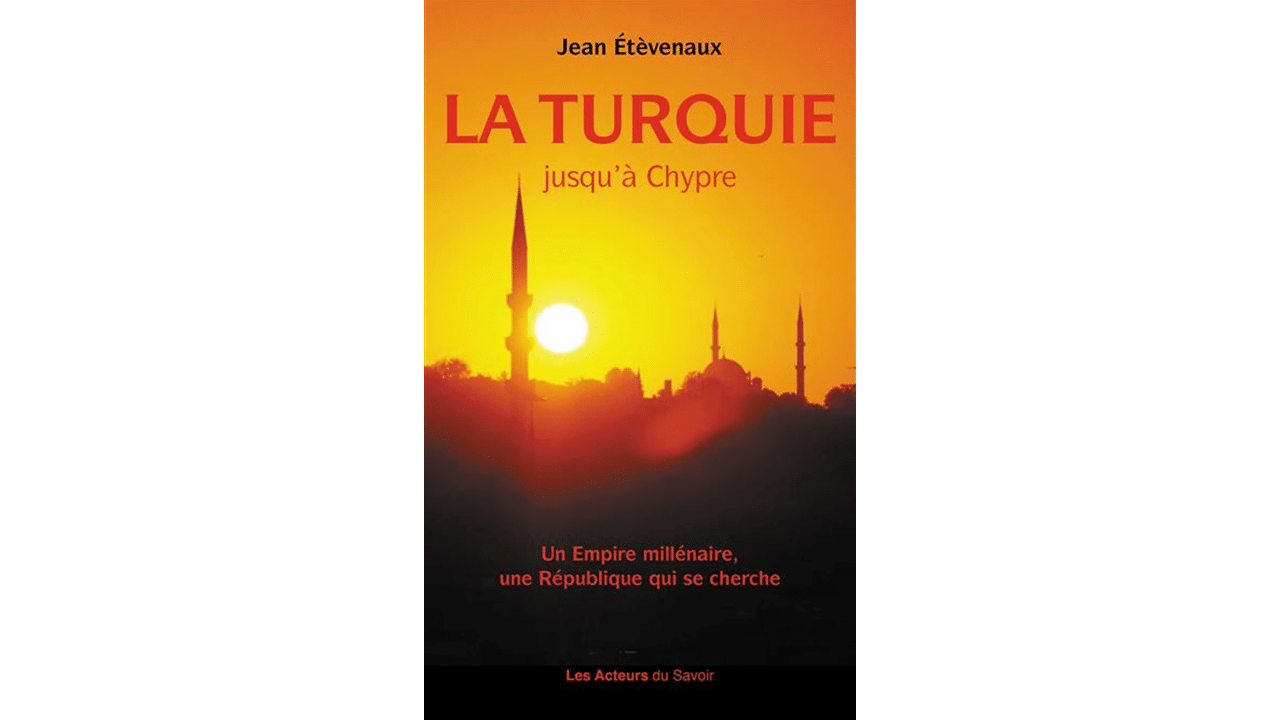Iran, Irak, Syrie, Liban : ces quatre États ont en commun de faire partie d’un axe géopolitique cohérent, d’un « croissant chiite » qui, entre volonté de composer un frein à toutes formes d’hégémonisme sunnite ou occidental et nécessité d’unifier une branche minoritaire de l’islam pour lui conférer une place de choix sur l’échiquier international, s’impose comme une réalité géopolitique.
S’interroger sur la réalité ou le mythe de l’existence d’un « croissant chiite » au Moyen-Orient est une opération complexe, car elle oblige à prendre en compte bien des paramètres et des données dans le but de mieux appréhender ce qui est pour certain, une théorie fantasmatique et pour d’autres, une réalité géopolitique incontestable. Du Pakistan à la Méditerranée et de la Syrie au Yémen, cet arc géographique évoque le rassemblement solidaire des chiites face aux États sunnites souvent ralliés aux intérêts occidentaux. Expression théorisée par le roi de Jordanie, Abdallah II, le 8 décembre 2004 dans un entretien accordé au Washington Post, elle s’apparente donc à une réalité autant religieuse que géopolitique bien qu’elle demeure comme forgée par les adversaires du chiisme en général, et de l’Iran en particulier, pour en faire un objet politique hostile aux intérêts sunnites, car parrainé et soumis à Téhéran. Deux ans plus tard, le 8 avril 2006, dans un entretien à la chaîne al-Arabiya, le président égyptien Hosni Moubarak mettra également en garde contre la construction d’un tel arc chiite. En quelques années, la théorie d’un chiisme instrumentalisé par l’Iran avait fait le tour du Moyen-Orient.
Un « croissant chiite » va progressivement se former en rassemblant les déçus des politiques sunnites et de la montée en puissance des États du Golfe, porteurs d’intérêts que les chiites considèrent comme contraire à ceux de la communauté musulmane. La prise de pouvoir par un alaouite, Hafez al -Assad, en Syrie en 1970, la création du « mouvement des déshérités » et de sa branche armée, Amal, par le prédicateur libanais Moussa Sader, en 1974, mais surtout le retour d’exil de l’ayatollah Ali Khomeiny en Iran, le 1er février 1979, peuvent apparaitre comme les principaux marqueurs d’une renaissance chiite et de sa politisation au Moyen-Orient.
Si la religion est un facteur explicatif d’un tel « croissant » autant qu’elle s’apparente à un vecteur d’unité, du moins d’alliances stratégiques, entre les chiites du Moyen-Orient, elle n’est pas la seule composante de cet axe. Intérêts territoriaux et énergétiques, mais aussi partenariats géoéconomiques entrent également en ligne de compte. Si une part d’idéologie y a naturellement cours, notamment par le biais de l’exportation de la révolution iranienne au monde chiite, une vision réaliste de la géopolitique permet de mieux concevoir les intérêts de ceux qui promeuvent ou dénoncent un tel « croissant » qui s’apparente aussi, et de plus en plus, à un frein à toute forme d’hégémonisme occidental au Moyen-Orient.
A lire aussi : Iran : quel futur pour la crise islamiste ?
L’Iran, pierre d’achoppement du « croissant chiite »
11 février 1979 : coup de tonnerre en Iran. La même année où le sunnite et nationaliste arabe Saddam Hussein arrive au pouvoir en Irak, l’ayatollah Khomeiny proclame la fin de l’empire et l’instauration d’une République islamique dont il deviendrait le « juriste-guide » suprême. Le peuple iranien, toutes classes ou religions confondues, a renversé Reza Pahlavi, Shah qui leur apparait comme trop docile aux intérêts des États-Unis. Le souvenir de l’opération Ajax en 1953, coup d’état monté par la CIA dans le but de faire tomber le Premier ministre Mossadegh, car trop « nationaliste » aux yeux de l’Occident, reste gravé dans les esprits. Quinze ans plus tard, l’Iran souhaite effacer toute trace d’une présence étrangère et acclame, comme un sauveur, le retour d’exil de l’Ayatollah le 1er février 1979. La monarchie laisse place à une théocratie, teintée de démocratie et d’autocratie. Comme une réponse à Georges W. Bush qui, en 2002, plaçait l’Iran et son voisin irakien dans « l’Axe du mal », le Guide suprême, tête religieuse et, de fait, politique, de la nouvelle République islamique, désigne l’Occident et ses alliés orientaux comme ennemis publics.

L’actuel guide suprême de la Révolution islamique, l’Ayatollah Khamenei, le 22 mai 2020. AP22457607_000002 Photo : /AP/SIPA
Exporter la révolution : tel semble être le mot d’ordre, du moins l’un des objectifs, de la diplomatie iranienne au Moyen-Orient. Téhéran se veut, en effet, parrain de l’émancipation sociale, politique et géopolitique des chiites. Si les premiers véritables mouvements révolutionnaires chiites, entendant imposer la théocratie par la politisation du clergé et émanciper une frange de l’islam qui se revendique comme persécutée et mis à l’écart de la société, naissent en Irak dans les années 1950, c’est surtout en Iran qu’elles se développent. Les manifestations de 1979 à La Mecque ou dans la province saoudienne de Hasa, mais surtout le printemps arabe de 2011 à Bahreïn, révolte chiite écrasée par l’Arabie saoudite, témoignent de cette volonté iranienne de libérer les chiites minoritaires des pays sunnites que leurs adversaires dépeignent comme occidentalisés. Par-là, l’Iran cherche aussi à installer ses pions pour maintenir son rang de puissance régionale. Raisonnent logique de tout État.
L’Iran peut légitimement se maintenir comme principale porteuse des intérêts chiites au Moyen-Orient, car, depuis le XVIe siècle avec le Shah Ismaël Ier, c’est le seul pays à avoir fait du chiisme duodécimain sa religion officielle. Une décision qui s’est ensuite étendue à l’Empire safavide. Dans une moindre mesure et dans le but de renforcer sa place dans la région, l’Iran marche donc dans les pas de l’empire et cherche, en ce sens, et pour s’opposer aux puissances sunnites, saoudiennes au premier chef, que l’Iran accuse d’être parrainées par les États-Unis, à unir les chiites de l’espace moyen-oriental. De l’Iran au Liban, en passant par l’Irak et la Syrie, et pouvant s’étendre jusqu’aux rebelles houthistes du Yémen, cet axe est une réalité géopolitique. Répartis entre l’Iran, la Mésopotamie irakienne, la Syrie, le Liban, la bande côtière de l’Est saoudien, le Koweït, Bahreïn, le Qatar, les Émirats arabes unis, le Kurdistan du sud syrien et le Yémen, cette frange minoritaire de l’Islam détient, sans le vouloir, une unité et une puissance avalisée, certes, à Téhéran, mais garantie par elle.
Le fait qu’une grande majorité des oulémas chiites du Moyen-Orient se forment en Irak, à Nadjaf et Kerbala ou en Iran, à Qom notamment, démontre combien la République islamique, outre le fait qu’elle possède une influence considérable sur le « croissant », est le terreau de la formation des clercs chiites et entretient, en ce sens, l’exportation des préceptes et valeurs de la révolution iranienne. Un outil de soft power qui n’est, dans cet espace, aucunement négligeable. Le fait que cet arc chiite se confonde également avec les routes d’exportations des hydrocarbures, base économique des Etats qui le compose et instrument géopolitique principal de l’Iran, rend son étude plus attrayante tant les facteurs énergétiques, clés de compréhension de bien des conflits dans cette région, entrent en ligne de compte. À eux seuls l’Irak, la zone chiite de l’Arabie saoudite et l’Iran totalisent près de 18% de la production mondiale de pétrole, ce qui est considérable.
Maintenir un semblant d’unité entre les chiites du Moyen-Orient par une « géopolitique confessionnelle », entretenir des pressions sur l’Arabie saoudite et Israël en exportant la révolution, tels sont les objectifs de Téhéran. À l’aune de ces critères, les alliances avec les voisins irakiens, syriens, libanais et yéménites prennent tout leur sens. Si le Guide suprême demeure la clé de voute de l’architecture institutionnelle de la République islamique, il est donc aussi la pierre angulaire de ce « croissant chiite » tant il l’entretient et garantit sa pérennité. Le rapprochement avec l’Irak, survenu à la suite de l’intervention américaine en 2003, qui vit la destruction de l’État sunnite irakien et du parti nationaliste arabe Baas, repose sur deux éléments : le maintien au pouvoir des chiites, désireux de s’émanciper de la tutelle sunnite qui a cours depuis les Abbassides (VIIe siècle), et l’instabilité chronique de cette région qui, aux prises avec les séparatismes identitaires, l’État islamique et une présence américaine de plus en plus contestée, reste fragiles et en recherche d’un protecteur.
A lire aussi : Iran : les craintes d’une explosion sociale
D’autre part, l’Iran entretient un dialogue conséquent avec les alaouites de Damas qui, au sein de l’alliance russo-irano-syrienne, permet à Téhéran, hier d’enclaver l’Irak sunnite, mais aujourd’hui d’asseoir son influence en Syrie, de faire de cet État une base arrière pour les alliés du Hezbollah libanais et d’y apparaitre comme un acteur indispensable à la résolution du conflit. Le « Parti de Dieu », Hezbollah, permet également à l’Iran de maintenir une pression constante sur l’adversaire israélien et de garder le Liban sous influence. Depuis le Pacte national de 1943, qui régit la politique libanaise selon des principes démographiques, cette donnée a grandement évolué. Les chiites grandissant numériquement, leur poids n’en est que plus important, ce qui profite à Téhéran pour lequel le Hezbollah demeure un véritable instrument sous influence. C’est d’ailleurs cet élément, parmi d’autres, qui a vu le départ du Premier ministre Saad Hariri, car son sunnisme affirmé et sa volonté de s’émanciper des tutelles iraniennes et syriennes a obligé le Président Aoun, proche de Téhéran, de s’en séparer. C’est enfin au Yémen que la présence de Téhéran se fait sentir durablement. L’aide aux rebelles houthistes lui permet de maintenir un état de tension au sud de l’Arabie saoudite, ennemi prioritaire de la République islamique. Autant d’alliances qui, entre nécessités géopolitiques, exigences stratégiques, rapprochements pragmatiques et partenariats historiques, répondent tous au même mot d’ordre : faire du chiisme un nouvel acteur au Moyen-Orient.

Téhéran, Iran ; des soldats crient des slogans pour l’anniversaire de la révolution islamique de 1979, le 1er février 2020. 00943108_000002
Photo : CHINE NOUVELLE/SIPA
Un arc hétérogène, cristallisation de « l’Orient compliqué »
Si le chiisme permet de rassembler et unir un peuple, comme le démontre le cas iranien, l’arc sur lequel il est majoritaire n’en est pas pour autant homogène, et ce, à bien des égards.
Comme l’illustre le fait que la révolution iranienne fut d’abord populaire puis accaparée par les religieux, le clergé chiite iranien entend se servir des révoltes locales pour entretenir son rêve d’exportation de la révolution. Mais cela ne fait pas forcément bon accueil, car, comme souvent, les intérêts politiques prennent le pas sur les accointances religieuses ou culturelles. Sans entrer dans des considérations théologiques, le premier point de dissension qui apparait dans la compréhension de ce « croissant » est, sans nul doute, la diversité même du chiisme. En effet, si le courant duodécimain prédomine en Iran, en Mésopotamie, dans le sud-est de l’Irak, en Afghanistan, en Azerbaïdjan, au Liban, dans l’Est de l’Arabie saoudite, au Koweït et à Bahreïn, l’ismaélisme est présent au Liban, les alaouites ont le pouvoir en Syrie, l’alévisme a bonne presse dans le Sud de la Turquie et les zaydites forment la majorité des chiites du Yémen. Cette hétérogénéité démontre que l’intitulé même du sujet n’est pas sans créer, dès son énoncé, bien des oppositions. Il en va de même du point de vue ethnique, car, là aussi, des différences peuvent être signalées ; en effet, si les chiites iraniens sont majoritairement perses, ceux irakiens, syriens ou libanais, mais aussi du Golfe sont arabes, par exemple, ce qui n’est pas sans créer de dissensions. La guerre Iran-Irak a vu, à titre d’exemple, se cristalliser ces différences, car, si la Syrie s’est ralliée à Téhéran, les pays sunnites et chiites du Golfe ont apporté leur soutien à Bagdad. Bien souvent, l’identité, ici l’arabité, outrepasse la religion.
D’autre part, notons que les chiites de cet arc ne sont pas tous inféodés à Téhéran comme le laissait entendre, en 2004, le monarque jordanien. Si le soft power iranien demeure une réalité au sein du « croissant », les chiites irakiens, par exemple, ont fait primer leur arabité et leur identité durant la guerre qui les a opposées à l’Iran entre 1980 et 1988 et se sont ralliés à Saddam Hussein. D’autre part et si les chiites sont aujourd’hui majoritaires en Irak, l’ayatollah al-Sistani (d’origine iranienne), autorité religieuse suprême du pays, entend garder sa liberté et entretient un discours nationaliste arabe, élément repris et matérialisé par le mouvement chiite de Moqtada al-Sadr. De plus, l’Iran, qui se veut porteur d’une alliance chiite internationale, accorde aussi son aide, et ce de manière pragmatique, aux sunnites du Hamas palestinien dans leur lutte contre Israël, ce qui démontre que le « croissant » est, en réalité, un partenariat stratégique plus qu’une coalition religieuse. Autre illustration, le fait que l’Iran ait pris le parti des chrétiens arméniens face aux chiites azéris, sous prétexte que ceux-ci entretiendraient des liens trop étroits avec la Turquie et permettraient aux Azéris du Nord de la République islamique de faire sécession. Ainsi et comme le rappelle le géographe Bernard Hourcade, le terme « archipel » serait sans doute plus adéquat pour qualifier cet axe chiite tant les dissensions internes vont grandissantes.
Mais revenons un instant sur le cas irakien qui, instable, car politiquement fragile, n’est pas sans déstabiliser cet « arc ». À titre de nouvel exemple qui vient illustrer les dissensions internes à ce jeune État chiite en quête d’affirmation identitaire, le Parlement du pays vote, début janvier 2020, le départ des Américains, alors même que les sunnites et les Kurdes n’ont pas pris part à ce scrutin, ce qui pourrait laisser penser à une division sur ce sujet sensible et, qui plus est, essentiel à la stratégie iranienne dans la région. D’autre part, les manifestations de l’automne dernier, dirigées contre l’attentisme du Gouvernement, ont aussi mis en avant une volonté populaire de s’émanciper de l’influence iranienne. L’ambassade de Téhéran à Bagdad en a ressenti quelques effets. L’Irak, grand pays chiite de demain et concurrent de l’Iran ?
Enfin, la position turque demeure celle qui cristallise l’hétérogénéité de l’arc chiite. Si Ankara reste opposée au régime de Damas, elle entretient des relations cordiales avec Téhéran sur la question syrienne et yéménite. Pays sunnites qui, par ailleurs, s’étaient élevés contre les sanctions américaines imposées à l’Iran en 2018, la Turquie participe donc, inconsciemment sans doute, au désagrégement géopolitique du « croissant » par ses combinaisons d’alliance pragmatiques.
Militairement et économiquement affaibli, l’Iran se cherche également des alliés en direction de la Russie ou de la Chine. Le rapprochement entre l’Iran, la Syrie et la Russie témoigne de ces excroissances du « croissant chiite » qui, de plus en plus, se conçoit comme un véritable frein à l’expansion de l’influence occidentale en Orient plus que comme un axe religieux permettant aux chiites de s’unir sous la bannière de Téhéran. La Russie et l’Iran ont, en effet, nombre de points communs qui les rapprochent et ouvrent ledit « croissant » à d’autres partenariats stratégiques : le fait que ces deux États soient aujourd’hui sous sanctions internationales, qu’ils se sentent comme « encerclés » par l’Occident et se perçoivent, en ce sens, comme les hérauts d’un antioccidentalisme parfois primaire, qu’ils soient d’accord sur le statut juridique complexe de la mer Caspienne, qu’ils s’opposent au développement du fondamentalisme islamique et des séparatismes locaux et qu’ils se rapprochent sur le cas de l’Arménie ou de la Syrie permet au « croissant chiite », porté par Téhéran, de prendre une envergure plus importante. À ce titre, Moscou pourrait-elle prétendre à devenir un nouveau parrain de cet axe géopolitique ? Les liens qu’elle entretient avec Téhéran ou Damas, comme nous venons de le voir, mais aussi avec Bagdad, comme l’illustre le fait qu’elle investit dans le champ pétrolier de Bassora depuis 2014, lui permet de prendre une certaine ascendance sur ces alliés chiites. Mais gardons à l’esprit que la diplomatie russe se veut, avant tout, porteuse d’un monde multipolaire, entend maintenir un certain équilibre dans sa géopolitique au Moyen-Orient et s’attachera à conserver un statut, enviable à bien des égards, d’acteur incontournable, car capable de dialoguer avec tous.
A lire aussi : Du pétrole, des missiles et le chiisme : les fondements de la puissance iranienne
Mais ce qui demeure comme le liant de l’arc chiite reste, aujourd’hui, l’opposition aux États-Unis et, donc, à leurs alliés au Moyen-Orient. Le conflit larvé entre l’Iran et les États-Unis permet, en effet, d’unir les chiites et plus encore, de les rallier à la politique de Téhéran. Les attaques répondant aux attaques, la mort du général iranien Qassem Soleimani, stratège des opérations extérieures de la République islamique, entretient cette logique. Alors que beaucoup voyait en cet acte une « déclaration de guerre » américaine, il n’est, en réalité, qu’une confrontation de plus qui profite à la cohésion nationale iranienne et au rassemblement des chiites derrière leur « grand frère », seul capable de les défendre et de mener une lutte efficace contre l’adversaire américain.

Paris, plusuieurs centaine de personnes ont manifestes contre la guerre Etat-Unis VS Iran. France le 25 janvier 2020. 00942047_000002
Photo : SEVGI/SIPA
Et en face, le « bloc » sunnite ?
Nous l’avons bien compris, le but de l’Iran est de stabiliser, voire de satelliser, son « étranger proche » et d’y bâtir un périmètre de sécurité chiite où elle puisse y disposer ses pions et y exercer son influence. En puissance régionale, elle se pense tout d’abord comme acteur majeur du Moyen-Orient et utilise les ressources qui sont à sa disposition, le chiisme au premier chef, pour y accroitre sa prépondérance.
Face à ce « croissant chiite », en réalité plus fantasmé que réaliste, un autre axe, mais sunnite cette fois-ci, peut également être mis en avant entre les monarchies du Golfe, et ce, sous le parrainage bienveillant de l’Occident. Soutenus par la stratégie américaine d’investissement du Moyen-Orient, les États sunnites du Golfe s’attachent à endiguer l’influence iranienne dans la région et c’est l’Arabie saoudite, puissance sunnite et gardienne des lieux saints, qui entend porter un tel projet. À ce stade de la réflexion, il nous est possible de nous rappeler qu’au-delà de la division chiites-sunnites et des oppositions géopolitiques et énergétiques qui ont cours entre ces deux pays, c’est également sur le plan purement politique que s’opposent Riyad et Téhéran. En effet, nous avons d’un côté une monarchie arabe, à peine centenaire, fidèle alliée des États-Unis et défenseuse des intérêts sunnites et de l’autre, un État héritier d’un des plus grands et des plus anciens empires du monde, république majoritairement perse, principalement chiite et qui voit dans l’Occident un adversaire à éradiquer.
Si le Moyen-Orient demeure majoritairement sunnite, trois problématiques permettent néanmoins de relativiser la potentielle constitution d’un arc sunnite : les différences internes entre ces mêmes États sunnites, le retrait (très) progressif des Occidentaux de la région et le cas israélien.
À l’instar de leurs concurrents ou rivaux chiites, les pays sunnites, en particulier du Golfe, ne disposent pas tous de la même diplomatie à l’égard du « croissant chiite » en général, et de l’Iran en particulier, car leurs intérêts dans cette opposition demeurent sinon contradictoires, du moins distincts les uns des autres. Comme nous l’avons vu, l’Arabie saoudite wahhabite se veut être la principale opposante à l’Iran et ses alliés libanais, houthistes ou syriens. Le conflit syrien est, en effet, devenu le théâtre des affrontements irano-saoudiens : d’un côté l’Iran, ses alliés chiites et son partenaire russe, de l’autre, la coalition internationale dont font partie nombre d’États sunnites tels que l’Arabie saoudite, la Turquie et les monarchies du Golfe. Mais cette homogénéité de façade laisse paraitre, dans bien des circonstances, nombre de différences et de dissensions entre les opposants du « croissant chiite » : l’affaire Khashoggi a permis de mettre en avant l’opposition entre Saoudiens et Turcs, forme de tension liée au conflit d’influences auquel se prêtent ces deux États concurrents à la prééminence sur le monde sunnite ; le conflit opposant cette même Turquie, majoritairement sunnite, aux Kurdes de la même confession ; le double-jeu des Émirats arabes unis qui, bien que sunnites et proches des intérêts saoudiens, entendent maintenir, Dubaï au premier chef, leurs relations commerciales avec Téhéran qui demeure, par ailleurs, son deuxième client économique ; la crise qui a opposé les Riyad, Abou Dabi et Manama à Doha en 2017 sur la question des Frères musulmans, de la présence turque dans le pays (base d’Incirlik) et des complaisances du Qatar à l’égard de l’Iran ; le rapprochement conséquent entre Oman et Israël ; autant d’exemples qui cultivent ces différences internes au sunnisme.
Deuxième problématique : le retrait, tempéré certes, mais réel, des États-Unis du Moyen-Orient. En effet, le fait que le camp occidental, mené par les États-Unis, se retire progressivement de la région restreint leur soutien aux sunnites. Indépendant en pétrole et souhaitant concrétiser la stratégie du « pivot vers l’Est » instiguée par Barak Obama, Washington n’apparaît plus comme l’allié indéfectible et assidu des monarchies du Golfe, ce qui porte un coup au poids et à l’unité du sunnisme dans cet espace du globe. Le temps de l’intervention en Irak, pour sécuriser les routes de trafic pétrolier et protéger Israël face au nationalisme arabe de Saddam Hussein, semble loin. Mais les États-Unis garderont sans doute la volonté de contrôler les routes pétrolières, stratégie classique en géopolitique, et se devront, en ce sens, de maintenir une présence au Moyen-Orient.
Troisième source de dissension, le cas d’Israël. Si les États-Unis de Donald Trump demeurent un fidèle allié de l’État hébreu, en témoigne le fait que Mike Pompeo ait avalisé, récemment, l’annexion de la Cisjordanie par les Israéliens, ce qui révolte l’ensemble des pays moyen-orientaux, la diplomatie menée par Israël est certes anti-chiite, mais va également à l’encontre des intérêts sunnites. Si elle entretient des relations cordiales avec Oman, depuis 2018 comme nous l’avons vu, ou la Jordanie, depuis l’accord de 1994, les puissances sunnites du Moyen-Orient s’opposent à elle sur le dossier palestinien principalement. Le Koweït, Bahreïn, Oman, le Qatar, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ne reconnaissent en effet pas l’État hébreu qui leur apparait comme trop offensif à l’égard de leurs « frères » palestiniens. La reconnaissance de Jérusalem, ville sainte des sunnites, comme capitale d’Israël par Donald Trump, entretient également une dissension entre États-Unis et pays du Golfe. Mais et poussée en cela par Washington, l’État hébreu souhaite normaliser ses relations avec les pays arabes, en les basant sur l’opposition commune à l’Iran. En ce sens, l’arrivée au pouvoir du gouvernement d’union entre le Likoud de Benyamin Netanyahu et le parti « Bleu-Blanc » de Benny Gantz, qui promeut de « renforcer la sécurité nationale » et d’œuvrer à la « paix », pourrait participer à un tel rapprochement. Mais identité et religion passeront, sans nul doute, avant une alliance stratégique avec Israël.
Divisés, les sunnites ne semblent pas réellement former un bloc homogène capable de freiner l’hégémonisme iranien et d’endiguer les prétentions chiites en Orient. Mais les monarchies du Golfe dispose tout de même de l’appui traditionnel des occidentaux, de l’arme énergétique, de la bienveillance de Moscou, fer de lance, rappelons-le, d’un monde multipolaire, et de Pékin ainsi que de la menace d’une attaque sur Israël qui, outre le fait que cette question puisse rapprocher chiites et sunnites, demeure un moyen de pression considérable sur les États-Unis.

Frappe aérienne israélienne sur un quartier de la ville de Damas, Syrie, le 27 avril 2020. AP22450766_000001
Photo : /AP/SIPA
Moyen d’établir un périmètre d’influence, l’Iran s’appuie donc sur l’ensemble des minorités présentes chez ses concurrents pour endiguer les prétentions de ses adversaires et pousser à la concrétisation du « croissant chiite ». Fantasme imaginé pour mettre en avant la peur d’une « internationale chiite » inféodée à Téhéran, réalité géopolitique fondée sur un réseau d’alliances pragmatiques, cet arc peine à trouver une véritable identité. Néanmoins, il nous pousse à nous interroger sur l’avenir du Moyen-Orient qui, entre découpage confessionnel de la région, nouvelle répartition des rapports de force dû au retrait américain et montée en puissance des acteurs russes ou chinois, dispose d’un avenir aussi complexe qu’imprévisible. Le fait que les États parties au « croissant » entretiennent de bonnes relations avec la Russie et, pour l’Iran, avec la Chine et l’Organisation de coopération de Shanghaï favorise, en effet, la redistribution des cartes de la puissance dans cette espace stratégique. Si, en définitive, Téhéran ne semble pas mu par un véritable « panchiisme », mais s’attache plutôt à entretenir une vision réaliste des relations internationales, basée sur l’intérêt national et les rapports de force au profit de la puissance étatique, et aux vues des bouleversements actuels qui ont cours au Moyen-Orient, nous pouvons légitimement nous demander si nous assisterons, dans un avenir proche et pour citer le prince héritier saoudien Moukrine ben Abdelaziz Al Saoud, à « un croissant chiite en passe de devenir une pleine lune ».
Il est intéressant de conclure sur la question de la crise du coronavirus qui a mis en exergue les véritables alliances qui ont cours au Moyen-Orient. Si la Chine et la Russie ont apporté leur aide à Téhéran, cette pandémie démontre combien la République islamique dispose, malgré un bilan des plus conséquent, d’une capacité de résilience. Le trio Russie-Chine-Iran, sur les traces de l’empire mongol, est en passe de s’imposer comme une réalité géopolitique incontestable et, qui plus est, embarrassante pour les intérêts occidentaux en Orient. Passage obligé des « nouvelles routes de la soie », l’arc chiite s’apprête donc à prendre une tout autre dimension. Enfin, l’aide que la République islamique s’est vue octroyer de la part du FMI met également en avant une volonté de renouer avec l’Occident, élément qui entre dans la compréhension de la géopolitique iranienne, désormais tournée vers la puissance globale. D’autre part, le choc pétrolier né des conséquences de l’épidémie met à mal les pétromonarchies du Golfe, Arabie saoudite en tête, et fragilise le pouvoir de Mohammed Ben Salman, principal opposant à Téhéran. Autant d’éléments qui expliquent une restructuration des rapports de force et qui permettent de considérer le « croissant chiite » comme une réalité géopolitique qui, de la solidarité religieuse, prend la forme d’un axe d’opposition aux intérêts occidentaux dans cet Orient décidément compliqué.