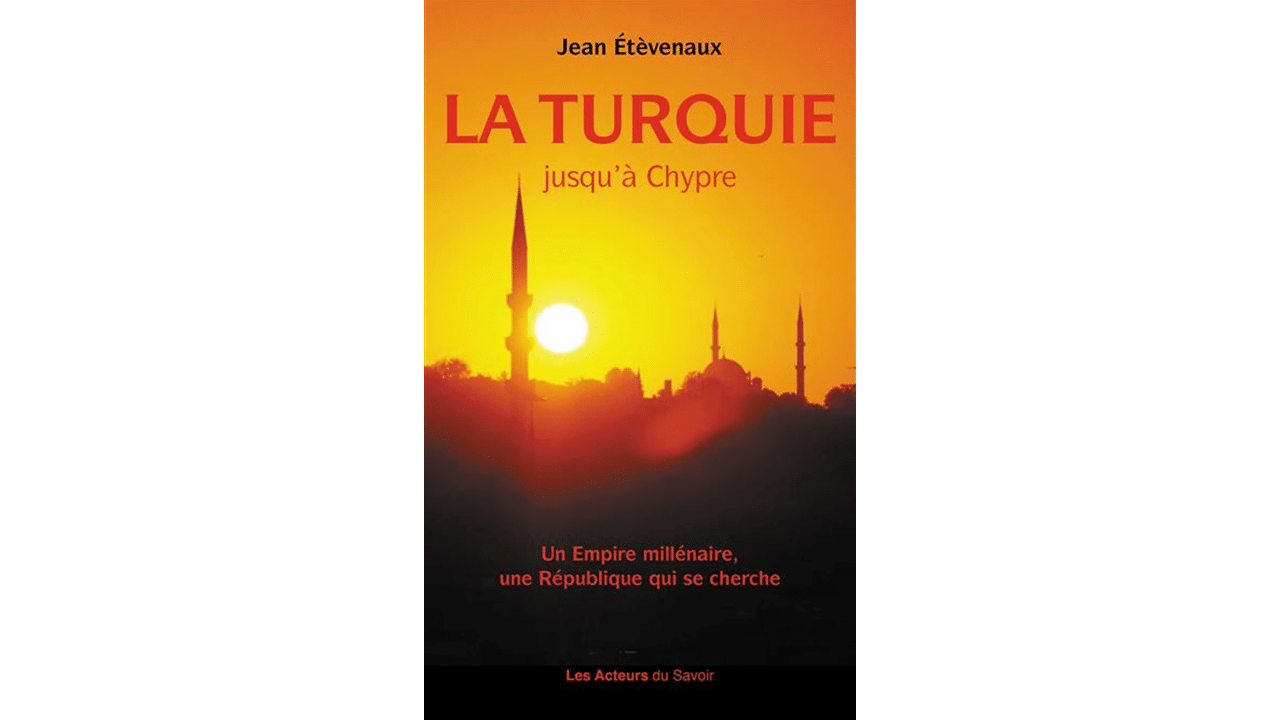Dans cet entretien mené par Conflits, Bayram Balci nous livre les clés de la politique internationale de la Turquie depuis l’arrivée de Recep Tayip Erdoğan au pouvoir en 2014. Entre alliances, coalitions, relations et intérêts, nous entrons plus en profondeur dans les rouages de la politique étrangère turque.
Comment pourriez-vous définir les principaux axes de la diplomatie turque en Orient depuis l’accès à la présidence par Recep Tayip Erdoğan en 2014 ?
Avant tout, il convient de préciser que la date de 2014, arrivée de Erdoğan à la présidence de la République en Turquie n’est pas une date charnière dans la politique étrangère turque. Elle ne constitue pas une rupture puisqu’avant et après cette date, Erdoğan était déjà et demeure le principal acteur de la politique extérieure de la Turquie, même s’il appliquait une vision plus collective de cette politique du temps où il était Premier ministre. Toutefois, c’est bien sous le pouvoir d’Erdoğan que s’opère le « shift » oriental dans la politique étrangère turque. Ce changement d’axe n’est pas brutal, ni daté ni acté par simple décret ou décision. Il est le produit d’un long processus qui a commencé bien avant l’accès au pouvoir par AKP et son leader Erdoğan. Par ailleurs, avant de répondre à la question des axes de la diplomatie turque en Orient, il convient de définir cet Orient. Pour simplifier, je dirais qu’il englobe tout ce qui est étranger à l’Union européenne et aux États-Unis, les deux tropismes qui avaient été au centre de la politique d’occidentalisation de la Turquie. Ainsi, depuis le début de la décennie 2010, quand la Turquie commence à prendre conscience que jamais elle ne sera admise dans l’UE, la diplomatie d’Ankara cherche à développer des axes « alternatifs » vers un Orient multiple, que l’on pourrait subdiviser en plusieurs pôles :
Le Moyen Orient, et de façon générale le monde musulman. Déjà avant Erdoğan, sous Turgut Özal, malgré le credo kémaliste préconisant la distanciation du monde arabo-musulman et la candidature à l’Union Européenne, la Turquie ne peut pas rester indifférente à son voisinage immédiat, ne serait-ce que parce que trois de ses voisins sont arabes et/ou musulmans, Syrie Irak, Iran et que les soubresauts de cette région la touchent de toute façon. À partir de ce constat, et pensant qu’une Turquie influente au Moyen Orient peut être un atout pour sa candidature à l’UE, Ankara amorce un rapprochement avec les États de son proche voisinage. De plus, dans une perspective de revalorisation de l’héritage ottoman, il est crucial pour la Turquie de développer de bonnes relations avec ces pays, notamment l’Irak et le bilad al sham. Cette initiative d’investissement politique et culturel dans cet Orient compliqué a été un succès, mais à partir de la crise syrienne, qui constitue un tournant dans la politique extérieure turque, on entre dans une nouvelle phase où la politique turque au Moyen Orient est davantage contestée par les intéressés, mais cela ne veut pas dire que la Turquie n’a plus de poids et d’influence mais elle a perdu une large partie de son soft power.
L’Afrique est l’extension la plus méridionale de cette politique orientale de la Turquie depuis l’arrivée de l’AKP au pouvoir. Mais là aussi, il ne faut pas croire que l’initiative appartient exclusivement à Erdoğan et à son équipe. En fait déjà en 1998, donc quatre ans avant l’arrivée de l’AKP au pouvoir, la Turquie élabore une politique africaine, mais la crise économique brise cet élan qui sera repris par l’AKP et qui aura trois piliers : la compagnie nationale Turkish Airlines, les entreprises turques d’exportation, et le réseau éducatif de la mouvance de Fethullah Gülen qui, depuis, est entré en conflit avec le pouvoir d’Erdoğan mais qui avait été pionnier dans l’ouverture turque vers l’Afrique.
L’Asie centrale occupe également une place à part dans la politique orientale de la Turquie mais là encore ce n’est pas nouveau, puisque depuis leur apparition sur la scène internationale à la suite de l’implosion de l’ex URSS, les États du Caucase, mais surtout d’Asie centrale, comptent beaucoup pour la diplomatie turque.
Le rapprochement avec la Russie est la vraie nouveauté dans cette politique orientale de la Turquie menée par l’AKP. Mais ce rapprochement en cours entre la Turquie et la Russie doit aussi être remis dans son contexte et relativisé. Son contexte c’est celui de la guerre en Syrie où la Turquie, initialement alignée sur ses partenaires occidentaux pour le départ de Bachar, a dû, pour préserver sa sécurité nationale et territoriale, se brouiller avec ses alliés occidentaux et amorcer un virage pour se rapprocher de la Russie, malgré de nombreux points de divergence notamment sur l’avenir de la Syrie. En effet, enlisée dans une guerre syrienne qu’elle n’a pas provoquée, mais qu’elle a contribué à aggraver par son ingérence (au même titre que d’autres puissances y compris occidentales), la Turquie s’est rapprochée de la Russie, quand elle s’est sentie insuffisamment comprise et défendue par ses alliés, notamment l’OTAN, sur la délicate question kurde. Or, cette alliance avec la Russie est fragile, car le dossier syrien pose des problèmes, mais aussi la situation en Libye, ou encore dans le Caucase, en Ukraine, voire en Asie centrale. Tant de points de discorde n’en font pas une alliance solide et déterminante à ce stade.

La ville d’Istanbul
A lire aussi: Pour quelles raisons la Turquie s’implante-t-elle en Afrique ?
Voisin de la Syrie, quel rôle a joué Ankara dans la guerre qui a opposé Damas à la coalition internationale ? Quel intérêt avait la Turquie à s’ingérer dans ce conflit et qu’en est-il, aujourd’hui, des revendications territoriales sur la frontière turco-syrienne ?
Votre question est multiple, aussi je répondrai en plusieurs temps :
À la veille du déclenchement de la révolte syrienne, qui pour moi s’apparentait au départ à une révolution d’aspiration démocratique, sur le modèle des printemps arabes, la Turquie était en excellents termes avec le régime de Bachar al Assad. Cette relation précieuse et inédite dans l’histoire turque moderne était le fruit de la politique de « zéro problème avec ses voisins » de Davutoğlu. Aussi, hésitante à rompre avec le régime et durant les six premiers mois de la crise syrienne, Ankara, trop confiante de ses bonnes relations avec Bachar, fait des efforts pour le convaincre de procéder à des réformes afin de calmer la situation. Mais constatant l’intransigeance du régime et son basculement dans une répression brutale et meurtrière, la Turquie, en concertation avec ses partenaires occidentaux et la Ligue arabe réunis dans le cercle « les amis de la Syrie », change de politique, pour soutenir ouvertement la résistance contre le régime de Bachar. Alors que les chancelleries et analystes occidentaux voyaient Bachar la Assad comme condamné à partir, à l’instar des autres hommes forts de la région emportés par les révoltes arabes, l’entrée en scène des alliés de Bachar, principalement l’Iran, la Russie et le Hezbollah, a changé la donne et permis au régime de Damas de se maintenir.
La Turquie a alors sous-estimé ce soutien étranger au régime et surestimé le soutien américain à la révolution populaire et à la résistance syrienne s’organisant en Turquie. Or, les Occidentaux ont fait défaut à leur allié turc de l’OTAN quand ils ont délaissé l’objectif de la chute de Bachar al Assad, source du problème syrien pour prioriser la cible DAECH, conséquence de la violence de Bachar. La Turquie s’est retrouvée seule face à Bachar et ses alliés. La crise a dégénéré en guerre civile, dont l’aggravation a contribué à l’extrême polarisation des parties. Dans le temps, la Turquie s’est enlisée, après l’émergence de deux acteurs majeurs inattendus, les Kurdes et DAESH. Les menaces sécuritaires que les deux font peser sur la Turquie déstabilisent un peu plus encore le pouvoir à Ankara et cette guerre a eu des effets considérables sur la nature du régime turc, sur sa politique intérieure et extérieure.
Pour répondre à la question précise de l’intérêt de la Turquie à entrer dans le conflit, elle n’en avait aucun en réalité. Au contraire, elle a tout à perdre de la rupture avec Damas, au point de vue économique, stratégique, politique. Mais le pays, partageant une frontière longue de 900 km avec la Syrie est aux premières loges de ce théâtre d’atrocités, et la Turquie accueille près de 4 millions d’exilés fuyant la mort. Les considérations humanitaires sont alors sincères, car les Turcs croient à la chute rapide de Damas et à la normalisation prochaine de la situation. Finalement contraints de rompre avec le régime de Bachar, les Turcs ont fait le rapide calcul, que l’alternative serait l’avènement d’une formation issue de l’islam politique, donc potentiellement favorable à la Turquie. Ce fut le cas récemment en Tunisie et Égypte et à l’automne 2011, le modèle turc rayonne encore, et fait l’objet de louanges un peu partout parmi les intellectuels arabes et musulmans mais aussi occidentaux.
Mais encore une fois, il faut bien insister sur le fait que ce prestige est une très maigre consolation par rapport à ce que perd la Turquie en rompant avec Damas. Et cette aura s’effondre à son tour, au fur et à mesure que la guerre s’aggrave et ouvre une boîte de Pandore, avec ses mauvaises surprises, si bien qu’au final la Turquie est la grande perdante de ce cynique jeu de billard à plusieurs bandes.
Pour ce qui est des revendications territoriales de la Turquie sur la Syrie, elles n’existent pas et n’ont jamais existé. Depuis le début l’objectif de la Turquie n’est pas irrédentiste mais politique et sécuritaire. Au départ, l’indignation internationale, dont faisait partie la Turquie, souhaitait la chute inéluctable du régime criminel de Bachar. Mais avec l’ingérence étrangère et l’aggravation du conflit armé, c’est surtout la montée en puissance du facteur kurde, dont une partie s’est retournée contre la Turquie sous forme de guérilla indépendantiste, et à laquelle s’ajoutait la menace posée Daesh, ont incité la Turquie à entamer des incursions militaires en territoire syrien. Leur but n’était pas d’annexer, mais d’assurer que la région échappant au contrôle de Bachar ne devienne pas une région posant des défis sécuritaires à la Turquie.
D’ailleurs, si on observe bien le déroulé des faits sur le terrain, parmi tous les pays impliqués dans le confit, c’est la Turquie qui est la dernière et avec la plus grande réticence à entrer en Syrie avec ses propres soldats. La guerre commence en 2011, or la première incursion turque n’intervient qu’en août 2016, bien après l’entrée en jeu de la Russie, de l’Iran, du Hezbollah et du PKK.

Des réfugiés syriens en Grèce
A lire aussi: Syrie : Turquie et Russie reprennent la main
Quelles relations entretient la Turquie avec les monarchies sunnites du Golfe ainsi qu’avec les pays de l’arc chiite, notamment dans le cadre du processus d’Astana, élément qui pourrait la rapprocher de l’Iran ? Essaie-t-elle de s’insérer dans un camp clairement défini ?
Pour ce qui est des relations entre la Turquie et les monarchies du Golfe, elles sont changeantes depuis une quinzaine d’années mais à l’heure actuelle je dirais qu’elles sont tendues avec tout le monde sauf avec le Qatar qui demeure un des rares pays avec lequel la Turquie n’a pas de différend. Cette tension trouve son origine dans la question syrienne. Au début du conflit, Arabie Saoudite, Qatar et Émirats arabes-unis étaient favorables à la chute de Bachar et soutenaient divers groupes rebelles. Par la suite, l’évolution du conflit et le constat que dans ce conflit comme dans les autres pays touchés par les printemps arabes se renforçait l’islam politique des Frères musulmans, la plupart des monarchies ont changé de stratégie. Craignant l’arrivée des Frères musulmans dont le credo politique préconise élections et parlementarisme, et menaçant de facto les monarchies, celles-ci ont cessé leur soutien à la révolution et à leur projet de faire chuter Bachar, ce qui les met en opposition avec la Turquie qui elle campe sur sa position de soutien à l’islam politique. Parmi les monarchies, il y a l’exception qatarie, qui n’a pas peur de l’islam politique, qu’elle soutient même pour le mettre à son service, et qui n’a pas peur non plus de l’Iran, la bête noire des autres monarchies, notamment de l’Arabie saoudite. Pour ce qui est de l’arc chiite, c’est-à-dire l’alliance entre l’Iran, la Syrie de Bachar, et le Hezbollah, son existence me parait douteuse, du moins dans les termes car le chiisme n’est pas le moteur de cette union d’intérêts. Quoi qu’il en soit, la Turquie a toujours eu des relations pragmatiques avec le principal acteur de ce supposé arc, l’Iran. Bien qu’en désaccord sur nombre de questions régionales, notamment le dossier syrien, ils arrivent à compartimenter leurs relations du fait de leur interdépendance économique.
Si la Turquie a reconnu Israël en 1948, les rapports entre les deux pays demeurent fragiles. Comment ont-ils évolué, notamment depuis l’abordage, par l’armée israélienne, d’un navire turc en partance pour Gaza, en 2010 ?
La Turquie fut parmi les premiers pays musulmans à reconnaître l’État d’Israël et par la suite leurs relations bilatérales ont connu trois phases. De 1948 à 1996, les relations sont excellentes, notamment grâce au fait que la Turquie, fidèle à son héritage kémaliste, se méfie d’une bonne partie des pays arabes. Et cette précaution se trouve renforcée dans un contexte de guerre froide, où nombre de pays arabes sont prosoviétiques, tandis que la Turquie comme Israël sont plus proches de l’Occident.
1996 marque pour la première fois en Turquie l’arrivée au pouvoir d’un gouvernement issu de l’islam politique, avec Necmettin Erbakan comme Premier ministre. L’homme est antisioniste voire antisémite notoire, mais ce gouvernement n’a pas entamé les bonnes relations avec Israël, car en matière de politique étrangère, à cette époque, c’est encore le Conseil National de Sécurité, instance composée de civils mais aussi de militaires, qui, méfiante envers le nouveau gouvernement islamiste et habitués à la coopération militaire poussée, veille au maintien de bonnes relations entre la Turquie et Israël.
En 1998, c’est en partie grâce à l’aide des services israéliens que la Turquie parvient à capturer Abdullah Öcalan, leader du PKK expulsé de Damas. Curieusement, accédant au pouvoir en 2002, l’AKP s’inscrit dans la continuité de ces bonnes relations entre Ankara et Tel Aviv. Le changement intervient à partir de 2009 quand Erdoğan, confiant de l’essor inédit du soft power turc dans tout le Moyen Orient, décide d’adopter un ton plus assertif vis-à-vis d’Israël, pour accroître davantage son prestige et l’influence de la Turquie dans la région. Rêvant d’un leadership régional, la Turquie est prête à rompre avec Israël dont l’attitude vis-à-vis des Palestiniens fait quasiment l’unanimité contre lui dans l’opinion turque, bien au-delà de la famille AKP. Ainsi, en mai 2010, l’abordage par l’armée israélienne d’un convoi humanitaire turc défiant le blocus pour apporter assistance à Gaza, résulte de plusieurs mois de tensions diplomatiques entre les deux pays. L’incident a coûté la vie à dix activistes turcs pro-palestiniens, ce qui a provoqué une rupture des relations diplomatiques. Depuis, des médiations américaines pour réconcilier ces deux alliés ont connu un succès tout relatif et vite déçu puisque les relations ont été à nouveau rompues, quand en décembre 2018 les États-Unis ont reconnu Jérusalem comme capitale d’Israël. À l’heure actuelle, elles sont toujours au point-mort et aucune amélioration ne semble s’annoncer à l’horizon.

La ville de Jérusalem
Quelles influence Ankara détient-elle sur les Républiques d’Asie centrale, spécialement celles qui sont majoritairement musulmanes ? Peut-on qualifier la géopolitique turque en Asie centrale de panturquisme ? Qu’en est-il des relations avec l’Arménie, pays qui garde un souvenir amer du génocide de 1915 ?
Je répondrai en plusieurs temps car vos questions sont multiples :
La Turquie a des relations privilégiées avec les Républiques turciques issues de l’ex URSS, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan et Turkménistan, voire le Tadjikistan même si ce dernier ne relève pas de l’espace turcophone. Toutefois, ces relations ne s’inscrivent pas dans le renouveau du panturquisme, une idéologie nationaliste propre au XIXe siècle comparable au panslavisme, panarabisme et panislamisme entre autres. Cette idéologie visait la réunification des peuples turciques de deux empires moribonds, celui des sultans ottomans et des tsars russes. Mais les régimes naissants sur les décombres impériaux, la Turquie kémaliste et l’Union soviétique de Lénine ont balayé cette utopie irréalisable compte tenu des différences culturelles, linguistiques entre les groupes ethniques qu’elle ambitionnait de réunir. Des vestiges de cette idéologie ayant survécu à la période soviétique et revendiqués par certains cercles intellectuels dès la fin de l’URSS, en Turquie et en Asie centrale, ont pu faire croire un temps à une ambition panturquiste de la part d’Ankara.
Or, il n’en est rien, car très rapidement la Turquie a mesuré les fossés irréconciliables entre les groupes, aggravés par une longue rupture entre les populations de Turquie et celles de l’ex URSS. En effet, jaloux de leur particularisme identitaire, les États turciques ne voulaient pas d’une union turcique qui aurait limité leur souveraineté. Toutefois, malgré l’échec de ce projet panturquiste, il existe à l’heure actuelle des structures de coopération dans le domaine des arts, de la culture, des sciences et de la politique, pour favoriser le développement des liens entre la Turquie et les républiques post soviétique. D’aucuns qualifieront cette politique de panturquisme culturel, mais je pense qu’elle s’apparente davantage à la francophonie ou à ce que fait la Russie en matière de soft power dans l’espace ex soviétique.
Quant aux relations avec l’Arménie, elles sont de fait inexistantes, même si depuis que l’Arménie est indépendante des tentatives de normalisation ont été menées. En 1991, la Turquie a reconnu l’indépendance de l’Arménie et pendant un court moment la frontière entre les deux pays était ouverte. Mais hélas assez rapidement, la guerre du Karabakh entre Arménie et Azerbaïdjan, et dans laquelle la Turquie a pris fait et cause pour l’Azerbaïdjan a poussé la Turquie à fermer la frontière pour mettre la pression sur l’Arménie et favoriser ainsi son allié azerbaidjanais. L’AKP, qui a entrepris une politique de pacification des relations de la Turquie avec tous ses voisins, a initié à partir de 2008 ce qu’on a appelé la « diplomatie du football », c’est-à-dire favoriser la rencontre des chefs d’État à l’occasion d’une rencontre sportive.
Par la suite, des protocoles ont été discutés, grâce à la médiation de plusieurs pays, notamment la Suisse et les États-Unis, pour une normalisation des relations et la réouverture de la frontière. Les avancées avaient été significatives et la partie arménienne n’ayant pas exigé la reconnaissance du génocide par la Turquie comme précondition à la normalisation, l’effort semblait bien engagé mais c’est une fois de plus à cause de la question du Karabakh que la réconciliation a échoué. En effet, l’Azerbaïdjan, qui semble-t-il n’avait pas été informé des pourparlers entre Erevan et Ankara, a déployé toute son énergie et renforcé la pression sur son allié turc pour empêcher cette normalisation. En effet, l’Azerbaïdjan est un partenaire énergétique et un investisseur crucial pour la Turquie et il peut aussi mobiliser une partie de l’opinion publique turque. Et c’est ce qu’il a fait, avec succès pour faire obstacle à cette normalisation. La réconciliation turco-arménienne ne pourra pas être envisagée sans le facteur du Haut Karabakh et l’Azerbaïdjan. Mais le contexte actuel n’est pas du tout favorable à une nouvelle tentative de normalisation car la Turquie est empêtrée dans plusieurs conflits qui remettent la question de la sécurité au centre du débat politique. Mais à moyen terme il est permis d’être optimiste, car malgré le refus de l’Etat de reconnaître le génocide, alors qu’en 2014, il avait fait une ouverture sur la question en présentant ses condoléances aux descendants des victimes de la tragédie de 1915, nombreuses sont les associations qui en Turquie le commémorent chaque année, organisent des évènements et des manifestations autorisées. Et malgré, le raidissement général du pouvoir ces dernières années, il les tolère encore.
Les liens russo-turcs semblent se renforcer sur bien des plans, qu’ils soient militaires (vente de missiles S-400) ou énergétiques (gazoduc TurkishStream). Ces deux pays deviendront-ils, à terme, les acteurs incontournables du Moyen-Orient ?
On constate en effet un assez remarquable rapprochement entre la Turquie et la Russie ces dernières années. Celui-ci est d’autant plus surprenant que les deux pays, durant la guerre froide et encore plus auparavant, pendant leurs périodes impériales étaient en quelques sorte des ennemis héréditaires. Depuis la fin de la guerre froide, la rivalité est moins exacerbée, mais dans le conflit syrien à nouveau ils se sont retrouvés dans des camps diamétralement opposés, la Turquie voulant la chute de Bachar, tandis que la Russie au contraire continue de le soutenir. Les deux pays ont bien failli entrer en guerre, quand en novembre 2015 la Turquie a abattu un avion russe qui bombardait ses protégés en Syrie et violait régulièrement l’espace aérien turc. Cet incident a été en réalité un test supplémentaire pour les relations entre la Turquie et ses alliés traditionnels occidentaux, notamment l’OTAN. Le manque de solidarité et le quasi retrait des Occidentaux du dossier syrien, ont incité la Turquie à se rapprocher de la Russie avec laquelle Ankara cherche à bâtir une relation d’équilibre avec ses alliés qu’elle trouve peu soucieux de sa propre sécurité.
D’où l’achat par Ankara des S 400 qui compliquent davantage la relation turco-otanienne et permet à la Russie d’être en position de force face à l’Occident. Ce rapprochement militaire se double d’une coopération économique, notamment énergétique qui rend la Turquie encore plus dépendante de la Russie. Pourtant, à long terme cette relation n’est pas à l’abri de tensions, car les points de divergence entre eux demeurent, en Syrie, mais aussi en Mer noire, dans la question ukrainienne et dans le Caucase où la Turquie continue de soutenir l’Azerbaïdjan, alors que la Russie a une position certes équilibrée mais qui penche tout de même davantage en faveur de l’Arménie. Enfin, cette relative entente repose aussi sur la bonne entente personnelle entre Vladimir Poutine et Recep Tayyip Erdoğan qui ont le même tempérament politique. Or, même si les deux leaders sont encore forts et contrôlent bien leur pays, tôt ou tard le changement de pouvoir, en Turquie en tout cas, ne sera pas sans effets sur l’entente turco-russe.

Militaires russes et turcs faisant une patrouille commune en Syrie SIPAUSA30212248_000001 Photo : Russian Reconciliation Center fo/SIPA
Comment voyez-vous l’avenir de la diplomatie turque en Orient ? Quelle place occupera Ankara à l’issue de ce premier quart de siècle et dans quelle mesure son rapprochement avec la Russie pourrait remettre en cause sa place dans l’OTAN ?
Durant les premiers temps des printemps arabes, la Turquie donnait le sentiment d’avoir gagné le pari de devenir une puissance régionale, voire une puissance internationale ayant toute légitimité pour participer davantage à la gouvernance mondiale. Toutefois, ce rêve de grandeur a été mis en échec en Syrie où les choix faits par Ankara se sont avérés mauvais, au moins d’un point de vue géopolitique, car en termes humanitaires, elle a fait le bon choix sur deux points : elle a su rompre avec l’allié Bachar devenu boucher de son propre peuple, avant même que la révolution ne soit confisquée, et surtout, bien qu’impopulaire et électoralement peu porteuse pour le pouvoir, la décision fut prise d’ouvrir les frontières pour permettre à plus de 3 millions de gens en détresse de trouver refuge en Turquie. L’échec politique en Syrie a ramené la Turquie à ce qu’elle est en réalité, une puissance régionale fragile, et de plus en plus perdue et isolée entre la Russie et l’Occident, une situation qui n’est pas sans faire penser à la guerre froide. Aussi, la Turquie demeure un acteur régional en Orient, mais un acteur mal aimé car le pays s’est à nouveau fâché avec tout le monde à cause de sa politique étrangère perçue désormais comme trop belliqueuse, et de du style autoritaire aux des Occidentaux qui s’en exaspèrent.
Pour ce qui est de sa relation avec l’OTAN, pour ne pas entrer dans un interminable débat il convient de souligner que la confiance s’est érodée, mais là aussi, les racines du malentendu sont anciennes. Pendant toute la période de guerre froide, l’alliance prenait tout son sens. La Turquie bénéficiait du fort soutien américain étant donné son importance géostratégique sur le flanc sud-ouest de l’URSS, mais aussi dans l’idée de promouvoir un pays musulman non hostile. En échange, la Turquie contribuait à contenir la menace soviétique grâce à la présence sur son territoire de plusieurs bases militaires de l’OTAN. La fin de la guerre froide a changé la donne, la Turquie n’est plus l’allié indispensable de l’Amérique et de l’OTAN face à une Russie moins menaçante que l’URSS. Entre temps, la Turquie a changé et est devenue une puissance moyenne qui tout en restant dans l’OTAN veut avoir une certaine autonomie sur la scène internationale, y compris dans ses choix militaires. Ce changement de contexte fragilise l’alliance, et occasionnellement les deux parties s’accusent mutuellement de déloyauté, avec des arguments solides et fondés de chaque côté. Et, une fois de plus, c’est dans le conflit syrien que la mésentente entre la Turquie et l’OTAN est devenue la plus apparente. Les États-Unis et la Turquie, respectivement la première et la deuxième armée de l’OTAN, se sont opposés sur deux questions cruciales : la manière de mener la guerre contre DAESH et l’attitude vis-à-vis de la Russie.
La première pomme de discorde entre la Turquie et les États-Unis, concerne son système de défense anti aérienne et antimissile mobile. En pleine guerre syrienne, la Turquie a éprouvé le besoin de s’équiper, et il est vrai que dans un premier temps, face à l’aggravation des tensions entre la Turquie et la Syrie, des missiles Patriot ont été installés en Turquie, par l’OTAN. Mais au bout de quelque mois, ils ont été démantelés, laissant la Turquie sans protection, dans un contexte d’aggravation de la guerre en Syrie, et après avoir subi des attaques sur son territoire par le régime de Bachar. Butant sur le prix des Patriot et la délicate question de transfert de technologie, la Turquie s’est tournée vers la Russie, trop heureuse de vendre son système à un membre de l’OTAN pour le déstabiliser davantage et semer la zizanie dans l’alliance. Cette crise ouverte va durer car la Turquie ne veut ni sortir de l’organisation, ni accepter toutes ses règles contraignantes mais dépourvues de garanties en matière de sécurité. Quant à l’OTAN, elle accuse là une faiblesse importante qui dénonce le fait qu’elle n’a pas su faire son aggiornamento, qui s’imposait pourtant, quand on sait l’évolution de l’ordre international depuis 1947. Mais l’achat d’armement russe n’est pas le seul point de friction entre la Turquie et l’OTAN.
Face à la menace de Daesh, les États-Unis affirment n’avoir eu d’autre d’autre choix que de passer une alliance avec les forces kurdes, plus efficaces pour combattre les djihadistes. Choix judicieux s’il en est d’un point de vue militaire, au plan politique cette stratégie d’alliance a été plus problématique. En effet, profitant du soutien militaire américain, le PKK tout en coordonnant la guerre des milices kurdes au sein des FDS contre Daesh, a détourné une partie de l’aide américaine, et donc de l’OTAN, pour entamer une guérilla urbaine contre l’armée turque, brisant la trêve difficilement négociée par l’AKP et le PKK, via des parlementaires kurdes de Turquie qui faisant la navette entre Ankara et Kandil. Ainsi, en Turquie prédomine le sentiment que non seulement l’OTAN n’a pas été solidaire de la Turquie dans le conflit syrien, mais qu’en plus, il a contribué, par le jeu d’alliance avec le PKK, à faire voler en éclat une trêve durement négociée avec le PKK qui, ayant le vent en poupe grâce au soutien des Occidentaux, a préféré renouer avec la stratégie guerrière contre Ankara.