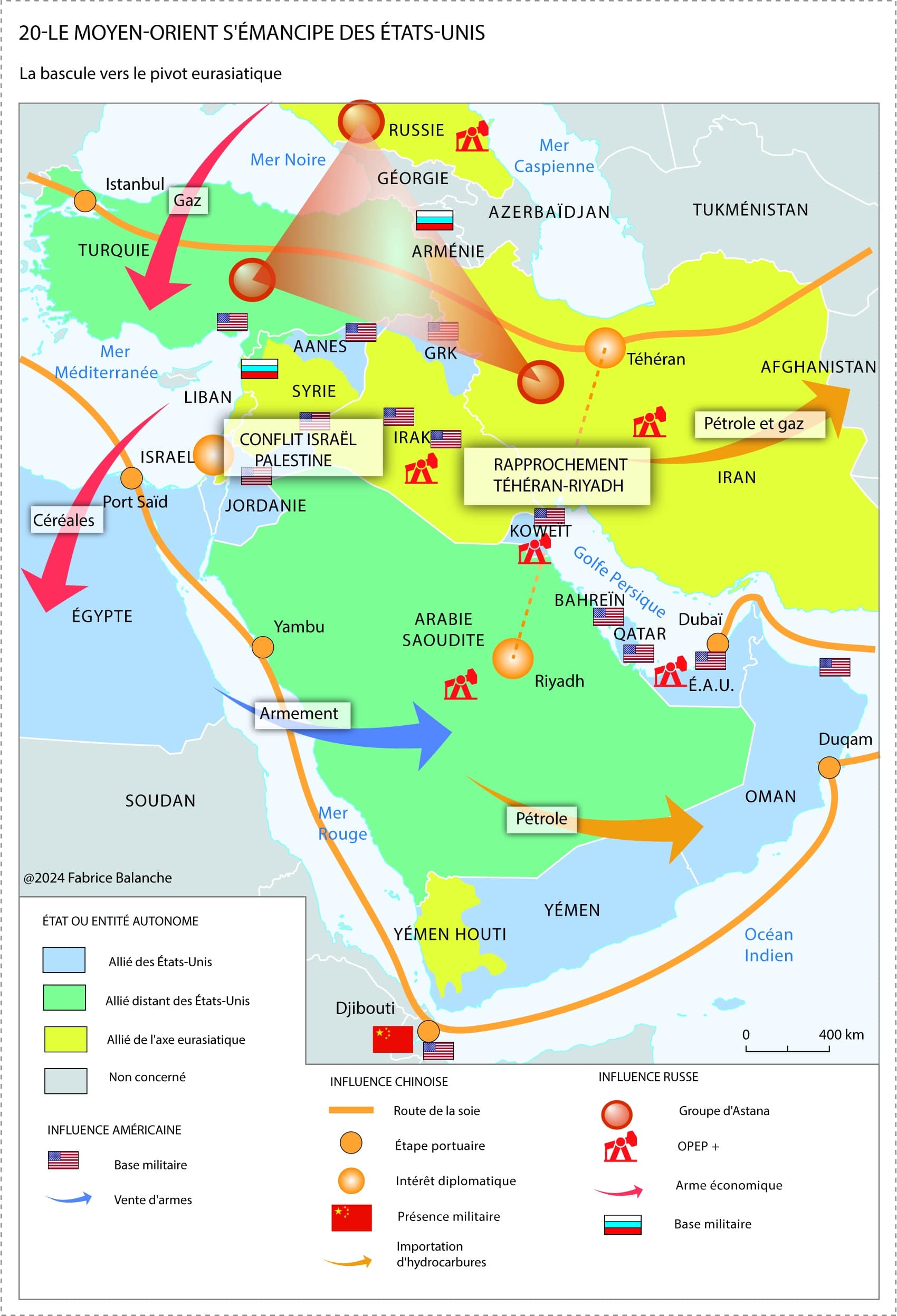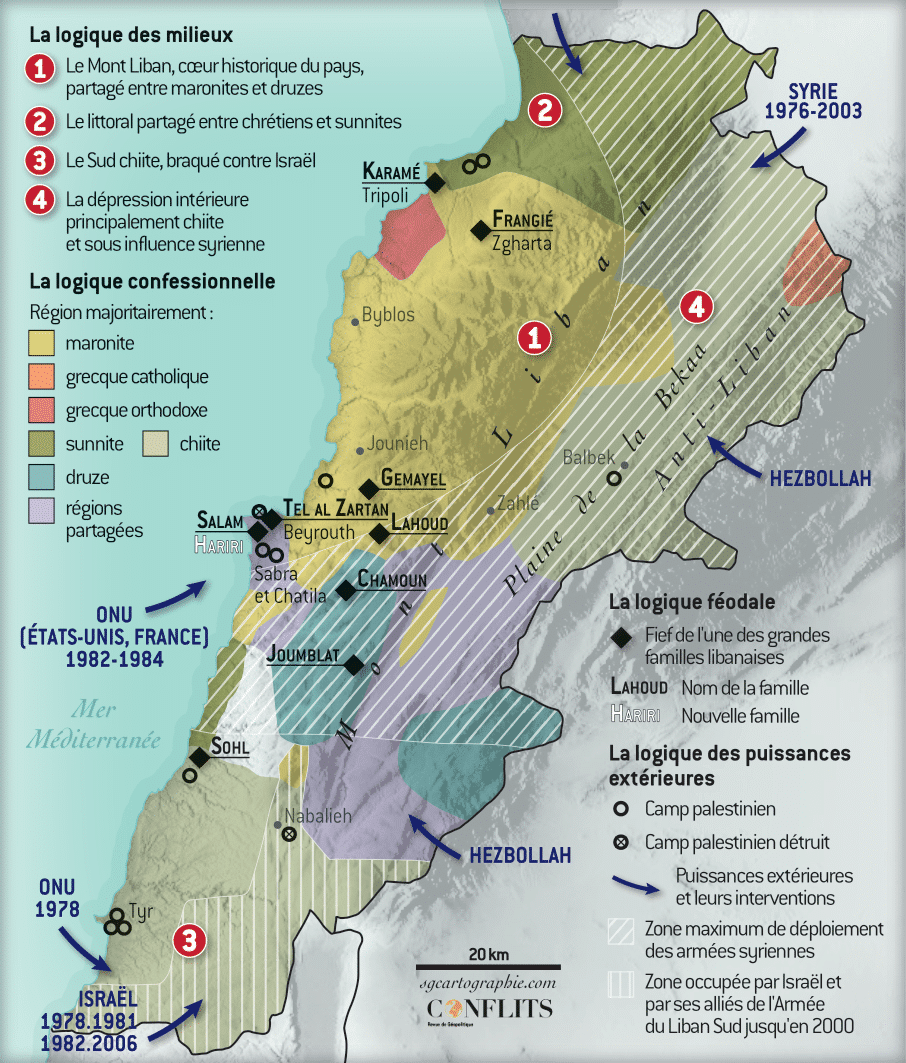Commencé en 1999 dans l’euphorie soutenue par la perspective d’une paix enfin retrouvée après sept ans d’une atroce guerre civile (200 000 morts), le long règne d’Abdelaziz Bouteflika – dix-sept ans et sept mois en novembre 2016 – s’achève dans une opacité pathétique, marquée par une double agonie : celle du cinquième président de la République algérienne démocratique et populaire, élu en avril 1999, réélu à trois reprises en 2004, 2009 et 2014 ; celle du régime dont il est un fidèle serviteur depuis l’indépendance, en 1962.
Malade, incapable de gouverner plus de quelques heures par jour, quasiment grabataire et muet, Bouteflika achève une longue carrière politique marquée par sa lutte pour le pouvoir. Né à Oujda (Maroc oriental), le 2 mars 1937, originaire de la région de Tlemcen (ouest de l’Algérie), il s’engage dès l’âge de 19 ans dans l’Armée de libération nationale (ALN), l’« armée des frontières », stationnée au Maroc. Militant indépendantiste précoce, ce jeune cadre administratif prend vite du galon, protégé par le colonel Houari Boumediene, le futur chef de l’État algérien (1965-1978). Plus politique que militaire, Bouteflika apprend à parler, à convaincre, à manœuvrer dans les réseaux de la clandestinité. Sa capacité de séduction et son talent manœuvrier en font un élément prometteur du « clan d’Oujda », composante majeure au sein de l’état-major général de l’Armée de libération nationale.
Fidèle à Boumediene, il est naturellement dans l’équipe des vainqueurs, en 1962. Il a 25 ans. Député de Tlemcen puis ministre de septembre 1962 à juillet 1981, Bouteflika s’installe pour dix-huit ans au pouvoir. Serviteur zélé de l’Algérie indépendante, il passe du ministère de la Jeunesse et des Sports aux Affaires étrangères, poste qu’il occupe de septembre 1963 à mars 1979. Flamboyant, hyperactif, ce petit homme – 1 mètre 56 – devient le visage de cette jeune république socialiste arabe, alliée de l’Union soviétique. Sous sa houlette, Alger devient la capitale des mouvements révolutionnaires du monde entier. Le « camarade Boutef » est le porte-parole attitré des luttes du tiers-monde.
A lire aussi : L’Espagne face aux revendications territoriales marocaines et algériennes
Mêlé en 1980 à une affaire de détournement de fonds, jamais vraiment élucidée, il est écarté du pouvoir par le président Chadli Bendjedid. Traduit devant le conseil de discipline du FLN, poursuivi par la Cour des comptes, il décide de quitter la scène politique en 1981 pour un exil de six ans (1981-1987), avant de revenir à Alger, en attente de son destin (1987-1999).
Consultant international, il fait des affaires et s’enrichit. Connu pour son goût de la fête, pour ses succès féminins et son art de mettre en réseau son carnet d’adresses, ce célibataire endurci a toujours gardé un œil sur les jeux d’influence à Alger entre le FLN, l’armée et les services de renseignement, l’ancienne SM (Sécurité militaire) devenu le DRS (Département Renseignement et Sécurité).
Président… à vie ?
En 1998, le régime est à bout de souffle, épuisé par presque sept ans de guerre civile entre le pouvoir et les islamistes. Les candidats à la présidence ne se bousculent pas ou sont rejetés par le FLN, l’armée et le DRS, faiseurs de rois de cette « démocratie populaire. » Candidat « indépendant » à la présidentielle d’avril 1999, Bouteflika est facilement élu (74 % des voix).
Personne n’imagine alors qu’il fera quatre mandats, ni qu’il réussira à se libérer de l’emprise de ceux qui l’ont installé et conforté au pouvoir : l’état-major de l’armée et le DRS. Réélu à trois reprises (2004, 2009, 2014), sa quadruple présidence va culminer avec la mise au pas des plus fortes personnalités du système, à commencer par l’inamovible patron du DRS, le général major Mohamed Mediène, dit Toufik, limogé en novembre 2015. Longtemps considérés comme intouchables, l’armée et le DRS ont plié devant sa volonté.
Ces incontestables succès politiques, rythmés par des limogeages à répétition dans la haute fonction publique et par plusieurs changements des textes constitutionnels, ont consolidé l’emprise du clan Bouteflika sur le pouvoir, malgré l’affaiblissement accéléré de la santé du président, jusqu’à sa quasi-paralysie. La première alerte sérieuse remonte à novembre 2005. Hospitalisé à l’hôpital militaire du Val-de-Grâce (Paris) le 26 novembre 2005, Bouteflika n’en sortira qu’après 21 jours d’hospitalisation. Officiellement, il souffre d’un ulcère de l’estomac. La rumeur évoque un cancer, hypothèse accréditée par un télégramme du département d’État américain révélé par les fuites de l’affaire WikiLeaks.
A lire aussi : Algérie: Un destin en suspens
En avril 2006, Bouteflika est de nouveau à Paris pour un « suivi médical ». Contempteur obstiné de la France et de l’armée française, le président algérien apprécie beaucoup la qualité des soins de la médecine militaire française. À deux reprises encore, il sera soigné au Val-de-Grâce. En 2013, son état physique s’est dégradé. Il est victime de deux accidents ischémiques transitoires – attaques cérébrales –, et doit séjourner à l’hôpital militaire des Invalides. Il ne revient en Algérie qu’après quatre-vingts jours d’absence. Des images de la télévision algérienne le montrent figé, le verbe hésitant, le regard vide.
Paralysé du côté gauche, obligé de se déplacer en fauteuil roulant, Bouteflika ne peut plus cacher son état. La France l’accueillera encore à plusieurs reprises, à Grenoble et au Val-de-Grâce, la dernière fois en novembre dernier. La presse libre algérienne s’interroge. Le quotidien El-Watan estime à cette époque que le chef de l’État « n’est pas en mesure de conduire le pays jusqu’à la fin de son mandat en 2019 ».
Un pays à la dérive
Presque résignés, les Algériens observent ce naufrage, parallèle à celui de l’Algérie qui avait tout pour être un des géants de la Méditerranée. Le triomphe politique personnel de Bouteflika aura prolongé la tragédie collective de son pays. Lucides, ils savent tout du marasme de l’économie, malgré la rente pétrolière et gazière. Ils constatent la ruine de l’industrie et de l’agriculture, leur dépendance à l’égard des circuits d’importation qui alimentent la corruption ambiante. Ils s’interrogent sur l’utilisation par le pouvoir des 784 milliards de dollars rapportés par les exportations depuis 1999 (dont 95 % assurés par les hydrocarbures).
Méprisés par une administration envahissante et incapable, négligés par un régime vieillissant qui tente de calmer les colères populaires à coups de largesses sociales, les Algériens disent éprouver une sensation d’étouffement. À Alger, ce mal-être chronique s’appelle le « dégoûtage ». Il pousse les gens à fuir. Les plus riches partent faire leurs études à l’étranger, parfois pour ne plus revenir. Les plus audacieux risquent leur vie pour traverser la Méditerranée vers l’Europe. Les autres se tournent vers la religion, dans sa pratique la plus radicale. Les plus désespérés s’immolent. Ces dernières années, l’Algérie a battu des records de tentatives de suicide, des chiffres tenus secrets par le pouvoir.
A lire aussi : Présentation du Maghreb
L’enveloppe allouée aux budgets sociaux – 15 milliards de dollars en 2017, soit 23,7 % du budget de l’État – ne parvient plus à calmer les mouvements de colère, souvent associés à d’anciennes revendications culturelles (comme en Kabylie ou dans le Mzab), ni à maintenir le lien entre le peuple et le régime. Avec la chute des cours du pétrole et du gaz (95 % des recettes en devises), les revenus de l’État se sont brutalement affaissés, tombant de 62 milliards de dollars en 2014 à 25 milliards cette année. Constituées grâce à l’embellie financière des années 2000, les réserves financières du pays fondent. En deux ans, elles sont passées de 194 milliards à 110 milliards de dollars. Avec des caisses presque vides, l’État aura des difficultés à recourir aux artifices habituels pour calmer la rue : hausse des budgets sociaux, détaxation des produits de base, recrutement de fonctionnaires, grands travaux financés par l’État. Ce système avait permis à l’Algérie de s’éviter un « printemps arabe » en 2011.
Ce désinvestissement général peut avoir des conséquences catastrophiques dans ce pays de 40 millions d’habitants, « une poudrière » selon un rapport de la gendarmerie algérienne, révélé en juillet dernier. Dans dix ans, l’Algérie comptera 50 millions d’habitants. Son agriculture ravagée ne pourra pas les nourrir et son industrie ruinée sera incapable d’assurer des emplois à la jeunesse. Le gaz et le pétrole aussi s’épuisent. Dans quinze ans, les revenus des hydrocarbures ne suffiront plus à couvrir les besoins de la population. Tous les ingrédients d’une grave explosion sociale et d’une énorme vague d’émigration vers le nord se mettent en place.
Abdelaziz Bouteflika porte une responsabilité directe dans ce marasme. Pendant ses cinquante-quatre ans de vie politique, il aura accompagné ce régime autocratique, clone de l’Union soviétique. À Alger, comme à Moscou, les mêmes choix auront produit les mêmes effets : la ruine économique et l’affaissement moral du pays.
L’isolement diplomatique
Le système Bouteflika a conduit aussi l’Algérie à un isolement progressif. À l’exception de la Russie, restée un ami, fournisseur quasi exclusif de l’Algérie en armements, Alger a perdu la plupart des soutiens qu’elle avait jusqu’au début des années 2000, quand le pays était montré en exemple, en Europe et en Amérique, pour son combat contre le terrorisme islamiste. La révélation des exactions commises par l’armée durant cette « décennie noire », de gros scandales financiers et la corruption endémique, comme le jeu équivoque d’Alger avec les djihadistes au Sahel, ont dégradé son image.
Avec la France aussi, les relations se sont distendues. Les rapprochements successifs tentés par Jacques Chirac entre 2002 et 2007, puis par François Hollande depuis 2012, n’ont pas empêché le fossé de s’élargir. Des responsables algériens, tous liés de près au clan Bouteflika, réaniment à intervalles réguliers le ressentiment antifrançais. Cherchant à jouer sur les complexes de l’ancien colonisateur, ils exigent de la France sa repentance pour « les crimes de la colonisation. » Ahmed Ouyahia, le directeur du cabinet présidentiel, anime ce lobbying antifrançais. C’est de mauvais augure pour la relation bilatérale future car Ouyahia figure sur la liste des successeurs potentiels de Bouteflika. Abdelmadjid Tebboune, ministre de l’Habitat et du Logement, se montre hostile aux entreprises françaises de BTP. Chakib Khelil, l’ancien ministre de l’Énergie, s’est opposé à plusieurs reprises aux intérêts pétroliers français, comme Amine Mazouzi, le PDG de la Sonatrach (la Société nationale des hydrocarbures), acteur majeur de l’industrie pétrolière algérienne. Chasse gardée du régime, la Sonatrach est la force de frappe financière du clan présidentiel.
Même sur le plan militaire, jusque-là épargné, la coopération avec la France se dégrade. Le gouvernement algérien s’est dit froissé par l’amélioration de la relation entre Paris et Rabat et par l’activisme français en Libye. La coopération militaire franco-algérienne a donc été gelée, sous l’autorité du général Ahmed Gaïd Salah, le chef d’état-major de l’armée, fidèle d’entre les fidèles du clan Bouteflika.
Quel successeur ?
Ces polémiques et ce jeu des chaises musicales dissimulent des règlements de comptes, au plus haut de l’État, en vue de la succession. Le clan Bouteflika poursuit un objectif : pérenniser le système actuel à son profit. L’état-major, le DRS et le FLN ont été successivement maîtrisés et épurés des opposants potentiels. Hier tant redouté, le DRS a été rattaché à la présidence en janvier 2016. Trois piliers du clan présidentiel sont à la manœuvre pour verrouiller la transition : les généraux Ahmed Gaïd Salah, 76 ans, chef d’état-major et vice-ministre de la Défense, et Athmane Tartag, 66 ans, le patron du nouveau DRS ; et Djamel Ould Abbès, secrétaire général du FLN, fidèle du clan présidentiel.
Parmi les civils, d’autres proches de Bouteflika espèrent jouer un rôle de premier plan. Le plus en vue, Abdelmalek Sellal, 68 ans, haut fonctionnaire d’origine kabyle, ministre sans discontinuer depuis 1998 et Premier ministre depuis 2012, assure l’intendance au sommet de l’État. L’ancien ministre de l’Énergie Chakib Khelil, 77 ans, ami personnel de « Boutef » est lui aussi sur la liste des prétendants, malgré des accusations de corruption et un exil de trois ans aux États-Unis. Revenu à Alger en mars 2016, il a réintégré l’équipe présidentielle. Proche du président, Ahmed Ouyahia, 64 ans, son chef de cabinet au palais El Mouradia, a été aussi son Premier ministre de 1995 à 2012. Il contrôle le Rassemblement national démocratique (RND), la deuxième force politique du pays après le FLN.
Du côté de l’opposition, beaucoup se voient bien placés pour la transition. C’est le cas de deux anciens Premiers ministres, Ali Benflis, 72 ans, réputé libéral, et Mouloud Hamrouche, 73 ans, réformiste. Appréciés à l’étranger, ils manquent de moyens et d’appuis au sein de la nomenklatura politique et militaire en Algérie. Rien ne dit non plus que le système acceptera de se laisser déposséder ou réformer, au risque de perdre beaucoup d’avantages.
Ce blocage interne accrédite la thèse d’une transition générationnelle et politique en douceur à laquelle travaille le clan présidentiel, derrière Saïd Bouteflika, 59 ans le 1er janvier prochain. Petit dernier de la fratrie Bouteflika (neuf enfants), plus jeune de vingt ans que son frère Abdelaziz, l’ancien élève des jésuites d’Alger joue depuis dix ans un rôle de premier plan. Son influence politique s’est accrue depuis la maladie du président (un autre frère, Mustapha, est le médecin personnel du chef de l’État). Fondateur en 2010 du Rassemblement pour la concorde nationale (RCN), Saïd prépare la succession, comme le prouvent la série de nominations de ces derniers mois et le rapprochement en cours avec la mouvance islamiste modérée.
La carte islamiste
Le clan Bouteflika aurait choisi cette alliance avec ces islamistes modérés pour maintenir la stabilité du pays à l’heure de la succession, tout en donnant une bonne assise populaire à la nouvelle équipe en quête de légitimité. L’islamisation rampante de la société algérienne est déjà une réalité. On le constate tous les jours dans les campagnes et dans les villes, où les débits de boisson et les cinémas ferment les uns après les autres, où le voile islamique gagne du terrain. Réintégrés dans la société civile à la faveur de la politique de concorde nationale menée par Bouteflika depuis 1999, les islamistes ont déjà conquis des pans entiers de l’économie. Ils contrôlent une partie des circuits d’importation, notamment les denrées alimentaires et les produits électroniques.
A lire aussi : Les multiples visages de l’islamisme
Abdelaziz Bouteflika et son clan laissent faire. Ce modus vivendi avec les islamistes sert leurs intérêts. Le dernier grand projet de sa présidence – la grande mosquée Djamaâ el Djazaïr – illustre ce rapprochement. Confiée à un conglomérat algéro-chinois, cette « cité islamique » comprendra douze bâtiments, une salle de prière pour 120 000 fidèles, une bibliothèque d’un million de livres. Surplombé d’un minaret de 265 mètres de haut – 55 mètres de plus que le minaret de la grande mosquée Hassan II de Casablanca (au Maroc) ! – ce projet pharaonique devait coûter à l’origine 1 milliard d’euros, l’équivalent de quarante hôpitaux pour ce pays qui en manque tant. Le chantier dépasse déjà les 2 milliards. Prévue en 2016, son inauguration a été retardée à 2020. On dit à Alger que Bouteflika sera de nouveau candidat, en 2019, pour pouvoir inaugurer, en personne, « sa » grande mosquée…