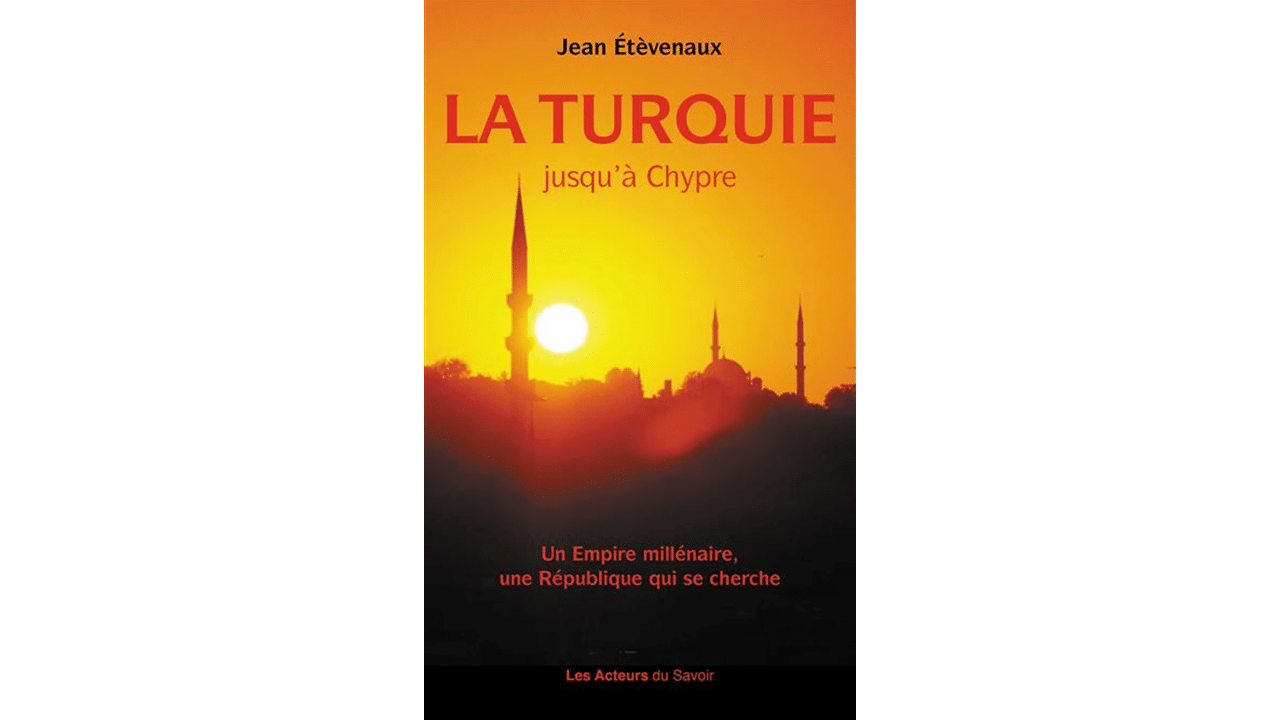Guy Mollet, Félix Gaillard et la descente aux enfers
En 1956, j’ai 15 ans. Nous sommes sous la IVe République, le pouvoir est entre les mains du président du conseil des ministres et le président de la république, René Coty, ne joue qu’un rôle modeste, comme en Italie ou en Allemagne aujourd’hui.
Notre président du conseil, Guy Mollet, n’était pas seulement calamiteux en politique étrangère, mais il se lança avec son ministre des finances, Félix Gaillard qui lui succédera en 1957, dans de grandes manœuvres financières que je m’obstinais à essayer de comprendre. Son étiquette de « socialiste SFIO » (section française de l’internationale ouvrière) anticommuniste ne me disait pas grand-chose.
Je suis alors en première puis en « Maths-élem » au Lycée Descartes de Châtellerault. L’économie n’était alors pas enseignée dans le secondaire et les discussions avec les copains étaient décevantes : la prochaine « surboum » et le permis de conduire à obtenir le jour de leurs 18 ans leur semblaient bien plus intéressants. Mon père, autodidacte très concret, plutôt de droite, haussait les épaules « devant tant de bêtises » et ma mère, plus intellectuelle et plutôt de gauche, estimait que les questions économiques et financières étaient méprisables. Elle préférait parler de Simone de Beauvoir en présidant les repas pendant les fréquents voyages de mon père. Ça nous semblait un snobisme bizarre. Maman, marre de cette « du bavoir », explique-nous plutôt ce qui se passe !
Je n’avais donc pour comprendre l’économie que le duel entre le Figaro et les médias de gauche.
Le premier dénonçait les tours de vis fiscaux de plus en plus serrés, tandis que les seconds célébraient les avancées sociales, au coût desquelles s’ajoutaient ceux de la guerre d’Algérie. Le franc craqua et fut dévalué de 20 %. La hausse des prix corrélative mangea alors les « avancées sociales ». Je n’étais ni pour ni contre ces dernières, mais avais les yeux ronds de les voir présentées comme gratuites.
Mon amour de l’histoire m’aidait néanmoins un peu. Nos bons rois avaient eu eux aussi des guerres à financer, mais leurs solutions étaient difficilement applicables. Emprunter aux banquiers juifs, puis les brûler comme hérétiques pour ne pas les rembourser ? Rogner les pièces d’or ? Tout ça pour finalement se rabattre sur de nouveaux impôts : je lisais que c’était pour cela que Louis XVI avait convoqué les États généraux en 1789, suite aux dépenses de la guerre en Amérique !
En 1956–57, l’augmentation répétée des impôts ne suffisait pas, et il fallut vite passer aux emprunts auprès des nationaux ou de l’étranger, emprunts à longuement négocier un par un en acceptant des taux élevés ou des conditions politiques. J’enrageais de voir nos dirigeants quémander et cela s’ajoutait à l’exaspération de voir les gouvernements tomber de plus en plus rapidement.
Mais tout n’était pas noir : Jacques Anquetil gagna le tour de France. Par contre Sacha Guitry disparût. Ce joyeux misogyne ravissait les adolescents timides dans notre genre : « Je suis contre les femmes, tout contre… »
La découverte du Maghreb
Mon oncle Louis nous invitait de loin en loin chez lui en Tunisie. Il était arrivé dans ce pays en 1935, avait travaillé pour les Américains qui lui avaient enseigné la rigueur, s’était mis à son compte comme fournisseur de matériel agricole aux colons français et à leurs mécaniciens italiens. Il était devenu plus tunisien que les Tunisiens, presque physiquement, en reprenant inconsciemment leurs mimiques.
Ce n’est que plus tard que je compris la complexité de la situation mais, à cette époque, c’est plutôt avec les cousins de mon âge que je discutais. L’aîné, Jean, qui allait vers ses 20 ans, s’intéressait au pays et parlait l’arabe dialectal, le plus jeune, André, qui commençait son adolescence, était une graine de pied-noir classique, et me traitait de « frankaoui ». On pourrait traduire diplomatiquement aujourd’hui par « métropolitain idéaliste », mais on disait plus brutalement à l’époque, « ce crétin qui ne sait pas que les Arabes ne comprennent que la force ». Il plaisantait cruellement sur les défauts des Tunisiens, ce qui me gênait un peu dans ce pays à 95 % musulman. De son côté, il était effrayé par les quelques attentats qui menèrent à l’indépendance en 1956. Elle fut pacifique et ne changea pas grand-chose à la vie des Français.
Qu’on ne se méprenne pas, je ne dénonce pas « le néocolonialisme », notion que j’ignorais alors, d’autant que la suite a montré que ce fut une bonne période également pour les Tunisiens. La brouille catastrophique entre Bourguiba et De Gaulle, qui cassa la Tunisie, ce sera pour les années 1960.
En 1956 toujours, je suivais sans rien comprendre le vaudeville qui allait aboutir à l’indépendance du Maroc : nous déposâmes le sultan légitime Mohamed V, avant de devoir ensuite le remettre piteusement sur son trône. Ce fut reproché à notre négociateur, Edgar Faure, traité de girouette, qui aurait repris cette vieille formule politique française : « Ce n’est pas la girouette qui tourne, c’est le vent ». À part quelques attentats comme en Tunisie, cette indépendance marocaine fut également pacifique, notamment, comme je l’appris plus tard, grâce à une bonne coopération entre officiers français et marocains, camarades de Saint-Cyr ou d’autres grandes écoles, qui s’entendirent pour « mettre à l’ombre » les activistes qui voulaient saluer l’indépendance par un massacre des Français.
Embrouilles en Algérie
Avec l’envoi par Guy Mollet de jeunes métropolitains réservistes, « les rappelés », pour renforcer l’armée française en Algérie et le massacre de 20 d’entre eux à Palestro par le Front de Libération nationale (FLN), les « Français de France » se sentirent concernés par l’actualité algérienne et les articles et reportages se multiplièrent.
Mais tous ces points de vue contradictoires m’embrouillaient. On parlait beaucoup du feuilleton hebdomadaire de Jean-Jacques Servan-Schreiber, « lieutenant en Algérie », dans l’Express qu’il co–dirigeait avec Françoise Giroud et où il décrivait son quotidien de rappelé loin de « l’Algérie française idéalisée ». À droite, on l’attaquait pour « atteinte au moral de l’armée », mais il paraît bien modéré aujourd’hui. Un chiffre flotte dans ma tête : plus de 400 000 rappelés passèrent par l’Algérie, dont 10 000 y furent tués.
Je lis alors tout ce que je peux, et malgré les critiques d’aujourd’hui sur la liberté de la presse, on pouvait lire de tout, de l’Humanité au Figaro et une masse de reportages ou d’interviews.
Conclusion pour moi : il y avait du sang de tous les côtés.
Entre musulmans pour commencer : le FLN massacre à Mélouza 330 sympathisants du mouvement rival, le Mouvement National Algérien (MNA), ce qui m’amène à remarquer la guerre permanente (10 000 morts, 23 000 blessés), notamment à Paris, entre ces deux courants nationalistes algériens pour le contrôle de la population musulmane.
Le FLN l’emporta grâce, dit-on, à l’appui soviétique, direct ou via l’Egypte, ce qui contribua à la division des Français, notre parti communiste étant alors aux ordres de Moscou. Et non ce n’est pas une accusation polémique, ce fait historique ayant été abondamment prouvé par la suite. Il appliquait la « ligne » soviétique de l’indépendance algérienne et se faisait gloire de procurer les armes au FLN. Ses «porteurs de valises » sont encore honorés dans l’Algérie d’aujourd’hui.
Le récit d’un gendarme à la radio m’a particulièrement frappé : un couple de pieds-noirs habitant près d’un village musulman avec lequel ils étaient en bons termes, est découvert abominablement massacré, le ventre de la femme ouvert pour tuer son bébé. Le gendarme était catastrophé et perplexe : « Je ne pense pas que ce sont les villageois qui ont fait ça, mais des envoyés du FLN. Il y aura une pression pour des représailles contre les villageois, mais elles les feront basculer vers le FLN, ce qui est justement l’objectif de cet assassinat. Et s’il n’y a pas de représailles, ce ne sera pas mieux, car le FLN dira : vous voyez bien qu’ils ne sont pas capables de protéger leurs amis et qu’ils n’ont pas le courage de les venger, c’est donc nous qui sommes les patrons ».
Dans ce contexte, l’armée est officiellement autorisée à pratiquer la torture, ce qui aide le général Massu à gagner la bataille d’Alger en reprenant la Casbah au FLN, mettant fin aux attentats contre les civils européens. Les auteurs de ces attentats sont toujours aujourd’hui considérés comme des héros en Algérie. La notion de « terrorisme » est relative…
Pendant ce temps, les Français se divisent entre partisans, surtout en métropole, d’une Algérie française donnant l’égalité des droits aux musulmans et ceux d’une « Algérie de papa » selon la formule gaullienne, vision d’un grand nombre de Pieds-noirs glorifiant la création et la mise en valeur du pays sous leur direction et soulignant qu’il était aussi leur terre natale. Cela sans parler des autres tendances, dont celle des parents des rappelés qui s’inquiétaient d’abord pour leurs enfants.
C’est pour sortir de cette confusion sanglante que certains allèrent chercher de Gaulle, qui finalement les roula tous. C’est du moins ce qui m’apparut au fil de l’année 1958.
Tous gaullistes
Avec quelques copains, je sentais cafouiller le vieux monde politique. Et puis de Gaulle vint. Nous allions pouvoir enfin avoir une action politique concrète ! Puisque les communistes n’étaient pas contents, nous dessinèrent une croix de Lorraine sur les vitres de la voiture d’un notable du parti.
Nous avions l’impression de voler de victoire en victoire en suivant les manœuvres du général, ses déclarations, son entrevue avec le président Coty et toutes les étapes qui le rendirent indispensable et désiré, alors qu’il était quelques semaines auparavant considéré comme un simple glorieux retraité.
Son élection comme président du conseil par l’Assemblée nationale fut un délice pour mes copains et moi : tous les caciques de la IVe république rivalisaient pour « en être ». En quelques jours, ils étaient tous devenus gaullistes ! Sauf un, qui s’attira une remarque du général en pleine séance de l’assemblée votant sa nomination : « Monsieur Mitterrand, arrêtez de vous agiter ».
Nous commentions l’incident : « Il veut être le premier opposant et prendre date », « il est extrêmement vexé de ne pas avoir été président du conseil (après, de mémoire, avoir été 11 fois ministre), il pensait que c’était son tour et voilà que le général le lui vole ».
Brusquement, le problème algérien se simplifiait : De Gaulle disait « Je vous ai compris ». Pieds-noirs et musulmans applaudissaient ensemble. Je me suis dit « Mais il donne le droit de vote à tout le monde, alors que les Pieds-noirs s’y opposent depuis toujours, pourquoi applaudissent–ils aujourd’hui ? ». Effectivement, les élections suivantes amenèrent à Paris un grand nombre de députés musulmans. Nous étions toujours juridiquement en Algérie française.
50 ans plus tard, en Algérie où je m’efforçais de récolter des souvenirs musulmans de l’époque je lus et entendis « tout le monde y a cru, mais comme les Pieds-noirs n’ont pas changé leur comportement quotidien, ça a raté ». Ils ont notamment continué à balancer des blagues racistes impossibles à citer ici ! J’ai recueilli les souvenirs d’une jeune musulmane d’alors voulant devenir infirmière, « écartée» par le directeur pied-noir et n’obtenant son inscription qu’en faisant un scandale en se référant à l’égalité proclamée par De Gaulle.
J’appris plus tard que De Gaulle « avait une dent » contre les Pieds-noirs depuis son séjour à Alger pendant la 2e guerre mondiale, et cela pour deux raisons : leur pétainisme et le fait que leur attitude envers les musulmans menaçait le futur de la France en Algérie. Il gardait dès cette époque (1943) des contacts directs avec d’autres milieux algériens, dont Jean-Mouloud Amrouche, écrivain kabyle chrétien dont j’ai eu la petite fille comme étudiante, et qui était le frère de la grande chanteuse Taos. Il résumait bien la situation en disant douloureusement « Jean veut tuer Mouloud et Mouloud veut tuer Jean ». C’est ce qui arriva avec l’OAS et la prise de contrôle du pays par le FLN et il en mourut.
Comme aujourd’hui avec les réseaux sociaux, chaque camp ou chaque courant s’excitait sans se renseigner sur les problèmes des autres. Je commençais à ne plus supporter les raisonnements du genre : « on tue mes partisans, donc j’ai raison » brandis par tous les camps.
Ces excitations prolongèrent la guerre de quatre ans, en gâcha la conclusion pour tous les camps, et ont encore des répercussions aujourd’hui. Hier encore un vieux kabyle me disait : « La France a perdu l’Algérie, et l’Algérie a perdu la France ».