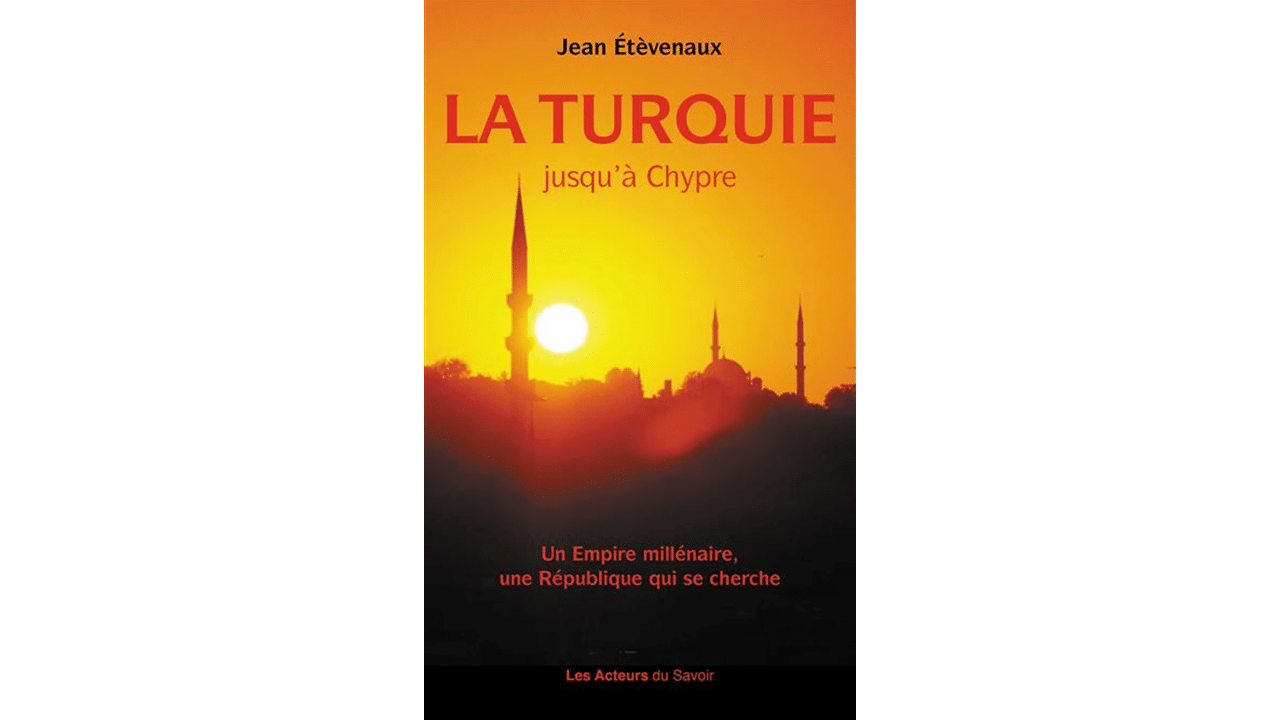Le Monde vu de Châtellerault
Le bonheur de l’école
Il est difficile de dater des souvenirs scolaires, les nouveaux effaçant les anciens. En remontant momentanément avant 1951, à Châtellerault, je me souviens d’une école primaire avec de nombreuses classes dans deux grandes cours et le décor communiste dont je vous ai déjà parlé dès que l’on sortait, tandis que le déjeuner était chez la grand-mère catholique.
Mais très vite je trouvai Cœurs Vaillants un peu bébête, et l’abandonnai pour un trésor trouvé au fond d’un meuble du salon : la collection de l’Illustration. Les numéros quotidiens de la guerre de 14 étaient d’abord épiques : les valeureux Poilus grattaient quelques mètres carrés aux Boches. Mais c’était navrant à la longue, parce que les morts s’accumulaient pour pas grand-chose. Je mis aussi dans un coin de ma mémoire des cartes du Proche-Orient qui m’intriguaient. Elles attribuaient de grands espaces à toutes les ethnies de cette mosaïque, ce qui en laissait très peu pour les Turcs. Je finis par comprendre bien plus tard que cette propagande occidentale avait poussé au massacre des Arméniens et de bien d’autres.
J’avais un vieil oncle qui avait vécu la Grande Guerre et j’attendais les repas de famille pour l’écouter. Malheureusement sa femme lui clouait le bec avec un « On en a marre des histoires d’anciens combattants », ce qui n’empêchait pas de presque aussi vieux combattants (à mes yeux) de claironner leurs hauts faits de la Deuxième Guerre mondiale, comme échapper au STO[simple_tooltip content=’« STO » : Service du Travail Obligatoire, mis en place en 1943 durant l’occupation de la France par l’Allemagne nazie.’][1][/simple_tooltip] ou se procurer un bon bifteck. Ou de faire l’original face aux craintes très répandues d’une invasion soviétique : « La vraie menace, c’est le péril jaune : ils sont 400 millions ! » (Ils sont presque 1 400 millions aujourd’hui).
Chaque année, on avançait symboliquement d’une salle de classe en direction de la sortie de l’école, jusqu’au jour où le directeur nous fit lever pour annoncer que 7 camarades et moi avions été admis en section classique du collège, celle où l’on étudie le latin.
Le collège
Le collège donnait sur « Les promenades » construites sur les anciens remparts et bordées d’édifices prestigieux comme le théâtre municipal ou la Banque de France. D’un côté la vieille ville au bord de la Vienne et son magnifique pont Henri IV, de l’autre les pavillons de moins en moins bourgeois au fur et à mesure que l’on s’éloignait du centre.
Le collège avait un plan solennel : il fallait passer par une entrée monumentale, traverser une cour d’honneur, puis les couloirs de l’administration et notamment passer devant le bureau du « surgé »[simple_tooltip content=’le « surgé » : surveillant général’][2][/simple_tooltip], petit homme irascible qui laissait sa porte ouverte pour sauter sur les retardataires. On arrivait enfin aux classes en préfabriqué sommaire près d’un parc ombragé.
Mon problème était de trouver un coin tranquille pour apprendre le poème du jour malgré les moqueries des copains. Car mon héros était le professeur de latin français, surnommé « Pendard », un peu bafouillant, ce qui impliquait de se mettre au premier rang si l’on voulait suivre. Je ne voulais pas le décevoir. Le choix des poèmes était abominablement classique d’après ma mère, mais au moins ils s’apprenaient aisément étant très structurés : la Pléiade et les Parnassiens étaient les plus faciles et je les répète encore aujourd’hui. J’ai eu le plaisir de les retrouver plus tard dans L’anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, qui fut un autre « Pendard » dans son jeune temps.
Mais, évidemment, les relire pendant la récré n’était pas bien vu. J’ai été parfois traité de frimeur et une discussion qui a mal tourné m’a laissé avec un nez légèrement tordu.
Un autre héros était le prof d’histoire-géo, et surtout ses manuels que j’avais entièrement lus trois jours après la rentrée.
Je découvris ensuite que les annuaires de la poste (pas La Poste, « les PTT »[simple_tooltip content=’« PTT » : Postes, Télégraphes et Téléphones, appelées Postes et Télécommunications à partir de 1959.’][3][/simple_tooltip]) avaient mécaniquement reproduit d’une année sur l’autre des introductions géo-historiques de chaque pays sentant bon leur avant-guerre, et c’était un prétexte pour s’arrêter à midi sur le chemin du déjeuner chez la grand-mère.
Pour les profs de maths, la sympathie a été moins immédiate, mais finit par s’imposer à partir des cas d’égalité des triangles. Cela malgré ce crétin de Thalès dont j’écrivais toujours les proportionnalités à l’envers, peut-être parce que j’étais un gaucher contrarié.
Tous les matins, je partais en vélo de ma campagne faire les 4 km me séparant du collège et j’étais rejoint par un camarade, « Porthos » dans mon esprit du fait de sa silhouette. Il sortait d’une de ces grandes maisons de ferme bordées de communs et de potagers. Mon camarade m’expliqua que son père était le responsable de la CGT locale. C’était l’occasion de comprendre enfin ce qu’était ce mystérieux et bienfaisant syndicat, et je demandais à discuter avec lui en rentrant du collège. Je fus extrêmement déçu, car ce qui intéressait d’abord ce responsable, c’était le Pineau des Charentes ! Je mis longtemps à comprendre que tout le monde n’était pas investi à 100 % dans son travail, surtout lorsque, comme lui, on approchait de la retraite. J’avoue que je ne l’ai toujours pas compris totalement aujourd’hui.
C’est ce même camarade qui me mit en contact avec d’autres travaillant à la chaîne, et qui en étaient heureux : « C’est toujours la même chose, on n’est donc pas obligé de se concentrer sur le travail et on peut penser à ce qu’on veut ». Beaucoup plus tard, mes camarades étudiants me dirent que « je n’avais rien compris à la souffrance ouvrière ».
En terminale, le prof de maths était un vieux monsieur très pédagogue et concret, qui peaufinait sa dernière année d’enseignement. Ma mention « très bien » fut d’abord la sienne. C’était la première de sa carrière et il était manifestement aux anges. Il me signala la meilleure prépa de la région.
Je ne savais pas que c’était la fin de l’école heureuse !
Mais nous voilà déjà en 1958. Revenons en arrière, voir ce que devenaient nos voisins.
En Allemagne
J’y retournais environ tous les deux ans. Les Français n’étaient plus des occupants, mais des alliés. L’armée française était dans les casernes et non plus dans des logements réquisitionnés chez l’habitant. Mes correspondants, maintenant retraités, avaient quitté leur immense et solennelle maison pour une villa moderne sur les premières pentes de la Forêt-Noire. La maîtresse de maison prenait sa douche tous les jours dans la verdure ou la neige suivant les saisons. Elle emmenait ses enfants « s’endurcir » l’été dans le vent frais et l’eau froide des îles de la mer du Nord, à leur grande détestation.
Le fossé culturel se creusait entre parents et enfants qui préféraient courir les boutiques pour choisir un jean à la mode. La mère soupirait et m’emmenait faire de grandes promenades en montagne pour me faire raconter tout ce que je savais d’Israël, pays qui lui semblait bizarre. Il faut dire qu’on sortait de 12 ans de nazisme et que la « communication » d’Israël se faisait sur le thème : « Nous sommes des athlètes faisant fleurir le désert, et non plus de faiblardes victimes ».
Profondément démocrates, ils affichaient des caricatures en français : un Napoléon III à tête de porc faisant face à des paysans à tête d’âne : « Pouvions revenir, j’avions point changé, j’voterons encore oui ». Et s’amusaient à appeler « Otto von Bismarck » un chien de faïence à l’expression bébête.
En Angleterre
À partir de la quatrième, il fallait une deuxième langue. Seul l’anglais était proposé, mais« la » prof n’était vraiment pas terrible et nous avons fini par manifester contre elle dans la cour d’honneur. Bref, je me retrouvai envoyé en vacances dans une famille anglaise.
C’était dans une vieille maison aux planchers obliques, où tout roulait sous les lits. La maîtresse de maison me prévint immédiatement : « Je sais que ce que ce je fais n’est pas bon, mais je me refuse à passer tout mon temps dans ma cuisine comme les femmes françaises ». Effectivement j’ai beaucoup maigri, comme en Allemagne d’ailleurs, où alternaient les saucisses froides au pain noir et des saucisses d’une autre couleur au pain gris.
J’interviewais mon correspondant, de 13 ans comme moi, qui me disait regretter les vacances qui l’éloignaient de sa chère et chic pension. Il me racontait avec émotion les « parties » où l’on dansait entre garçons.
Les vacances terminées, je fus accepté pour une semaine dans cette fameuse école. À l’entrée, il y avait un circuit hydraulique simulant le fonctionnement de l’économie. À part ce détail intéressant, je n’ai pas gardé un souvenir fantastique de l’enseignement. En cours de français, j’étais le cobaye et, en histoire, je soupirais de voir l’Antiquité réduite à : « Les Gaulois allaient régulièrement en Italie piller Rome, et les Romains venaient en France et en Angleterre pour nous piller ». Le tout assorti d’une caricature montrant un Romain et un Gaulois se croisant dans les Alpes. Humour britannique, probablement. On passait ensuite rapidement à la « guerre des Deux-Roses», à laquelle je n’ai rien compris.
Je crois qu’il n’y avait pas de cours de géographie. Les connaissances étaient de toute façon sommaires, car j’ai entendu : « En France, au sud de la Loire, la race n’est plus pure ».
Bref, la langue et la civilisation anglaises ne se sont pas présentées à mes yeux sous leurs meilleurs atours. Alors que notre prof d’allemand, surnommé « Hitler » pour son exigence autoritaire, nous faisait savourer de beaux poèmes décrivant les facettes d’une civilisation.
Cinquante ans plus tard, j’en savais toujours davantage que mes étudiants allemands de l’ESCP pourtant bien sélectionnés mais apparemment décérébrés par une « culture moderne » à l’américaine :
« Que vous évoque le Rhin ? »
« Heuh, rien de spécial Monsieur, je suis de Berlin ».
Ô mânes de Wagner et de la Lorelei !
Voir le site d’Yves Montenay
#2 – Algérie, Hongrie et Canal de Suez : 1954-56, tout se complique !
#4 – Des gouvernants calamiteux et l’affaire algérienne achèvent IVe République