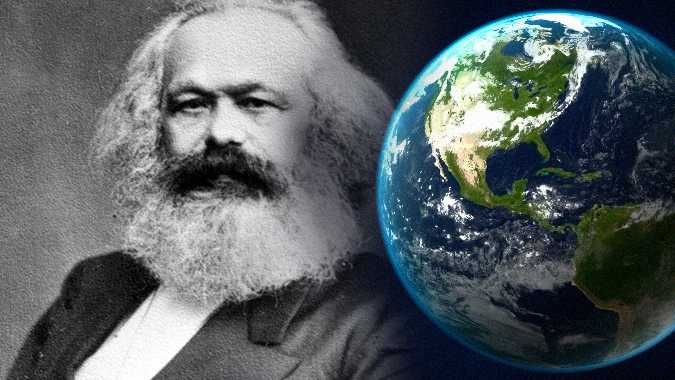La théologie de la libération n’a jamais disparu. Elle s’est transformée en écologie de la libération. Les auteurs des années 1970 ont muté le marxisme en écologisme, défendant un projet politique sous couvert de protection de l’environnement. L’écologie de la libération risque de nuire au catholicisme d’Amérique latine, comme la théologie de la libération avant elle.
Ce que l’on a appelé « théologie de la libération » n’a jamais été un mouvement monolithique. Néanmoins, ses courants les plus importants ont été influencés par la pensée marxiste, comme de nombreux libérateurs l’ont reconnu librement. La lecture du classique de Gustavo Gutiérrez Une théologie de la libération : L’histoire, la politique, le salut (1971) le confirme amplement. Ce stimulus était encore plus évident dans les œuvres d’éminents libérateurs comme Leonardo Boff et Jon Sobrino.
L’effondrement du socialisme en Europe de l’Est a créé des défis importants pour les libérationnistes qui se sont appuyés sur l’analyse marxiste. Alors que beaucoup affirmaient que le bloc soviétique s’écartait des idéaux marxistes, de tels systèmes avaient donné corps à des engagements marxistes clés. Il s’agit par exemple de la minimisation (voire de l’abolition effective) de la propriété privée, de la subordination formelle du droit à l’idéologie marxiste et de l’hostilité à la religion.
1989 n’a cependant pas conduit certains théologiens de la libération à remettre en question leurs hypothèses fondamentales. Nombre d’entre eux ont simplement porté leur attention sur l’environnement. Parmi les choses que nous avons apprises du Synode de l’Amazonie, il y a la mesure dans laquelle cette pensée s’est répandue dans le catholicisme latino-américain.
Libération de l’environnement
Parmi les théologiens de la libération qui sont passés à ce qu’on appelle « l’écologie de la libération », Leonardo Boff est celui qui est allé le plus loin en essayant d’immerger le catholicisme dans les préoccupations et l’idéologie environnementalistes. Dans Cry of the Earth, Cry of the Poor (1997), Boff affirme que l’Église « ne peut enfermer les chrétiens dans des dogmes et des représentations culturelles. Il doit servir de lieu organisé où les gens peuvent être initiés, accompagnés et aidés [à exprimer] l’esprit du temps. »
Que « l’esprit du temps » ne corresponde pas toujours à la vérité sur Dieu n’est pas une question que se pose Boff. Quoi qu’il en soit, l’esprit de l’époque, du moins pour Boff, était l’écologisme. Le livre de Boff de 1997, par exemple, affirmait que « la Terre n’est pas une planète sur laquelle la vie existe… la Terre ne contient pas de vie. La Terre c’est la vie, un superorganisme vivant : Gaia. »
L’hypothèse de Gaia a été formulée pour la première fois par le chimiste James Lovelock dans les années 1970. Elle s’est depuis propagée à d’autres disciplines, dont la théologie. À plusieurs reprises, Boff a reconnu que « La vision de James Lovelock… nous a aidés à voir non seulement que la vie existe sur Terre, mais aussi que la Terre elle-même est un organisme vivant ».
L’argument de Lovelock était que toutes les entités vivantes (animaux, plantes, etc.) sur Terre coopèrent efficacement avec les composés inorganiques (oxygène, métaux, etc.). Cela fait de la planète une entité autorégulatrice, peut-être même autogérée, qui préserve tous les éléments essentiels de la vie, à condition que les humains n’interfèrent pas trop dans ce qui se passe.
Vers la fin des années 1990, l’hypothèse a commencé à s’effondrer sous l’effet d’une critique scientifique sévère. Certains scientifiques ont souligné, par exemple, que la théorie de Gaia ne pouvait expliquer le fait que certaines parties du monde naturel avaient des effets naturellement néfastes sur d’autres parties de l’environnement. Bref, il y avait beaucoup de désaccord dans la nature qui ne devait rien à l’action humaine.
D’autres scientifiques ont critiqué les aspects non scientifiques et téléologiques de la théorie de Gaia – des caractéristiques qui ont fait l’aller et le retour de Lovelock lui-même. Ses connotations pseudo-religieuses émergent lorsque l’on découvre que Gaia est le nom de l’une des déesses grecques les plus primordiales. Dans la mythologie grecque, Gaïa (qui prend le nom encore plus révélateur de « Terra » dans le mythe romain équivalent) personnifiait la Terre elle-même. L’attribution du statut divin à la création de Dieu plutôt qu’à Dieu lui-même a un nom : c’est-à-dire le panthéisme.
Au cœur de l’adhésion de Boff à la théorie de Gaia se trouve son insistance pour que les humains acceptent qu’ils ne sont pas seulement homo sapiens (l’homme sage) mais aussi, selon Boff, homo demens (l’homme dérangé) : une espèce dont la démence s’exprime dans l’incapacité de reconnaître le monde naturel comme l’équivalent humain.
Au cœur de l’écologie de la libération de Boff se trouve donc une forme d’égalitarisme biologique. Dans la prochaine « démocratie écologique et sociale », déclare Boff, la religion va promouvoir l’idée que « ce ne sont pas seulement les humains qui sont citoyens mais tous les êtres… ». La démocratie est donc une question de biocratie et de cosmoscratie.
La façon dont les plantes, les animaux, les glaciers, le feu ou les métaux exerceraient leur citoyenneté dans la biocratie de Boff n’est pas claire. Après tout, ils manquent de raison et de libre arbitre. Mais Boff a défini une structure politique distincte pour sa démocratie éco-sociale. Elle devrait s’articuler autour « d’organismes mondiaux, tels que les Nations Unies et ses dix-huit institutions spécialisées et quatorze programmes mondiaux ». Une approche très centralisée et descendante des questions environnementales et de la politique en général était l’avenir. Comme à l’époque d’avant Gaia, le principe de subsidiarité ne semble pas avoir exercé d’influence substantielle sur la pensée de Boff.
Le Ciel sur Terre
Il y a une autre caractéristique de l’écologie de la libération qui a été préfigurée dans les théologies de la libération influencées par le marxisme. Il s’agit des tendances à « immanentifier l’eschaton », pour reprendre l’expression employée par le politologue Eric Voegelin.
L’une des caractéristiques des nombreuses théologies de la libération d’avant 1989 était leur silence relatif sur la vie que le christianisme enseigne au-delà de la mort. Au contraire, ils se concentraient presque exclusivement sur les injustices terrestres et sur la façon de les surmonter. Beaucoup de théologiens de la libération ont même dépeint l’enseignement chrétien traditionnel sur la souffrance comme potentiellement rédempteur, de la même manière que Marx présentait la religion : c’est-à-dire une rationalisation du statut quo injuste qui anesthésiait les gens devant l’injustice structurelle qui les entoure. Par la suite, certains libérationnistes ont soutenu que l’élimination de toutes les structures oppressives inaugurerait un état de choses plus naturel : un monde sans aliénation et remarquablement semblable à l’utopie terrestre qui, selon Marx, se trouvait à la fin de l’histoire.
Des schémas similaires imprègnent la pensée de certains écologistes de la libération. Dans une interview accordée en 2016, Boff affirme que les révolutions intellectuelles et économiques des XVIIe et XVIIIe siècles « ont donné naissance à l’idée de la conquête des peuples et de la Terre. La Terre n’était plus considérée comme la grande Mère, vivante et déterminée. Au lieu de cela, il a été réduit à quelque chose que les humains peuvent exploiter pour l’accumulation de richesses. » De ce point de vue, l’environnement pré-Lumières et précapitaliste était un monde placide, presque vierge, naturellement hospitalier pour les humains.
De telles affirmations sont historiquement discutables. Bien avant le XVIIe siècle, les humains utilisaient abondamment – et souvent maltraitaient – le monde naturel. Cela inclut les sociétés autochtones pré-chrétiennes. Dans A God Within (1973), le biologiste René Dubos, lauréat du prix Pulitzer, a illustré comment les peuples mayas ont infligé d’immenses dégâts écologiques dans tout le sud du Mexique et en Amérique centrale bien avant la conquête espagnole. Ces nations n’avaient jamais entendu parler d’Isaac Newton, d’Adam Smith ou des économies de marché.
Plus généralement, l’écologie de la libération a un côté nettement romantique. Ses adeptes semblent réticents à admettre que, avec ou sans les humains, le monde naturel n’est pas un paradis symphonique. Les animaux, par exemple, ne sont guère gentils entre eux. Des millions d’espèces ont disparu sans aucune intervention humaine. De plus, la nature a infligé d’énormes dommages aux gens pendant des millénaires par le biais d’événements imprévisibles comme les tremblements de terre. L’affirmation selon laquelle l’environnement est en quelque sorte naturellement inoffensif et nourricier, sauf lorsque les humains le perturbent, n’est tout simplement pas vraie.
À cela il faut ajouter que ni le judaïsme des Lumières ni le christianisme n’ont investi les plantes ou les animaux d’un statut équivalent à celui de l’homme, et encore moins d’une Mère divine. En effet, le judaïsme et le christianisme ont joué un rôle central dans la dé-divinisation du monde naturel. Ils ont ainsi contribué à balayer les religions païennes de Grèce, de Rome, d’Égypte et de Babylone qui attribuaient irrationnellement des qualités divines à des éléments comme l’eau et des activités comme la guerre. Certes, les Écritures présentent le monde créé comme bon. Mais ils ne dépeignent pas le monde naturel comme parfait ou ne prétendent pas que la nature est intrinsèquement meilleure que l’homme ou égale à lui, car c’est là que se trouvent les pentes glissantes du syncrétisme et du paganisme.
Pas de salut en dehors de la politique
Il y a cependant une autre similitude importante entre les théologiens de la libération d’hier et les écologistes d’aujourd’hui. Aucun n’a réussi à endiguer la dérive des Latino-Américains qui s’éloignent du catholicisme.
Il y a de nombreuses raisons à ce déclin, mais l’une d’entre elles est certainement la façon dont de nombreux théologiens et écologiens de la libération situent l’essence du salut en politique. Dans des remarques écrites en 1984, Joseph Ratzinger a observé que la plupart des théologiens de la libération croyaient que rien ne se trouvait en dehors de la politique. C’est pourquoi, a-t-il dit, ils considéraient toute théologie qui n’était pas « pratique », c’est-à-dire qui n’était pas essentiellement politique, comme « idéaliste » et donc dépourvue de réalité, ou qui est condamnée comme un véhicule pour le maintien du pouvoir par les oppresseurs. À en juger par leurs écrits, de nombreux écologistes de la libération adoptent cette position.
Le problème, c’est que la politique ne peut pas répondre à ces questions ultimes sur la vie, la mort, le bien, le mal, les origines et le destin ultimes de l’humanité qui hantent l’imagination de chacun. Peut-être une des raisons pour lesquelles certains Latino-Américains ont embrassé diverses confessions évangéliques est que beaucoup de ces mouvements font passer le Christ en premier et maintiennent fermement la politique à sa place. C’est une leçon, cependant, que certains écologistes de la libération d’Amérique latine et leurs compagnons de voyage ecclésiaux n’ont pas absorbée. Et comme la théologie de la libération, les dommages causés par l’écologie de la libération radicale à la capacité – voire à la volonté – du catholicisme d’évangéliser les Latino-Américains seront probablement profonds et durables.
Traduction : Conflits