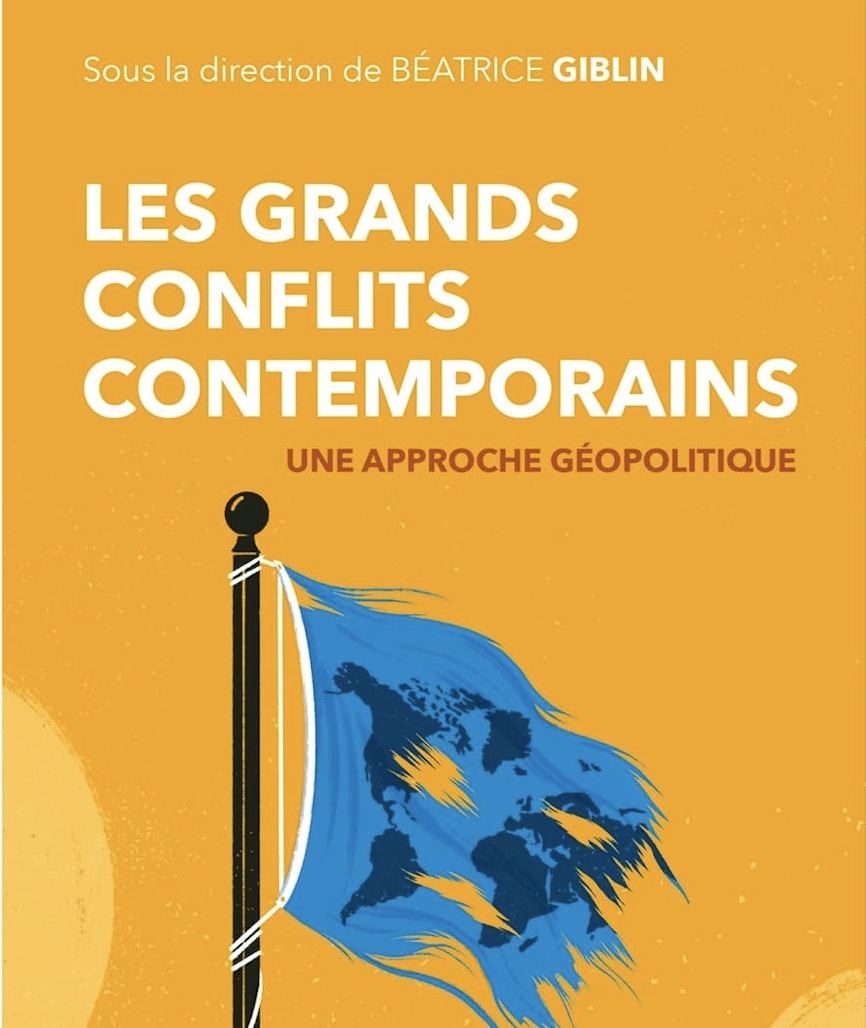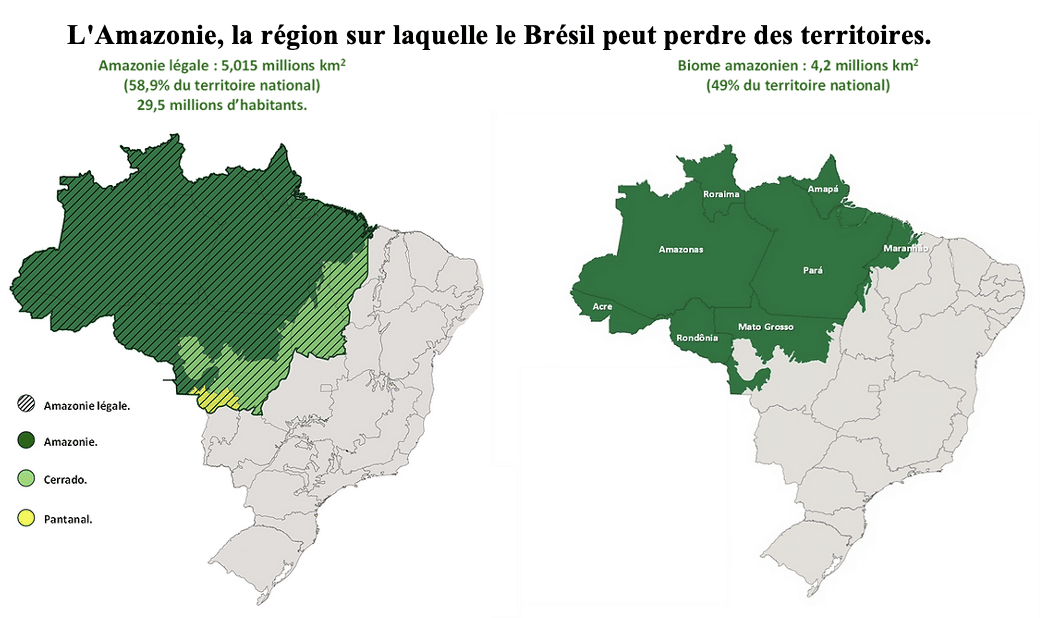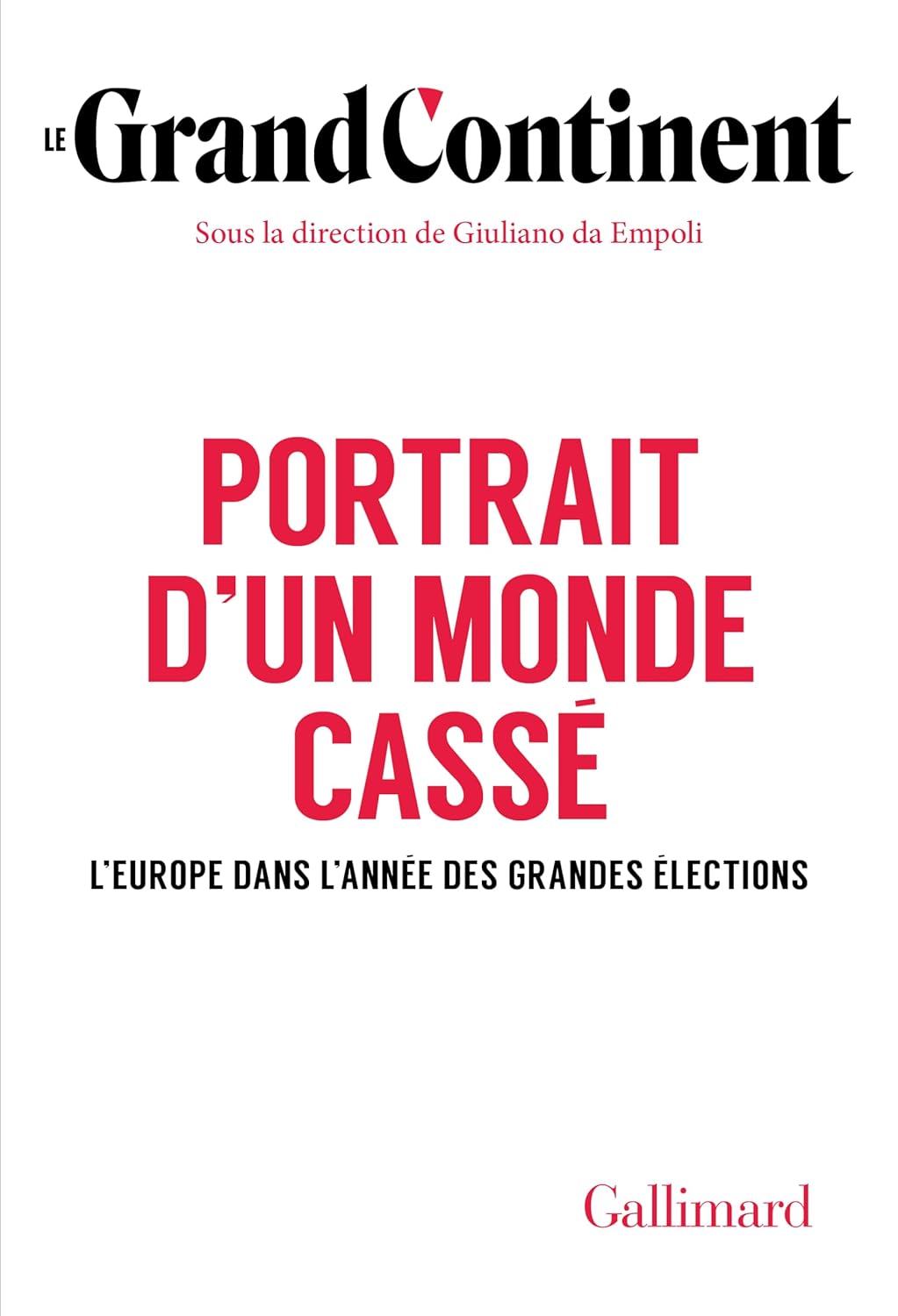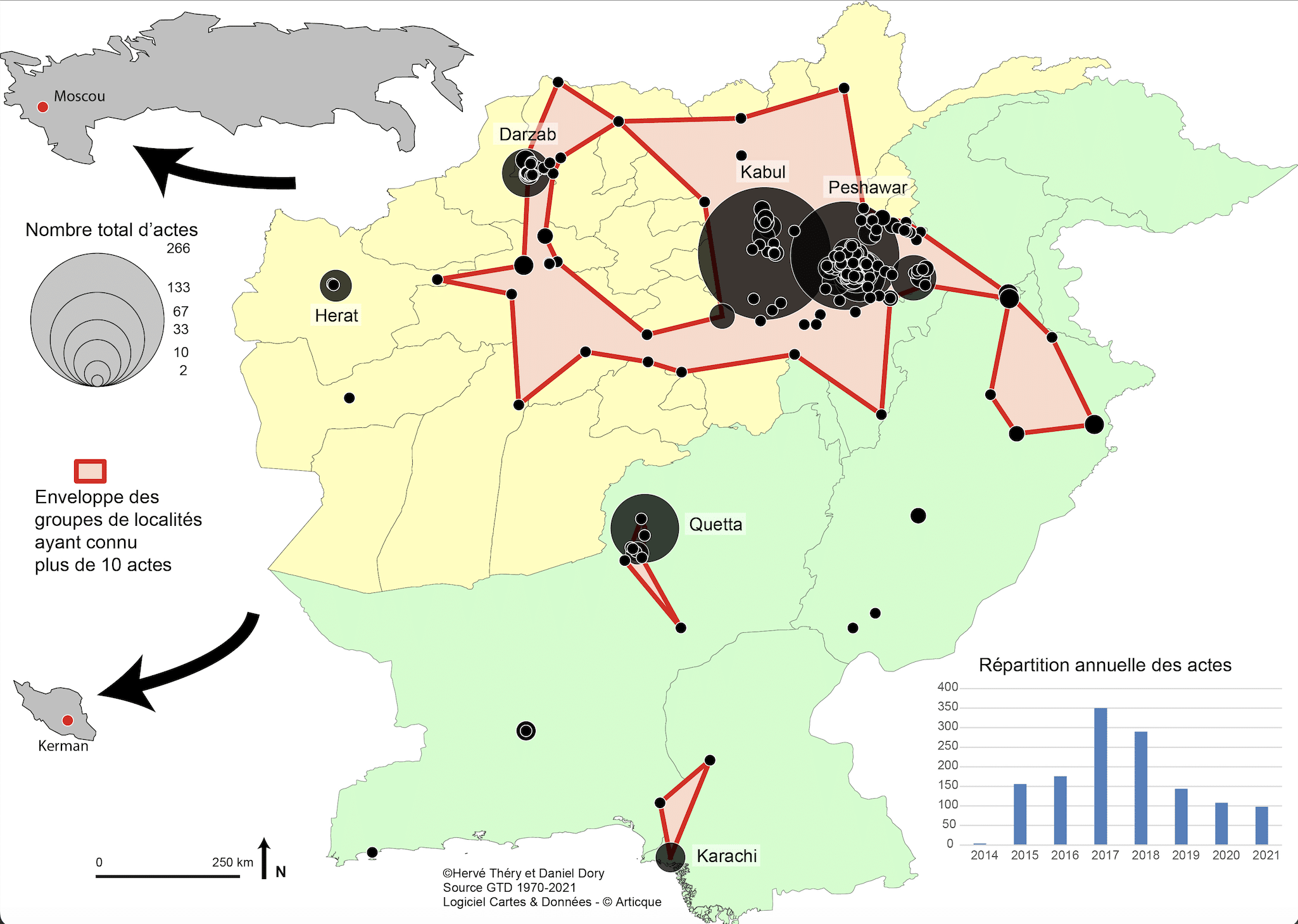Cet ouvrage présente l’immense intérêt d’être très à jour sur les conflits en cours. Pour autant, surtout lorsque l’on subit le tourbillon des chaînes d’information en continu, cette publication permet de prendre du recul et de comprendre les ressorts des confrontations actuelles et à venir.
Béatrice Giblin (Dir) Les grands conflits contemporains, une approche géopolitique. Armand Colin – Mai 2024.
Une place privilégiée dans les différents articles, où l’on retrouve des spécialistes connus comme Frédéric Encel, Yves Lacoste, Myriam Benraad ou Philippe Subra, est accordée à ce que l’on appellera « les confrontations majeures ». La guerre en Ukraine ou le conflit israélo-palestinien relancé depuis le 7 octobre dernier, occupent évidemment une bonne place. Mais en réalité, l’orientation que la directrice de publication Béatrice Giblin a voulu donner à cet ouvrage échappe à cet écueil « journalistique », pour traiter les différents sujets au fond. Le premier enseignement que l’on trouvera est le suivant : « il n’y a pas de petits conflits géopolitiques ». Les conflits transnationaux comme l’Ukraine ou Gaza se trouvent en 5e partie, tandis que la première est consacrée à des conflits locaux urbains et ruraux à Marseille, Jérusalem, mais aussi dans les campagnes de France autour de « la question de l’eau », opposant agriculteurs et autres usagers.
La frontière comme lieu de confrontation est examinée sous l’angle des relations entre le Mexique et les États-Unis, mais également à propos de la guerre au Kivu, située à l’est de la république démocratique du Congo mais frontalière du Burundi, du Rwanda et de l’Ouganda. La guerre y est endémique depuis au moins 25 ans. Ce chapitre aurait pu d’ailleurs se situer dans la 4e partie de l’ouvrage qui traite de la conquête des ressources, en raison des enjeux miniers de ce territoire qui souffre de ce que l’on peut appeler la malédiction des matières premières. L’or et le diamant y sont évidemment convoités, au même titre que la cassitérite, le coltan ou le wolfram. Les usages de ces minéraux se retrouvent dans les composants électroniques comme dans les aciers spéciaux.
De la même façon, et surtout dans le contexte actuel envisager, comme le fait Frédéric Encel, Jérusalem comme une capitale frontière est d’autant plus pertinent qu’il ne sera pas possible d’évacuer le statut de cette ville dans l’hypothèse d’un règlement de la paix, même si ses perspectives s’éloignent.
Il n’y a pas de petits conflits, en effet, le premier article de l’ouvrage, après la mise en perspective de Béatrice Giblin, est consacré à Marseille. Son auteur, Simon Ronai, analyse avec beaucoup de soin les rapports de force entre la ville et son environnement, notamment celui des structures territoriales qui organisent la métropole avec 92 communes représentées par 240 membres. La périphérie se sent riche face à une ville centre appauvri.
Frédéric Douzet et Thomas Cattin ne sont pas trop de 2 pour examiner la situation complexe de la frontière entre le Mexique et les États-Unis. 3 000 km, 40 points de passage, un fleuve comme le Rio Grande et des conurbations rendent cet espace qui sépare pays en développement et économie développée particulièrement sensible. 270 millions d’individus empruntent les points de passage, tandis que la circulation des biens, des capitaux, des informations et des produits illégaux a été largement favorisée par les différents accords de libre-échange.
Cette frontière est aussi un enjeu pour les élections majeures, au niveau des états concernés, comme pour l’élection présidentielle américaine.
La 3e partie aborde, après une introduction de Béatrice Giblin, les nationalismes régionaux. Le ressort est souvent le même, celui d’un sentiment de mépris subi de la part de l’État central, notamment pour ce qui peut concerner l’usage de la langue, la place des habitants dans les institutions de l’État, les politiques de développement.
Pour autant, les conflits engendrés peuvent être très différents, allant de l’affrontement comme au Kurdistan à la confrontation démocratique pour l’Espagne avec la question basque et catalane.
Yves Lacoste et Béatrice Giblin abordent pour leur part le nationalisme régional de la Kabylie. L’unité imposée par le FLN suscite un mécontentement qui peut s’exprimer par la revendication linguistique, une sorte de nationalisme culturel, avec dans le fond une certaine forme de résistance à une arabisation normalisatrice que la jeunesse refuse.
La 4e partie aborde 2 questions qui seront très largement étudiées par les candidats de la filière lettres du concours de l’école militaire interarmes, à savoir « les guerres de l’eau en question », avec un article de Leïla Oulkebous, et celui de « l’avenir géopolitique du pétrole à l’horizon 2050 », par Benjamin Augé.
Paradoxalement, la volonté de diminuer les émissions de carbone, car les ressources naturelles qui permettent de développer les technologies bas-carbone suscitent des convoitises et bien souvent des phénomènes de corruption, des conflits environnementaux, et au final des affrontements.
Béatrice Giblin et Yves Lacoste traitent respectivement de la guerre en Ukraine et à Gaza, des sujets qui pourraient largement être développés plus longuement. Ce qu’il faut surtout noter à propos de ces 2 articles d’une trentaine de pages, c’est surtout celui de leurs conséquences géopolitiques à moyen et à court terme. La Russie joue son destin dans ce conflit, tout comme Israël d’ailleurs. Car il s’agit là de guerres existentielles, celles dans lesquelles les belligérants remettent en cause l’existence même de leur ennemi. La guerre du Nagorny Karabagh qui se termine en 2023 par la disparition d’une entité existant depuis plusieurs siècles aurait pu figurer dans cet inventaire.
Le dernier article de l’ouvrage, rédigé par Frédéric Douzet et Aude Géry, nous permet d’aborder une nouvelle dimension. « L’extension continue du champ de la conflictualité dans le cyberespace », cet environnement créé par l’interconnexion planétaire des systèmes d’information et de communication, est une dimension de plus en plus prise en compte par les militaires. Cela trouve son application au plus petit niveau, celui du groupe de combat ou de l’équipe, et celui que l’on a longtemps appelé le caporal stratégique est également un acteur de la guerre électronique, au même titre qu’un groupe informel ou un état.
En un peu moins de 300 pages, cet ouvrage qui est condamné à vieillir, en raison des événements à venir, devrait quand même être précieusement conservé en référence. Car au-delà de l’actualité qui passe, les fondamentaux demeurent. Et puis l’immense mérite de tous les auteurs est celui qui consiste à prendre le risque de la prospective, avec un horizon au milieu du siècle, ce qui reste tout de même assez proche.
On me permettra pour conclure un souvenir personnel, celui de mes rencontres avec Béatrice Giblin et Yves Lacoste, dans une autre vie.
J’ai pour ces deux géographes qui ont accompagné ma formation une immense admiration pour leur savoir, mais aussi leur disponibilité et leur sens de l’écoute.
A lire aussi,
L’eau, paradigme essentiel de la géopolitique de l’Ouzbékistan